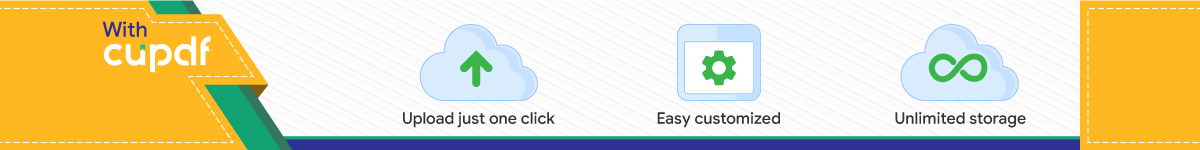
« L’État (et il ne pourrait en être autrement) ne s’occupe que de lui-même, il ne s’informe pas de mes besoins et ne s’inquiète de moi que pour me corrompre et me fausser, c’est-à-dire pour faire de moi un autre moi, un bon citoyen. »
Max Stirner, L’Unique et sa propriété, 1845.
Raisons d'État
ISSN 0335-5322
Revue soutenue par l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Publiée avec le concours du Centre national du livre, du Centre national de la recherche scientifique, du Centre de sociologie européenne, du Collège de France, de l’École des hautes études en sciences sociales et de la Fondation Maison des sciences de l’homme.
Numéro coordonné par Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle
et Franck Poupeau
Raisons d'État
201-202Mars 2014
4 Penser l’État Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau
Actions d’ÉtAt 13 L’action de l’État, produit et enjeu des rapports
entre espaces sociaux Vincent Dubois
26 Régimes génocidaires et compartimentation de la société Abram de Swaan
44 Le Brésil : un État-nation à construire Le rôle des symboles nationaux : de l’empire à la république Joseph Jurt
58 L’érosion discrète de l’État-providence dans la France des années 1960 Retour sur les temporalités d’un « tournant néo-libéral » Brigitte Gaïti
72 Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires Le chèque en gris de l’État à la police Didier Fassin
ActuAlitÉ de sur l’ÉtAt 89 Bourdieu, l’État et l’expérience chinoise
Pierre-Étienne Will
98 À propos de Pierre Bourdieu et de la genèse de l’État moderne Jean-Philippe Genet
106 Du bon usage des divergences entre histoire et sociologie Christophe Charle
112 État-mort, État-fort, État-empire George Steinmetz
120 Résumés
4
Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau
UN LIt de justice au Moyen Âge.
5ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 4-10
Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau
Penser l'État
La publication des Cours que Pierre Bourdieu a donnés au Collège de France entre 1989 et 1992 sur l’État a permis de dresser un bilan des recherches consacrées à cet objet. La journée d’étude organisée au Collège de France le 23 janvier 2012, à l’occasion de la parution du premier volume de ses enseignements et du dixième anniversaire de sa mort prématurée, a souligné la vivacité des enquêtes et analyses qui se sont développées depuis, en France comme à l’étranger, en science politique, histoire, anthropologie, ou en sociologie. Ce numéro, en grande partie issu de cet événement, s’inscrit dans la continuité de ce renouveau intellectuel. Avec ces échanges multiples, il participe d’abord d’une lecture des Cours Sur l’État. Mais, au-delà d’une mise à disposition critique des analyses de Pierre Bourdieu, il entend aussi réaffirmer une certaine manière de pra-tiquer la recherche en sciences sociales. En effet, avec la publication d’articles fondés sur des recherches empiriques originales, il défend la possibilité d’une science sociale de l’État distincte d’une lecture théorique de l’administration.
L’État – pluriel, divers, complexe – est un objet qui représente l’un des plus grands défis à la capacité analytique et synthétique des sciences sociales. Or, qu’elles l’aient délaissé ou que des disciplines plus « nobles » (philosophie, droit) aient tenté de l’accaparer – pour des raisons historiques sans doute plus liées à la politique des sciences qu’à leurs méthodes –, le regard historique et sociologique permet de renouveler les interrogations sur cette forme historique d’organisation politique. Ainsi, il ne s’agit pas de prétendre déterminer ce que l’État est, serait ou devrait être, mais plutôt de déployer une analyse critique de ce qu’il fait, produit ou exerce pour penser, à partir de ses effets pratiques, les dynamiques qui l’animent et le traversent. Moins qu’une ontologie de l’État, les recherches empiriques présentées ici participent de sa phénoménologie pour saisir, par ses actions et les discours qui les animent, certaines de ses formes mouvantes et dynamiques souvent invisibles aux approches convenues. Il s’agit ici d’articuler des recherches actuelles avec des réflexions de Pierre Bourdieu qui ne s’est attaché qu’assez tard à problématiser
6
Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau – Penser l'état
l’État en tant que tel tout en en ayant constamment traité indirectement dans ses travaux initiaux sur l’éducation, l’Algérie coloniale en révolte ou les classes dirigeantes. De cette préoccupation découle le format retenu pour ce numéro double : celui d’un dialogue, à travers les objets, les problématiques, les perspectives, mais aussi les personnes, les échanges ou les rencontres, afin de poursuivre une démarche intellectuelle et de rendre hommage au sens même d’une certaine perspective scientifique.
Penser l’État
« Rien n’est plus surprenant […] que de voir la facilité avec laquelle le plus grand nombre est gouverné par le plus petit nombre, et d’observer la soumission implicite avec laquelle les hommes révoquent leurs propres sentiments et passions en faveur de ceux de leurs dirigeants », constatait le philosophe David Hume dans un article sur les principes de gouvernement publié en 1758. En effet, cette capacité à gouverner ne procède pas de la force, laquelle se situe du côté des gouvernés. Et Hume d’en conclure que c’est « sur l’opinion seule que le gouvernement est fondé ». Dans son cours du 7 février 1991, Bourdieu s’appuie sur Hume pour avancer que « le problème de la croyance et celui de l’obéissance n’en font qu’un ». La soumission des dominés aux dominants ne résulte ni de la coercition, ni du libre consentement. Elle repose sur les catégories de pensée que les premiers partagent avec les seconds, ce que Hume appelait « l’opinion », et que Bourdieu a théorisé à travers le concept de « violence symbolique ».
Cette « violence » tient au fait que l’intériorisation des catégories de pensée et systèmes de classification, c’est-à-dire des structures cognitives qui désignent à chacun sa place dans la hiérarchie sociale, implique la méconnaissance de leur origine sociale et donc leur naturalisation. L’ordre social, semble alors aller de soi. En soulignant l’arbitraire de ces hiérarchies, le concept de « violence symbolique » peut sembler apparenté aux notions marxistes de mystification et d’aliénation. Il s’en démarque toutefois sur un plan politique car la « prise de conscience », moment clé pour échapper à l’aliénation chez les marxistes, ne suffit pas selon Bourdieu à se défaire de hiérarchies faites corps, fruits d’un long processus d’incul-cation qui façonne les habitus. Or l’État joue un rôle capital tant dans la production de ces structures cognitives que dans le processus d’inculcation, par le truchement du système scolaire notamment.
L’analyse des mécanismes de la domination permet ainsi à Pierre Bourdieu de compléter et de modifier la définition que Max Weber avait proposée de l’État. L’État ne se définit pas par le seul monopole de la violence physique, mais aussi par le monopole de la violence symbolique, cette dernière légitimant d’ailleurs la première : c’est au nom de la « pureté de la race » que l’Allemagne nazie a procédé à des exterminations en masse, au nom de l’intérêt de la « nation » que des États
7
Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau – Penser l'état
WRoCLaW, Pologne. Monument à la mémoire des victimes du massacre de la Place tian’anmen.
8
Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau – Penser l'état
se sont livrés des guerres meurtrières, au nom de la « citoyenneté » que les émigrés sont refoulés aux frontières. L’État est en effet le lieu de production des identités légitimes, qui justifient les politiques d’inclusion et d’exclusion.
Lieu de fabrication du « public » et de « l’officiel », l’État se définit en outre par son aspiration au monopole de l’universel : il a le pouvoir d’universaliser (et donc d’installer au sommet des hiérarchies sociales) certaines pratiques ou caractéristiques, au détriment d’autres attributs, ainsi déclassés et renvoyés à leur particularisme. On peut penser par exemple aux accents dits « provinciaux » par rapport à celui de l’élite parisienne, aux cultures dites « populaires » par rapport à la culture légitime sanctionnée par le système scolaire, ou encore aux propriétés dites « féminines » dominées par un ordre du genre qui consacre la supériorité sociale du masculin. C’est ainsi que l’État produit les taxinomies et les hiérarchies intériorisées par ses sujets, y compris lorsqu’ils cherchent à y résister. Et c’est pourquoi les débats autour des réformes, y compris les plus symboliques, comme celle de l’orthographe ou des programmes scolaires, soulèvent de telles passions. Ceci conduit Bourdieu à définir l’État comme le « point de vue géométral de toutes les perspectives », que Leibniz attribuait à Dieu, point de vue investi d’une légitimité suprême qui s’impose aux autres et qui organise les rapports que les alternatives potentielles entretiennent avec lui et entre elles.
Cependant, l’État n’est pas une abstraction. Contre la propension à réifier et unifier a priori cette entité, Pierre Bourdieu invite à une sociologie des institutions et des individus qui font l’État (pour saisir, par exemple, comment et pourquoi l’on désigne les experts qui composent les commissions publiques), ainsi que des luttes qui les opposent (on peut penser, par exemple, aux tensions entre « main gauche » et « main droite » de l’État, ou entre professions désireuses d’affirmer leur compétence sur un domaine) et que les polémiques autour des réformes rendent visibles. Seule une telle approche résout le paradoxe de l’État comme instance qui d’un côté exclut, contraint, censure, de l’autre protège, soutient, compense, corrige. L’État peut ainsi être conçu comme un méta-champ, qui englobe des champs plus ou moins différenciés et plus ou moins dépendants de lui.
Cette approche sociologique ne peut qu’être pleinement historique : la genèse des institutions étatiques permet de saisir ces états antérieurs à la codification de l’officiel, de l’universel, où se sont jouées les luttes entre groupes sociaux pour décider de ce qui est digne d’accéder à l’universel. Le retour historique permet en même temps de rendre compte des « possibles non advenus », déconstruisant ainsi, par l’anamnèse, l’illusion téléologique que ces institutions produisent et reproduisent pour fonder leur existence en nécessité. S’interrogeant sur la genèse du discours public, Pierre Bourdieu met en avant le rôle des juristes, et en particulier des premiers qui ne tiraient pas encore leur légitimité de l’État, tel que le prophète juridique, dont la légitimité charismatique, pour reprendre le concept webérien, repose sur le travail poétique de mise en forme de son discours, sans lequel il risque à tout moment
9
Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau – Penser l'état
de tomber dans le discrédit ; ou encore les législateurs-poètes tels les canonistes anglais du XIIe siècle étudiés par l’historien Ernst Kantorowicz, et qui furent les premiers à produire une théorie de l’État. L’étude de ces individus enseigne que, « pour que la prophétie juridique fonctionne, il faut qu’elle soit auto-légitimante », rappelant que « l’État est la fictio juris qui fonde tous les actes de la création juridique ». La sociologie de l’État doit aussi prendre pour objet les actions les plus quotidiennes et triviales qui mettent constamment en œuvre des procédures et des catégories qu’il produit ; on peut par exemple penser à l’achat d’une maison qui implique des formes de pensée et d’action directement déterminées par l’État, comme le révèle la simple observation d’une interaction entre un vendeur et un acquéreur. Mais pour saisir ce désir initial, il faut comprendre comment se forme la volonté d’accéder à la propriété, directement liée aux politiques déployées dans les années 1970.
L’intérêt des Cours ne réside ainsi pas seulement dans son contenu. Il tient à l’approche mise en œuvre et au travail de déconstruction progressive d’une « pensée d’État » pour « penser l’État », par le recours à un modèle génétique destiné à en dégager les logiques de fonctionnement. Cette sociogenèse le conduit à dialo-guer avec de nombreux auteurs, historiens, économistes, politistes ou sociologues : partant de la définition webérienne de l’État comme monopole de la violence phy-sique légitime, il en étend l’action à toute l’activité symbolique, et au principe de la légitimité des institutions consacrées au droit et à l’intérêt public « qui se donne pour loi officielle l’obligation de désintéressement ». La perspective historique des Cours s’éclaire en fonction de trois enquêtes antérieures que Pierre Bourdieu actualise : ses recherches conduites en Kabylie, durant lesquelles s’élabore la notion centrale de capital symbolique ; son enquête sur les stratégies matrimoniales et successorales des paysans béarnais, auquel il se réfère pour comprendre les struc-tures et le fonctionnement de la « maison du roi » et de l’État dynastique ; et enfin les recherches sur la haute fonction publique et la politique française du logement. La tension entre la division du travail de domination et la concentration des capitaux nécessaires pour l’exercer acquiert ainsi une densité sociologique inédite.
Perspectives pluridisciplinaires sur l’État
Participant du programme de recherches empiriques sur l’État, les articles réunis dans la première partie de ce numéro sous le titre « Actions d’État » l’interrogent à travers ses manifestations pratiques afin de délimiter ses contours et d’interroger les dynamiques et les enjeux qui le traversent. Les contributions de Vincent Dubois, Abram de Swaan, Joseph Jurt, Brigitte Gaïti et Didier Fassin mettent en œuvre des angles d’approche et des méthodes différentes, qui ont en commun à la fois de rompre avec une vision abstraite de l’État comme entité mais aussi de décloisonner l’analyse des politiques publiques, qui s’est constituée comme une spécialité à part : sociologie historique, approche comparative, observation ethnographique, analyse des agents
10
Sébastien Roux, Gisèle Sapiro, Christophe Charle et Franck Poupeau – Penser l'état
et des institutions qui font l’État (notamment pour appréhender les politiques publiques). Elles abordent les différentes facettes de l’État, de la fabrique des identités légitimes, selon la définition de Bourdieu, à travers le cas de la formation de l’identité nationale, à l’exercice de la violence physique extrême dans le cas des États extermi-nateurs, en passant par la reproduction d’un ordre social inégalitaire à travers l’action de « forces de l’ordre » (qui agit en parallèle au système d’enseignement).
Dans la deuxième partie du numéro, des spécialistes de différents horizons ont été invités à commenter les Cours au Collège de France à partir de leur perspective disciplinaire (histoire, science politique, sociologie), de leur période et aire de prédi-lection, ainsi que de leurs propres interrogations. Ceux des auteurs qui l’ont connu témoignent, chacun à sa manière, d’une rencontre intellectuelle autant qu’humaine avec Pierre Bourdieu. Leurs mots ou leurs souvenirs donnent chair à une pensée et réinscrivent les cours dans leur oralité, si présente à la lecture de l’ouvrage ; les Cours au Collège sont en effet la retranscription d’instants où la pensée s’affine, se cherche parfois, hésite, tâtonne, mais parvient in fine à retracer les contours de l’État et, sans jamais abandonner la rigueur scientifique d’une démonstration, à proposer au(x) public(s) et aux auditeurs une grille d’intelligibilité nouvelle, sur un ton vif et souvent malicieux. Les contributions de Pierre-Étienne Will, Jean-Philippe Genet, Christophe Charle et George Steinmetz confrontent leurs propres travaux et objets aux outils, méthodes, concepts et propositions de Pierre Bourdieu. On pourrait objecter, à juste titre, qu’il conviendrait ici d’appliquer l’un des principes fondamentaux de l’approche sociologique : soumettre à l’analyse les propriétés sociales des dialoguants pour penser, au-delà des mots, les conditions qui rendent possibles les débats et les déterminent. Comment être aveugle aujourd’hui au sexe, à l’âge, à la couleur et/ou à la position des interlocuteurs – et, à travers eux, aux positions spécifiques qui influent nécessairement sur les interprétations et les prises de position ? Cet exercice de réflexivité n’appelle pas à disqualifier des propos – et encore moins ceux qui les tiennent – au motif qu’ils refléteraient un entre-soi aveugle à la diversité des approches et des intérêts. Pour autant, elle rappelle qu’un débat est aussi le produit d’un moment, et qu’une histoire critique des lectures critiques reste encore à conduire, pour penser – y compris à travers ces formes les plus amicales – les effets d’occultation qu’induisent les positions. Surtout cette exigence de réflexivité rappelle combien cette dernière se doit d’être une entreprise collective : un travail de correction et de réflexion à partir de propositions théoriques toujours en partie inadéquates si l’on ne les confronte pas à la culture multiple de chercheurs venus d’horizons, de pays et de sciences différentes – une culture sans laquelle l’État sera toujours un objet trop grand pour qu’un individu isolé, même puissamment armé théoriquement, parvienne à en rendre compte complètement.
13ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 13-25
L’action de l’État, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux
Vincent Dubois
1. Cet article s’appuie sur une commu-nication présentée au colloque « Utiliser la théorie des champs pour comprendre le monde social », le 20 mars 2009 à l’Université catholique de Louvain. La publi-cation d’une version complète du texte est prévue dans un ouvrage collectif issu de ce
colloque : Vincent Dubois, "Policy fields", in Mathieu Hilgers et Éric Mangez, Field Theory, Londres, Routledge, à paraître en 2014.2. Voir par exemple Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Dic-tionnaire des politiques publiques, Paris,
Presses de Sciences Po, 2010.3. Marcel Mauss, « Divisions et proportions des divisions de la sociologie », in Œuvres III, Paris, Minuit, 1969, en particulier p. 239.4. Philippe Bezès et Frédéric Pierru, « État, administration et politiques publiques : les dé-liaisons dangereuses », Gouvernement
et action publique, 1(2), 2012, p. 41-87.5. Stephen Skowronek, “taking stock”, in Lawrence Jacobs et Desmond King (éds), The Unsustainable American State, oxford, oxford University Press, 2009, p. 330-338, cité in P. Bezès et F. Pierru, « État, adminis-tration et politiques publiques… », art. cit.
Ce qu’il est convenu d’appeler les « politiques publiques » est devenu un domaine de recherche à part entière, à la faveur d’un processus de spécialisation engagé dès l’entre-deux-guerres aux États-Unis, où il s’est ensuite fortement renforcé, avant d’être très large-ment diffusé sur le plan international1. S’il a suscité d’innombrables travaux dont il ne s’agit pas ici d’établir un bilan, ce processus a aussi entraîné des obstacles à la connaissance sociologique, dont l’identification forme le point de départ de cet article. Sans même parler des possibles biais normatifs et prescriptifs des policy sciences, dont l’orientation appliquée d’auxiliaire de la pratique gouvernementale a pu et peut encore marquer une partie des recherches, la constitution de l’ana-lyse des politiques publiques en spécialité académique s’est accompagnée de la formation d’un lexique spéci-fique, au détriment de l’usage des catégories éprouvées de la sociologie. L’incrémentalisme disjoint, les coali-tions de cause, la dépendance au sentier, le référentiel global-sectoriel, la gouvernance multiniveau ou les paradigmes de politiques publiques sont quelques exemples de ces notions, le plus souvent fort éloignées d’un cadre d’analyse sociologique2. Cette tendance à l’isolement conceptuel a pour double conséquence
une faible mobilisation des notions génériques de la sociologie, qui pourraient utilement contribuer à la compréhension de l’action publique, et sa constitu-tion en objet d’étude clos sur lui-même, alors que son analyse devrait être conçue comme une contribution à la compréhension des modes de domination, de reproduction et de transformation des sociétés contem-poraines – suivant en cela l’invitation de Marcel Mauss à faire de l’étude de « l’art politique » une composante de la sociologie générale3. Plus précisément, le proces-sus de spécialisation à la faveur duquel s’est développée l’analyse des politiques publiques l’a constituée en un domaine séparé de l’analyse de l’État et de celle de l’administration4. Ce découpage est l’origine des limites et de l’« essoufflement » maintes fois constaté de l’analyse des politiques publiques. La distinction très largement artificielle de ces trois sous-disciplines, qui dialoguent curieusement assez peu, conduit à envisager isolément ce qu’il faudrait précisément articuler pour rendre compte tant de ce que sont les États contemporains – qui se définissent précisément par les politiques qu’ils produisent (policy states5) – que du rôle des administrations publiques en tant qu’objectivation institutionnelle de l’État ou opérateurs
14
Vincent Dubois
6. Ces points sont plus largement déve-loppés in V. Dubois, "Policy fields", op. cit.7. Voir par exemple Meghan M. Duffy, amy J. Binder et John D. Skrentny, “Elite status and social change: using field analysis to explain policy formation and implementation”, Social Problems, 57(1), 2010, p. 49-73.8. Bob Lingard et Shaun Rawolle, “Media-tizing educational policy: the journalis-tic field, science policy, and cross-field effects”, Journal of Education Policy, 19(3), 2004, p. 361-380 ; Bob Lingard, Shaun Rawolle et Sandra taylor, “Global-izing policy sociology in education: work-
ing with Bourdieu”, Journal of Education Policy, 20(6), 2005, p. 759-777 ; Shaun Rawolle et Bob Lingard, “the sociology of Pierre Bourdieu and researching educa-tion policy”, Journal of Education Policy, 23(6), 2008, p. 729-741.9. C’est ce que notent Éric Mangez et Mathieu Hilgers, “the field of knowledge and the policy field in education: PISa and the production of knowledge for policy”, European Educational Research Journal, 11(2), 2012, p. 189, dans un article qui offre un rare exemple d’une mobilisation conséquente de cette théorie. Voir aussi, toujours sur les politiques scolaires, la
recherche récente de Pierre Clément, « Réformer les programmes pour changer l’école ? Une sociologie historique du champ du pouvoir scolaire », thèse de sociologie, amiens, Université de Picardie Jules Verne, 2013.10. Pierre Bourdieu, « Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucra-tique », Actes de la recherche en sciences sociales, 96-97, mars 1993, p. 49-62.11. Pierre Bourdieu, Sur l’état. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, coll. « Cours et travaux », 2012.12. thomas Medvetz, « Les think tanks
aux États-Unis. L’émergence d’un sous-espace de production des savoirs », Actes de la recherche en sciences sociales, 176-177, mars 2009, p. 82-93.13. Je développe ce point in Vincent Dubois, « L’État, l’action publique et la sociologie des champs », Revue suisse de science politique, 20(1), 2014.14. Pierre Bourdieu et Rosine Christin, « La construction du marché. Le champ administrat i f et la production de la “politique du logement” », Actes de la recherche en sciences sociales, 81-82, mars 1990, p. 65-85.
de la conduite des politiques, et, précisément, des politiques elles-mêmes, qui n’existent pas plus en dehors des struc-tures (notamment étatiques) dans lesquelles elles sont produites que séparément des pratiques (notamment administratives) qui les réalisent.
La proposition de cet article programmatique consiste à considérer la théorie des champs telle qu’elle a été formulée par Pierre Bourdieu comme un moyen permettant de dépasser ces deux obstacles, et, partant, de contribuer à construire les politiques d’État (et plus largement l’action publique) comme un objet à part entière de l’analyse sociologique. Le concept de champ permet tout d’abord d’éviter les limites des notions les plus fréquemment mobilisées par l’analyse des politiques publiques pour rendre compte des relations entre acteurs engagés dans leur production (réseau, communauté de politique publique, coalition de cause, etc.), qui, selon le cas, engagent un implicite normatif, demeurent essentiellement descriptives, ou ne s’intègrent pas dans un cadre explicatif d’ensemble6. Grâce à son caractère transposable, et au mode de pensée relationnel qui le sous-tend, le concept de champ peut également aider à penser ensemble ce que la division du travail scientifique de l’analyse standard tend à séparer : la structure et le fonctionnement du champ bureaucratique, les systèmes de relations constitutifs de l’État et de son pouvoir, et les politiques publiques définies comme pratiques et prises de position au sein de ces structures relationnelles.
Ces premières propositions sont plus originales qu’elles peuvent le paraître de prime abord. La sociologie des champs est en effet à peu près totalement ignorée dans les travaux qui se réclament de l’analyse des politiques publiques, en France comme ailleurs. Outre des usages ponctuels, et non spécifiquement liés à la théorie de Pierre Bourdieu7, les rares références figurent essentiellement dans des travaux sur les politiques éducatives8. Encore demeurent-elles assez superficielles, et sont loin de tirer toutes les consé-quences analytiques et méthodologiques de la théorie des champs9. Le concept de champ peut pourtant être utilisé de plusieurs manières pour rendre compte
de la structure des relations au sein desquelles se dessinent les politiques, et partant comprendre leurs orientations, leurs enjeux, et certains de leurs effets. On en retiendra cinq principales.
En premier lieu, la notion de champ bureaucratique permet d’analyser la formation, la structure et le fonctionnement d’un espace de positions spécifique à l’État et qui spécifie l’État en tant que tel10. Elle permet ce faisant de saisir l’accomplissement de ces « actes d’État » que sont les politiques étatiques, et de comprendre les ressorts de leur force propre, comme la « magie d’État » qui s’opère dans et par la mobili-sation ces catégories juridiques et, plus largement, officielles, pour décrire le monde social et prescrire son organisation11. En second lieu, on peut mobiliser le concept de champ pour analyser tel ou tel espace de positions et de relations spécifiques qui s’avère jouer un rôle déterminant dans la formulation des politiques publiques. Thomas Medvetz montre ainsi à partir des think tanks américains comment la formation d’un sous-espace distinct de production intellectuelle a contribué à structurer le débat public aux États-Unis, dessinant l’espace du politiquement pensable et possible, et orientant ce faisant les options gouver-nementales12. En troisième lieu, ce concept peut servir à objectiver l’espace de production d’une politique spécifique, dont l’enjeu est le pouvoir de régler une sphère particulière de pratiques (immigration, logement, éducation, santé, etc.), par la mobilisation de ressources (financières, juridiques, administra-tives, etc.) propres à une institution publique ou liée aux pouvoirs publics13. Il s’agit alors de considérer une politique comme l’objectivation d’un état provisoire du rapport de forces au sein du champ de luttes pour sa définition légitime. Pierre Bourdieu et Rosine Christin en donnent un exemple à propos de la politique du logement, dont ils expliquent la réforme en la rapportant aux alliances entre fractions « modernisatrices » qui conduisent à reléguer au second plan les agents anciennement dominants dans ce secteur et, avec eux, les orientations dont ils étaient porteurs14. Une quatrième
15
L’action de l’état, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux
15. Didier Georgakakis (dir.), Le Champ de l’Eurocratie. Une sociologie politique du personnel de l’UE, Paris, Economica, 2012.16. Voir P. Bourdieu et R. Christin, « La
construction du marché… », art. cit., et V. Dubois, « L’État, l’action publique et la sociologie des champs », art. cit. 17. Vincent Dubois, « Le ministère des
arts (1881-1882) ou l’institutionnalisation manquée d’une politique artistique répu-blicaine », Sociétés & Représentations, 11, 2001, p. 229-261.
18. Vincent Dubois, La Politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, Paris, Belin, 2012 [1re éd. 1999].
manière de mobiliser le concept de champ pour analyser le système de positions au sein duquel s’engendrent les politiques consiste à l’employer pour établir la structure d’un espace institutionnalisé de relations de pouvoir politique, à l’instar de ce que propose Didier Georgakakis en étudiant les structures relation-nelles réputées complexes sinon opaques de l’Union européenne comme le « champ de l’Eurocratie », doté de ses propres règles et enjeux, identifiables et analy-sables sociologiquement15. Enfin, la sociologie des champs invite à rendre compte non seulement d’espaces sociaux spécifiques constitutifs de l’action publique mais aussi, plus largement, de relations entre espaces sociaux distincts en tant que l’action publique est fondée socialement sur ces relations et contribue en retour à les structurer. Elle permet ce faisant de saisir les fondements et la portée des rapports de domination et de légitimation qui définissent l’intervention des pouvoirs publics, réinscrivant son analyse dans une perspec-tive de sociologie générale que les travaux spécialisés de l’analyse des politiques publiques perdent souvent de vue. C’est ce cinquième niveau d’une analyse en termes de champ que l’on se propose de développer ici.
L’action publique comme produit des relations entre champs
Comme tout objet social, l’action publique doit s’analyser comme le produit de relations sociales. En l’occurrence, la multiplicité de ces relations et la diversité des positions des agents qui y sont engagés sont telles qu’elles peuvent difficilement être circonscrites à un champ unique. Si on gagne à restituer grâce à la sociologie des champs l’espace de production spécifique d’une politique16, cette approche doit donc s’articuler à l’analyse des relations entre les champs ou fractions de champs mobilisés dans la conduite d’une politique. Il s’agit en d’autres termes d’établir des (systèmes de) relations entre des (systèmes de) relations, au-delà d’un usage seulement monographique de la notion de champ.
La forme la plus simple que peuvent prendre ces relations entre systèmes de relations tient aux échanges, collaborations, confrontations, etc., qui s’établissent de manière bilatérale entre la fraction de l’espace gouverne-mental mobilisée dans le traitement public d’un domaine particulier (e.g. les fonctionnaires et agents politiques en charge au moins temporairement d’un dossier ou secteur particulier) et le champ correspondant. Ce qu’on appelle
« politique culturelle » peut dans cette perspective s’analyser comme le produit des rapports entre le champ de la culture et le groupe des agents administratifs et politiques qui, au sein de l’espace gouvernemental, interviennent sur les questions culturelles. L’histoire de la politique culturelle se définit alors comme l’his-toire de ces rapports. Leur reconstitution permet en particulier de comprendre la formation des alliances d’un champ à l’autre, à d’autres moments impossibles, alliances dans lesquelles résident le principe des princi-pales innovations ou réorientations dans ce domaine – quand bien même ces dernières peuvent être reven-diquées par des agents singuliers ou leur être imputées. La première formalisation politique d’une « politique républicaine des arts » en France procède ainsi de la rencontre, à la fin du XIXe siècle, entre des administrateurs réformistes, le milieu composite des « arts industriels » et l’avant-garde du champ artistique facilitée par des agents politiques à la fois novices et multipositionnés et rendue possible par une conjoncture politique propice aux innovations17. L’institutionnalisation des politiques de la culture au sens contemporain du terme correspond à un moment où le champ de la culture est suffisamment établi pour que l’intervention de l’État puisse être perçue comme un soutien et plus comme une ingérence extérieure, et où l’administration centrale se renforce dans une orientation modernisatrice propice à l’ouverture de nouveaux domaines d’intervention. Les collabora-tions qui peuvent alors s’établir fondent socialement le principe de la « démocratisation culturelle » comme mot d’ordre dont la double connotation politique et culturelle dit bien l’origine : un humanisme technocratique repre-nant et neutralisant les velléités politiques des artistes dans un compromis entre agents des champs bureaucra-tique et culturel – bien plus que dans le « génie » prêté au ministre André Malraux, ce qui ne signifie pas que celui-ci n’ait joué aucun rôle dans l’élaboration de ces compromis, puis grâce à eux18. Une telle perspective permet de reformuler sociologiquement la question du rôle de « l’État » dans « la culture » telle qu’elle est naïvement posée dans les débats publics, les essais philosophiques ou juridiques, en orientant la recherche vers l’identification des positions et des relations objectives et historiquement situées en lieu et place d’une spéculation sur les rapports souhaitables entre deux entités abstraites.
Cette perspective peut, au-delà de ce cas précis, s’appliquer à toute politique qui touche au fonctionnement d’un champ constitué comme tel, l’éducation, la science
16
19. Christian topalov, Laboratoires du nou-veau siècle : les nébuleuses réformatrices et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris, Éd. de l’EHESS, 1999.20. Marc olivier Baruch et Philippe Bezès,
« Généalogies de la réforme de l’État », Revue française d’administration publique, 120, 2007, p. 625-633.21. Successivement Frédéric Lebaron, « Chômage, précarité, pauvreté. Quelques
remarques sur la définition sociale des objectifs de politique économique », Regards sociologiques, 21, 2000, p. 67-78, et Vincent Dubois (avec Jean-Matthieu Méon et Emmanuel Pierru), Le Contrôle des
chômeurs, Paris, GSPE/DaRES, ministère du travail, 2006.22. John W. Kingdon, Agendas, Alterna-tives, and Public Policies, Boston, Longman, 2011 [1984].
ou le sport par exemple, y compris lorsque ce champ est lui-même constitué au sein des institutions publiques, comme dans le cas de la justice.
La concordance des champs
Il serait cependant trop simple de considérer qu’une politique ne procède que de la confrontation binaire entre l’espace politico-bureaucratique et le champ directement concerné. C’est là une configuration possible, notamment lorsqu’il s’agit d’une question très spécifique et circonscrite et/ou d’un champ forte-ment clos sur lui-même dont le fonctionnement affecte peu celui des autres champs, comme dans le cas de mesures présentées comme « techniques » et faible-ment publicisées. Cette clôture se retrouve également lorsque le contrôle gouvernemental est tel qu’il conduit à limiter les relations à un face-à-face avec des groupes sélectionnés – ce dont le système corporatiste des régimes autoritaires a pu fournir une illustration. Dans la plupart des cas, la multiplicité des espaces et sous-espaces engagés dans la fabrication d’une politique dessine toutefois un ensemble d’interrelations beaucoup plus complexe.
Il suffit pour s’en convaincre d’observer la manière dont s’opèrent les « réformes » qui se multiplient au point de devenir aujourd’hui le quasi-synonyme de « politiques gouvernementales ». Au moins pour les réformes d’une certaine ampleur, comprendre leur émergence et leurs conditions de réalisation implique non seulement de reconstituer le champ des réformateurs ou « nébuleuse réformatrice19 » mais aussi d’établir l’état des rapports de forces internes des différents champs concernés et les modalités de leur mise en relation. Même une question apparemment technique et interne au champ bureau-cratique comme la réforme de l’État trouve son origine et les logiques de son traitement dans des espaces diffé-rents et grâce à leur mise en relation : la publicisation de la question administrative dans la presse écrite ; sa transformation en enjeu dans la compétition électo-rale ; les investissements intellectuels et littéraires de hauts fonctionnaires dans l’élaboration et la diffusion de thèses réformatrices20.
Le « plan Juppé » de réforme de la Sécurité sociale et le renforcement du contrôle des chômeurs dans le « Plan de cohésion sociale » en France ont été analysés de cette manière21. Ces réformes suscitent d’intenses mobilisa-tions dans les champs politique et bureaucratique. Leurs enjeux économiques et sociaux suscitent celles
du champ du patronat (via ses représentants) et du champ syndical, qui constituent l’espace institutionnalisé des rapports de forces (ce qu’on appelle les « partenaires sociaux ») dans lesquels se débattent et se dessinent pour partie la régulation des relations professionnelles et la gestion de l’État social. Dans un système social et politique où tant la légitimation des réformes gouvernementales que le succès des mobilisations qui tentent de s’y opposer se jouent pour partie dans les médias, il faut y ajouter la contribution propre du champ journalistique. Dans un domaine complexe, et à une époque où la « compétence » – notamment économique – est une ressource politique majeure, il faut enfin prendre en compte l’espace composite de la production d’expertise, à l’interface entre champs bureaucratique et scientifique.
Les pôles dominants de ces différents champs sont, pour des raisons qui peuvent être différentes, favorables à la réforme ou y ont intérêt. À tout le moins comme l’illustre le cas du champ syndical, la logique des relations avec le champ gouvernemental conduit à ce que seules les prises de position en ce sens puissent être entendues, renforçant en retour les positions de ceux qui les expriment dans les rapports de forces internes à ce champ. Les projets de réforme imputés à la « volonté » gouvernementale ne sont ainsi possibles que dans et par la convergence de logiques et d’intérêts (pour partie) spécifiques d’espaces distincts, mais en interrelation. Dans une certaine mesure, ils procèdent de cette convergence dans la mesure où les gouvernants (qui n’en sont du reste pas nécessairement les seuls ou principaux initiateurs) ne les ont intégrés à l’espace des possibles politiques que parce qu’ils savaient pouvoir s’appuyer sur une conjonction favorable.
Cette conjonction ne procède cependant pas du seul hasard ou de la mise en phase quasi spontanée que décrivent les analyses en termes de « fenêtre d’opportunité »22. En lien avec les rapports de forces internes aux différents champs, elle procède des collusions qui peuvent s’établir d’un champ à l’autre et des rapports de forces entre les champs. Que l’on pense par exemple aux relations entre patronat, presse et politique, ou aux échanges entre syndicalistes et experts. Et s’il serait encore une fois trop simple de considérer que ces convergences sont le seul fait d’un gouvernement capable de faire et défaire les positions au sein de chaque champ, cette orchestra-tion pourrait bien malgré tout avoir un chef d’orchestre, pour prendre à rebours la formule célèbre de Bourdieu, dans la mesure où (et seulement dans cette mesure)
Vincent Dubois
17
UNE REPRÉSENtatIoN SaVaNtE. Dans ce modèle classique de la science politique américaine, les politiques sont considérées comme des « outputs », soit les réponses apportées par un « système politique » désincarné à des « demandes » indifférenciées émanant de « l’environnement » social.
UNE REPRÉSENtatIoN tECHNoCRatIQUE. Le modèle de la « rationalisation des choix budgétaires » (RCB), importé des États-Unis en France à la fin des années 1960, décrit la production des politiques comme un système de flux, en même temps qu’il prescrit la maîtrise technique d’un processus de programmation.
L’action de l’état, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux
31 JaNVIER 2014, HôtEL MatIGNoN. Installation du groupe de travail sur la remise à plat de la fiscalité des ménages, constitué de membres du gouvernement, de parlementaires de la majorité et de l'opposition, de représentants des organisations syndicales et de grandes institutions (Banque de France, Conseil d’Etat).
20
La FIGURatIoN BUREaUCRatIQUE des relations sous la forme des organigrammes complexes qui présentent les organisations gouvernementales est subvertie par des artistes qui la reprennent parodiquement pour dénoncer les réseaux de pouvoir, relations d’influences et autres collusions illégitimes d’intérêt.
Vincent Dubois
21
23. P. Bourdieu et R. Christin, « La construction du marché… », art. cit.
le propre du champ du pouvoir politique est sa capacité à agir simultanément dans plusieurs champs, notamment en distribuant des positions de pouvoir à des agents (en les nommant dans une commission, en leur confiant une mission, en les désignant comme interlocuteurs privilégiés, etc.), ce qui permet d’exercer un pouvoir sur les équilibres internes des champs auxquels ils appartiennent.
Paradoxes et remises en cause de l’autonomisation des champs
L’approche structurale et relationnelle de la sociologie des champs permet de rendre compte de la spécification d’espaces dotés de leurs propres logiques de fonction-nement (les champs bureaucratique ou scientifique) et de restituer les relations qu’ils entretiennent d’une manière réaliste, c’est-à-dire à partir de systèmes de positions objectives et donc en évitant les abstrac-tions réifiantes qui mettent en rapport des concepts (« État » vs « société civile »). Son usage pour analyser l’action publique permet en retour d’éclairer les liens entre les dynamiques socio-historiques d’autonomi-sation des espaces sociaux et les transformations des modes d’exercice et de légitimation du pouvoir politique. On peut formuler à leur propos des hypothèses en partie contre-intuitives : le pouvoir politique ne s’exerce pas nécessairement au détriment de l’autonomie des champs sociaux ; cette autonomie ne constitue en retour pas nécessairement un obstacle à l’exercice de ce pouvoir dont elle peut au contraire servir la légitimation.
L’intervention publique dans un champ conduit en première analyse à agir de l’extérieur sur son fonction-nement et, partant, à réduire l’autonomie qui le constitue comme tel voire à la remettre en cause. Le cas limite en est donné dans les régimes dictatoriaux où toutes les sphères d’activité sont peu ou prou soumises aux règles de l’appareil politico-bureaucratique – à l’instar du modèle jdanovien de politique scientifique – au point de rendre délicate l’usage de la notion de champ. Au-delà de ce cas limite, l’intervention publique comme toute intervention extérieure (celles de l’Église ou du pouvoir économique) fait courir au champ qu’elle concerne le risque de se voir imposer des logiques hétéronomes, sauf à considérer cette intervention comme un soutien neutre ne faisant qu’enregistrer l’état de ses rapports de forces internes – ce cas de figure est possible mais ne peut à l’évidence être généralisé. L’histoire des politiques publiques est de fait jalonnée d’exemples où elles jouent un rôle décisif dans l’évolution de ces rapports, ce qui ne manque pas d’être dénoncé comme une ingérence politique inacceptable par ceux qui en font les frais.
Dans les démocraties libérales contemporaines, s’ensuit plus généralement la soumission – au moins partielle – de la régulation publique des rapports sociaux au respect – au moins formel – du principe d’auto-organisation des espaces sociaux différenciés. C’est sans doute là un élément central de la définition sociologique de ces régimes. L’extension, encore une fois partiellement réalisée et jamais définitivement acquise, du principe de séparation des pouvoirs aux champs qui sont parvenus à imposer leur autonomie comme une norme sociale devant être respectée (la « liberté » de l’artiste ou de l’entrepreneur, l’« indépen-dance » du journaliste ou du scientifique, la spécificité irréductible des règles devant régir l’activité sportive ou médicale) marque la double histoire de ces régimes politiques et de la différenciation des sociétés dans lesquelles ils se sont développés. Cette extension marque aussi les conditions et les formes de l’inter-vention des pouvoirs publics – ne serait-ce que parce qu’ils doivent de ce fait tout particulièrement « mettre les formes », en respectant des procédures formelles et/ou en mobilisant toutes les technologies de pouvoir qui permettent de distinguer cette intervention du « fait du prince ». C’est ce qui permet de comprendre par exemple que si les démocraties occidentales ont créé des ministères des Sports et que leurs dirigeants assistent régulièrement aux rencontres sportives auxquelles participe l’équipe nationale, il leur est à proprement parler impensable d’intervenir comme l’a fait lors de la Coupe du monde de football en 1982 le frère de l’émir du Koweit, descendu sur le terrain pour faire annuler un but accordé par l’arbitre.
L’analyse historique de la genèse des champs permet d’appréhender l’intervention publique sous un autre angle que celui de la réduction potentielle ou avérée de leur autonomie. Contre l’image spontanée de champs préexistants dans lesquels les pouvoirs publics interviendraient dans un second temps, cette analyse associée à celle de la formation historique de l’État révèle un processus bien souvent conjoint. Pierre Bourdieu, entre autres, a montré les limites de l’opposition entre l’État et le marché, qui fonde la dénonciation politique de l’intervention publique comme un dirigisme illégitime, en rappelant ce que la formation historique du champ économique devait à l’État, via notamment l’unification monétaire qui conditionne l’apparition d’un marché national23. Les académies nationales, créées sous l’égide de l’État et dénoncées ultérieurement comme l’instrument de son ingérence dans les champs littéraire et artistique ont constitué parmi les premières instances de débats, d’organisation et de consécration spécifiques à la littérature et à l’art,
L’action de l’état, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux
Luptate ex eum ex
L’ExPRESSIoN aRtIStIQUE des conceptions de l’art de gouverner dans la philosophie médiévale. Bien gouverner, c’est réaliser l’équilibre entre les vertus et les groupes sociaux qui les incarnent, de manière à garantir la stabilité d’une cité harmonieuse.
24
24. alain Viala, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature a l’âge clas-sique, Paris, Minuit, coll. « Le sens com-mun », 1985.25. Jacques Defrance, « L’autonomisation du champ sportif, 1890-1970 », Sociologie et sociétés, 27(1), 1995, p. 15-31.26. Il faudrait pouvoir établir systémati-quement l’ensemble des conditions néces-saires à ce que l’intervention publique
favorise l’autonomie des champs, ce qui dépasse les possibilités de cet article.27. Frédéric Pierru, Hippocrate malade de ses réformes, Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant, coll. « Savoir/agir », 2007 ; Nicolas Belorgey, L’Hôpital sous pression. Enquête sur le « nouveau management public », Paris, La Décou-verte, coll. « textes à l’appui/enquêtes de terrain », 2010.
28. Isabelle Bruno, À vos marques®, prêts... cherchez ! La stratégie euro-péenne de Lisbonne, vers un marché de la recherche, Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant, 2008 ; Franz Schultheis, Marta Roca i Escoda et Paul-Frantz Cousin (dir.), Le Cauchemar de Humboldt. Les réformes de l’enseignement supérieur européen, Paris, Raisons d’agir, coll. « Cours et travaux », 2008.
29. andy Smith, « Comment le néolibé-ralisme gagne sur le territoire. À propos de certaines transformations récentes du rugby », Politix, 50, 2000, p. 73-92.30. Vincent Dubois, Clément Bastien, audrey Freyermuth et Kévin Matz, Le Politique, l’artiste et le gestionnaire. (Re)configurations locales et (dé)politisation de la culture, Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant, 2012.
et en cela formé des bases déterminantes dans l’initiation de leur processus d’autonomisation24. Le développement de politiques sportives dans les années 1960 en France, à une période d’intervention-nisme public fort et centralisé, a quant à lui fortement contribué à l’autonomisation du champ sportif sous ses formes contemporaines25.
Pour s’en tenir à la période récente, on peut poser que pendant une cinquantaine d’années – grosso modo de l’entre-deux-guerres au milieu des années 1970, et de façons variables d’un pays à l’autre et d’un champ à l’autre – quand se structurent les modalités contem-poraines de l’intervention publique, cette intervention forme une contribution paradoxale à la constitution ou à la préservation de l’autonomie des champs. Elle contribue à cette autonomie, parce que la structuration politico-bureaucratique entérine la différenciation des champs et y contribue, reproduisant dans les structures institu-tionnelles (comme les ministères sectoriels) la distinc-tion des différents champs (sport, science, santé, culture). Elle y contribue également parce qu’elle est généralement au moins en partie conduite au nom de la défense des logiques propres à ces différents champs, notamment contre les risques de domina-tion des logiques hétéronomes du champ économique. Les politiques culturelles des années 1960 sont menées au nom du principe d’une création artistique ne devant pas être soumise aux lois de la rentabilité financière, et d’une démocratisation de l’accès à l’art véritable, suppo-sée impossible à réaliser par le seul libre jeu du marché, voire contrariée par la domination des produits de la « culture de masse » imposés par les « industries culturelles ». Et l’on pourrait transposer la remarque à nombre d’autres politiques sectorielles26.
Cette contribution de l’intervention publique à l’autonomisation est dans le même temps paradoxale, dans la mesure où l’autonomie des champs est à la fois conquise en partie contre l’État et octroyée par l’État. Et en même temps que l’État contribue à l’autono-misation d’un champ, son intervention s’accompagne de l’imposition de principes hétéronomes (i.e. propres aux champs politique et bureaucratique) ou de la forma-tion de principes et croyances hybrides, produits dans les transactions entre un champ et les champs politique et bureaucratique. La croyance dans le progrès économique
grâce à la science, l’intégration sociale par le sport, la démocratisation de la culture, les principes de la santé publique ou de l’égalité des chances scolaires forment ainsi des normes élaborées dans ces relations entre champs à l’occasion du développement de l’intervention publique, pour parties réappropriées au sein de chacun des champs concernés.
À rebours de cette contribution paradoxale à leur autonomie, ce qu’on appelle de manière trop rapide et en partie abusive le retrait de l’État – qui consiste plutôt en un tournant néo-libéral des politiques publiques s’accompagnant parfois d’un retour à des formes et des forces traditionnelles de l’État, en matière de sécurité par exemple – a très largement consisté à imposer les logiques du champ économique aux autres champs. On peut le voir en matière de santé avec les réformes managériales de l’hôpital27, dans l’enseigne-ment supérieur et la recherche28, le sport29 ou encore la culture via la promotion du mécénat d’entreprise ou la soumission croissante des activités culturelles à des impératifs de développement économique sur le plan local comme dans les programmes culturels de l’Union européenne30. Le redéploiement de l’inter-vention publique conduit cette fois plutôt à l’hétérono-misation des différents champs sociaux. Le paradoxe précédemment identifié peut alors être poussé jusqu’au bout puisque c’est, contrairement aux représenta-tions communes, l’« interventionnisme » qui, sous certaines conditions, favorise l’autonomie des champs, et le « libéralisme » qui œuvre en sens contraire.
allongement des circuits de légitimation et complexification des rapports de domination
La question de savoir si l’action publique est produite dans des relations bilatérales entre deux espaces de positions (champ gouvernemental et champ spécifi-quement concerné) ou résulte d’un système d’interdé-pendance plus complexe qui engage plusieurs champs, sous-champs ou fractions de champs est moins théorique qu’empirique. Les situations varient en effet selon les cas et les configurations historiques. On peut cependant faire l’hypothèse d’une tendance de long terme à la multiplication et la diversification des interrelations
Vincent Dubois
25
31. Pierre Bourdieu, La Noblesse d’état. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1989, p. 548-559.32. Pierre-Édouard Weill, « La maison à
100 000 euros : une “affaire” d’État », mémoire de master en sciences sociales du politique, Strasbourg, IEP de Strasbourg, 2007.33. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., notamment p. 47-50.
34. Pierre Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, 64, septembre 1986, p. 3-19.35. P. Bourdieu, « Esprits d’État… », art. cit.,
et P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit.36. P. Bezès et F. Pierru, « État, adminis-tration et politiques publiques », art. cit., et P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit.
dans la conduite de l’action publique, correspondant à l’allongement des circuits de légitimation lui-même associé à la complexification des rapports de domination dans les sociétés contemporaines31.
L’intervention d’agents multiples constitue dans cette perspective une condition nécessaire à la légitimation d’une décision publique difficilement envisageable sur la seule base de la légitimité politique de celui qui l’endosse. On le voit notamment dans les mécanismes de délégation du jugement. Qu’un gouvernement constitue un « comité de sages » pour éclairer des décisions à dimension éthique, des commissions pour choisir un architecte ou un artiste à qui commander une œuvre, ou encore un groupe d’experts pour trancher une controverse environnementale tient à la difficulté qu’il y a en ces matières à assumer politiquement un choix, moins du fait de la complexité intrinsèque des problèmes que parce qu’ils touchent à des champs de lutte pour la définition et la détention de la compé-tence légitime nécessaire à leur traitement. Un dispositif tel que les « maisons à 100 000 euros » dites « maisons Borloo » procède certes de l’initiative et de la mise en scène personnelles d’un ministre ; son (relatif) succès politique tient cependant à la production d’un consensus qui n’est rendu possible que par la (relative) convergence d’agents et de groupes aux positions très différentes (élus locaux de différents bords, constructeurs, bailleurs sociaux, journalistes, etc.) autour de l’accession à la propriété comme idéal et comme moyen de résolution des problèmes sociaux et urbains32.
Cette intervention d’agents aux positions multiples, c’est-à-dire situés dans des espaces sociaux différents, conduit moins à la dilution de l’exercice du pouvoir politique qu’elle ne constitue une condition et une modalité de sa légitimation. C’est par la démonstra-tion de leur capacité à s’entourer des « personnalités compétentes » et à « organiser le dialogue le plus large possible » que les gouvernants démontrent leur aptitude à gouverner et leur légitimité à le faire.
C’est là entre autres une des fonctions des commissions étatiques33. Les agents désignés ès qualités ou qui interviennent à divers titres dans la fabrication d’une politique sont des auxiliaires d’autant plus efficaces du pouvoir politique qu’ils n’apparaissent pas comme tels mais se présentent comme indépendants de lui, c’est-à-dire comme les agents d’un champ doté de règles et de logiques irréductibles à celles des gouvernants. Tout comme l’autonomie du champ juridique permet la traduction neutralisée de rapports de forces sociaux et contribue par là à perpétuer la domination34, l’auto-nomie des champs ne constitue dans cette perspective pas seulement une contrainte limitant les velléités inter-ventionnistes ; c’est aussi une ressource pour l’exercice du pouvoir politique et sa légitimation.
On peut ainsi envisager sociologiquement l’action publique comme un mode politiquement légitimé de régulation des rapports entre champs, favorisant ou non leur autonomie, corrigeant ou non leurs relations de subordination. À condition toutefois de ne pas voir dans cette régulation une forme de pilotage centralisé, mais de l’analyser comme le produit de rapports de forces, entre ces champs, et entre chacun d’eux et le champ de production des politiques. En cela la sociologie de l’action publique rejoint la sociologie de l’État considéré comme un « méta-champ » dont le pouvoir s’exerce grâce à l’accumulation des ressources disponibles dans les différents champs, lui permettant en retour d’y intervenir35. Tout comme cette analyse permet d’éviter une vision simplificatrice des rapports entre l’intervention publique et l’auto-nomie des champs sociaux, elle permet d’envisager la question classique de l’autonomie de l’État et de son action d’une manière moins univoque et théorique que dans les débats entre les approches marxiste, plura-liste et néo-institutionnaliste36, au profit de la mise au jour des pratiques et relations objectives fondant le système d’interdépendance généralisé qui caractérise les sociétés occidentales contemporaines.
L’action de l’état, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux
26
Abram de Swaan
MUR DU GHEtto de Varsovie en juin 1942.
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
27ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 26-43
1. Voir abram de Swaan, « La dyscivilisa-tion, l’extermination de masse et l’État », in Yves Bonny, Jean-Manuel de Queiroz et Erik Neveu (dir.), Norbert élias et la théorie de la civilisation. Lectures et critiques, Rennes, PUR, 2003, p. 63-74.2. Charles tilly, Coercion, Capital, and Euro-
pean States, AD 990-1990, oxford/Cam-bridge (Ma), Basil Blackwell, 1990, p. 20-28.3. C’est ce que Norbert Elias appelle « la contrainte sociale à l’autocontrainte ». Employer le terme « régulation » de préfé-rence à « contrainte » permet de nuancer. L’enjeu ne réside pas seulement dans la
maîtrise d’un comportement impulsif (comme l’agressivité) ; il s’agit aussi de surmonter cer-tains penchants, souvent aussi impulsifs, qui inhibent l’action (comme la peur ou la pitié).4. Robert Muchembled, Une histoire de la violence. De la fin du Moyen Âge a nos jours, Paris, Seuil, coll. « L’univers
historique », 2008 ; Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature. Why Violence has declined, New York, Viking, 2011 ; Sophie Body-Gendrot et Pieter Spie-renburg (éds), Violence in Europe. His-torical and Contemporary Perspectives, New York, Springer, 2009.
Tout au long de l’histoire humaine, des groupes d’hommes en armes ont semé la mort. Ils n’ont pas seulement tué des ennemis organisés et armés au cours de batailles. Dans des proportions plus grandes encore, ils ont tué des hommes, des femmes et des enfants non organisés et non armés, incapables de se défendre contre leur violence. L’extermination de masse n’a, hélas, rien d’exceptionnel. Elle s’est répétée au cours du temps, le plus souvent durant des guerres, des guerres civiles et des insurrections, ou à leur suite. Les temps modernes ont certainement limité la fréquence de ces événements, mais leur ampleur s’est accrue. La clef pour saisir cette évolution de l’extermination de masse réside dans l’émergence des États, ou – plus précisé-ment – dans un système d’États. Le processus de sépara-tion entre le « peuple du régime » et le « groupe ciblé » par le régime à tous les niveaux (culturel, institutionnel, interactionnel et mental) constitue l’une des principales conditions de réalisation d’une extermination de masse1. Quatre modes d’extermination de masse sont présentées en fin d’article. Chacun relève de circonstances macro-sociologiques différentes et s’accompagne de formes de compartimentation distinctes.
Formation des États et régimes génocidaires
Les États sont progressivement parvenus à monopoliser l’usage de la violence sur leur territoire ; ce faisant, ils ont accumulé une capacité de destruction supérieure
à toute autre institution, à l’exception des États rivaux. Dans chaque territoire, cette monopolisation de la violence a favorisé la pacification, après que les États ont successivement défait leurs concurrents intérieurs. Dans le même temps, les États – ces monopolistes de la violence – menaçaient le monopole de leurs États rivaux. Comme l’écrit Charles Tilly, à l’époque moderne « les États font la guerre et la guerre fait les États »2, et cette concurrence permanente a favorisé les conflits à grande échelle, d’une violence plus dévastatrice que celle qu’aurait pu causer tout autre type de confrontation.
La monopolisation intérieure de la violence par l’État a produit les conditions nécessaires au processus de civilisation décrits par Norbert Elias. La violence physique s’est peu à peu retirée de la vie quotidienne. Il est devenu inutile de maintenir une vigilance constante pour se protéger d’attaques éventuelles, et bien plus coûteux – notamment pour les jeunes hommes – de se battre, de blesser ou de tuer. L’habileté au combat a diminué. La plupart des gens ont limité le recours à la violence physique, s’y sont moins préparés, ont vu leur degré de compétence baisser et, à l’inverse, ont amélioré le contrôle de leurs penchants à user de la force. La régulation sociale de l’autorégulation des pulsions violentes s’est accentuée, s’imposant plus large-ment dans la vie d’un nombre croissant d’individus3. Le taux d’homicides a chuté, en particulier dans les sociétés occidentales4. La violence est progressivement devenue affaire de spécialistes, soldats et policiers (et aussi
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
Abram de Swaan
28
5. Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, notamment p. 107-120, 186-200 ; Pierre Bourdieu, Sur l’état. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, coll. « Cours et travaux », 2012,
notamment p. 257-278.6. a. de Swaan, « La dyscivilisation… », op. cit., p. 57.7. D’après Martin Shaw, “the general hybri-dity of war and genocide”, Journal of Geno-cide Research, 9(3), 2007, p. 461-473, si
la ligne de démarcation entre « guerre » et « génocide » est relativement arbitraire, ce n’est pas le cas pour la distinction opérée ici entre « guerre » et « extermination de masse ». Elle est graduelle et dépend du degré d’asymétrie entre les deux camps.
8. À l’inverse, les efforts fournis pour prévenir ou guérir une maladie sont per-çus comme une bataille menée contre des agents pathogènes non humains, voir Susan Sontag, Illness as Metaphor, Harmondsworth, Penguin, 1983.
criminels). Ceux-ci ont eu des armes de plus en plus efficaces à leur disposition, et en quantités toujours plus grandes.
À travers l’exercice continu de ce que Pierre Bourdieu nomme la « violence symbolique »5, ce processus de formation des États est allé de pair avec la trans-formation générale des personnes en citoyens de cet État. L’émergence des États, et en particulier des États-nations, a aussi transformé la connaissance, le jugement et les sentiments que les gens avaient les uns des autres. Les cercles d’identification6 se sont élargis pour couvrir l’ensemble de la nation, toute la population de l’État. De manière similaire, les cercles de dés-identification se sont aussi élargis pour intégrer d’autres nations rivales (saisies dans leur ensemble) ou d’autres groupes consi-dérés comme étrangers bien qu’ils soient situés à l’inté-rieur des frontières de l’État. Lorsque la nation n’était pas le seul dénominateur commun d’identification et de dés-identification, la foi, la race ou la classe ont pu s’y superposer ou la remplacer. Du fait de l’organi-sation sociale des ressentis, les périmètres d’inclusion et d’exclusion, de solidarité et d’hostilité, d’identification et de dés-identification se sont considérablement accrus.
De nombreux épisodes d’extermination de masse se sont produits dans ce contexte, au cours des XIXe et XXe siècles. L’extermination de masse est un type de violence particulier, fortement asymétrique et mené à très grande échelle : des hommes organisés et armés tuent un grand nombre de personnes sans arme et sans coordination, dans un cadre particulier où ils bénéficient d’un appui institutionnel avec, a minima, l’assurance d’une tolérance tacite. Ces violences se produisent plus fréquemment dans des sociétés extrêmement compar-timentées où le groupe-cible se trouve de plus en plus séparé du groupe dominant, à tous les niveaux.
La violence asymétrique de masse se produit le plus souvent en marge de la guerre : au lendemain d’une victoire ou à la veille d’une défaite. En temps de guerre, l’inhibition des comportements violents et impulsifs a tendance à disparaître. Aussi longtemps que les soldats combattent un ennemi plus ou moins symétrique qui tient ses positions, ils n’ont pas d’occasion de se livrer à des massacres gratuits. Cette possibilité ne se présente que lorsqu’ils se retrouvent face à des personnes sans défense, ennemis vaincus ou civils sans armes7. Transformés en brutes par les batailles qu’ils viennent de mener, les soldats auront davantage tendance à infliger des atrocités à ceux qui ne les menacent en rien.
Nombreux sont les combattants mis en rage par ce que l’ennemi vient de leur faire subir, à eux-mêmes ou à leurs compagnons d’armes. Ils peuvent alors chercher à se venger et, bien souvent, toute personne appartenant au peuple ennemi peut en faire les frais. La guerre décivilise. Elle atténue l’empathie, rend capable de rester insensible à la souffrance des autres et permet de l’infliger à son tour, avec calme, voire exultation.
La guerre est la métaphore perpétuellement invoquée à propos de l’extermination de masse, car la guerre ne facilite pas seulement les massacres, elle contribue aussi à les légitimer. Même lorsqu’il n’y a pas de conflit armé, la métaphore de la guerre suffit à justifier l’élimina-tion de l’ennemi, pour la défense de soi, de sa terre et de son pays, et pour protéger les précieux symboles qui sont associés à ce dernier. Ne pas agir contre les autres une bonne fois pour toutes, c’est courir le risque qu’ils frappent les premiers et nous détruisent. Les nations qui ont connu un conflit sanglant à la génération précédente sont plus enclines à reprendre les armes et recourent plus facilement à la violence contre des « adversaires » non armés et non organisés.
Un régime qui mène une campagne génocidaire contre un groupe-cible sans défense – aussi déséqui-librée soit-elle –, la présentera, dans la quasi-totalité des cas, comme une bataille symétrique menée contre des ennemis susceptibles de vaincre s’ils ne sont pas anéantis avant d’en avoir eu l’occasion. Les métaphores de la contagion et de l’infection sont fréquentes : l’adversaire est assimilé à une maladie, un virus ou une bactérie, un parasite ou un insecte qui doit être annihilé avant qu’il ne détruise l’organisme hôte8. L’éradication d’êtres humains est alors assimilée à l’extermination d’organismes pathogènes.
La compartimentation
Il y a un État derrière toutes les exterminations massives. Maintes et maintes fois, les États ont perpétré ou toléré des crimes de masse à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières. Il est possible qu’au fil du temps, la monopoli-sation de la violence par l’État ait fait progresser la civili-sation de la société. Néanmoins, il est aussi arrivé que ce processus prive de protection des catégories entières de citoyens qui, dans certains cas extrêmes, ont été exposées à la violence du monopole de l’État. Le régime a en effet le pouvoir de mobiliser tout son arsenal pour persécuter voire exterminer son groupe-cible
Abram de Swaan
29
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
9. Ervin Staub, “the psychology of bystanders, perpetrators and heroic helpers”, in Leonard S. Newman et Ralph Erber (éds), Understanding Genocide. The Social Psychology of the Holocaust, oxford/New York, oxford University Press, 2002, p. 11-42 et notamment p. 24. 10. Ibid., p. 27, Staub ajoute : les observateurs passifs « encouragent les tortionnaires qui interprètent souvent le silence comme un soutien tacite de leurs politiques ».
et de manière plus systématique encore dans les sociétés où l’appareil d’État n’est pas parvenu à monopoliser totalement les vecteurs de violence.
Les régimes qui ont recours à l’extermination de masse présentent le plus souvent une compartimen-tation avancée, le « peuple du régime » étant séparé du groupe-cible à tous les niveaux et à tous les points de vue. Dans un premier temps, il faut délimiter le groupe-cible ; ses membres doivent être répertoriés ; ils doivent être isolés et faire l’objet d’une campagne continue de dénigrement et de déshumanisation. Le reste dela population est incité à les haïr et à les détester. C’est le travail social de dés-identification. Il consiste à actualiser de vieux préjugés (souvent latents) en activant des stéréotypes, à déshumaniser les personnes-cibles ; il s’agit donc d’un processus actif de dés-identification qui inclut des campagnes de propagande explicite, des provocations, des rituels vexatoires, des humilia-tions publiques et des allégations de manipulation et de conspirations secrètes dont sont tenus respon-sables non seulement les coupables supposés mais le groupe-cible tout entier. Les simulacres de procès staliniens et nazis sont bien sûr les exemples les plus manifestes de ce type de pratiques. Les futures victimes sont présentées comme une menace effective, le peuple du régime comme sa victime potentielle : c’est le régime qui agit en position de légitime défense pour protéger sa population. Dans le même temps, une campagne inverse est menée pour renforcer les identifications positives parmi ceux qui jouissent de la protection du régime, afin qu’ils deviennent « le peuple spéci-fique du régime ». Reste à écrire une théorie capable d’expliquer comment la violence symbolique engendre la violence physique et, inversement, comment la violence symbolique est produite par la violence physique.
Au fur et à mesure que la compartimentation progresse, la population a des opinions de plus en plus tranchées et agressives sur le groupe-cible, tout en se montrant indifférents à ce qu’ils subissent (ils l’auraient d’ailleurs « bien mérité »). Ils lui attribuent alors ces pulsions qu’ils préfèrent ne pas reconnaître en eux-mêmes (une tendance appelée « identification projective ») : luxure, cupidité, soif de pouvoir, fourberie, sinistres desseins contre le peuple du régime et favori-tisme envers les membres de son propre groupe, mais aussi faiblesse, lâcheté, paresse ou saleté.
On juge alors qu’il est préférable de ne pas fréquenter la population-cible et de n’être aperçu avec aucun de ses membres en public comme en privé. Ce comportement, qui peut être motivé par une véritable aversion personnelle,
s’explique aussi par la crainte d’être associés à eux. « Les observateurs aussi apprennent et s’adaptent en conséquence de leur propre action – ou inaction… Pour atténuer leur désarroi empathique et leur culpabilité, les observateurs passifs se distancient des victimes9. ». Il faut les dévaloriser car celles-ci doivent avoir mérité leur sort10. Comme les contacts quotidiens se raréfient, les stéréotypes et la calomnie sont plus difficiles à corriger. Naturellement, parmi le peuple du régime, nombreux sont ceux qui connaissent des personnes de la population-cible qui, le plus souvent, ne correspondent en rien au modèle officiel ; mais ces gens « bien » sont l’exception qui confirme la règle. Ainsi presque chaque personne du groupe-cible est une exception aux yeux d’au moins une personne du peuple du régime.
Ce processus de compartimentation articule un lien étroit entre, d’une part, la doctrine officielle de l’État, la propagande et le rite public et, d’autre part, la percep-tion et le sentiment des individus. En ce sens, il existe de fait une relation très intime entre le régime et ses citoyens.
Par la suite, la compartimentation gagne la sphère « légale » et s’institutionnalise. Les membres du groupe-cible se voient interdire l’entrée des écoles ou des hôpitaux, sont relégués dans des établis-sements « réservés » ou sont exclus de l’éducation et des soins médicaux. Sur l’ordre du gouvernement, ils peuvent aussi être contraints de s’installer dans des zones spéciales (un « ghetto » dans la même ville, des « territoires » ou des « réserves » dans un même pays). Ils ne seront autorisés à utiliser les espaces publics communs qu’à certains moments seulement et seront éventuellement soumis à un couvre-feu particulier. Afin de prévenir tout contact fortuit entre le peuple du régime et le groupe-cible, et pour les humilier encore davantage, les exclus pourront être forcés à porter une marque distinctive, sauf s’il est possible de les identifier d’emblée comme tels (par exemple, en raison de la couleur de leur peau). Tous ces aspects du processus de compartimentation sont très bien résumés par le terme d’apartheid utilisé pour désigner la situation que connaissait autrefois l’Afrique du Sud.
La compartimentation prend une ampleur nouvelle quand la déportation commence. La population ciblée peut, dans un premier temps, être isolée dans des zones spéciales ou envoyée dans des espaces sécurisés (camps d’internement par exemple) afin qu’elle soit regroupée et mieux contrôlée. Des unités spéciales sont chargées de la rassembler, de l’isoler et de la déporter. On oublie vite ce que l’on ne voit plus.
30
11. C’est ce que Stanley Cohen, States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering, Cambridge, Polity, 2001, p. 153, qualifie de « double discours » : l ’équilibre entre la publicisation de la terreur d’État et la dissimulation de ses détails pratiques.12. abram de Swaan, “terror as a govern-mental service”, in Marjo Hoefnagels (éd.),
Repression and Repressive Violence, ams-terdam, Swets & Zeitlinger, 1977, p. 40-50 et notamment p. 44.13. Voir aussi Elçin Kürsat-ahlers, „Über das toten in Genoziden: Ein Bilanz histo-risch-soziologischer Deutungen“, in Peter Gleichmann et thomas Kühne (dir.), Mas-senhaftes Töten. Kriege und Genozide im 20. Jahrhundert, Essen, Klartext, 2004,
p. 180-206 et notamment p. 184.14. Ernst Klee, Willi Dressen et Volker Riess (éds), “The Good Old Days”. The Holocaust as Seen by Its Perpetrators and Bystanders, New York, Konecky & Konecky, 1991, p. 107-137.15. Patrick Desbois, Porteur de mémoires. Sur les traces de la Shoah par balles, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2007 ; timothy
Snyder, Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, New York, Basic Books, 2010.16. Gitta Sereny, Into that Darkness. From Mercy Killing to Mass Murder, New York, McGraw-Hill, 1974, p. 193 [Au fond des ténèbres. De l’euthanasie a l’assassinat de masse : un examen de conscience, Genève, Famot, 1977].17. Ibid., p. 238.
À ce stade, tout est prêt pour l’extermination des victimes désignées. Des zones spéciales peuvent être dissimulées aux yeux des non-initiés pour que la torture et le meurtre soient perpétrés discrètement, sans qu’ils soient toutefois complètement ignorés: secret public, savoir privé. Le peuple du régime soupçonne ce qui se passe et est dûment intimidé ; les gens n’osent pas en parler ouvertement, et encore moins en rejeter publiquement la responsabilité sur le régime11. Ils ont conscience qu’ils risquent d’être punis sans savoir exactement pour quelles raisons et, par peur, se censurent eux-mêmes12.
La violence contre les personnes-cibles est perpétrée dans des lieux d’extermination où des unités spéciales font leur travail. La professionnalisation du meurtre de masse est en soi la marque d’une compartimentation avancée : le régime peut se passer de la participation des civils et protéger sa population de toute confronta-tion avec la destruction de masse. La société allemande sous le régime nazi en est le cas exemplaire : elle était compartimentée à l’extrême, bien plus par exemple que l’Indonésie ou le Rwanda13.
Dans les sociétés qui ont connu une période relativement prolongée de paix intérieure et peu ou pas de guerre avec un pays étranger, il est possible que, pour ces raisons, l’aversion pour la violence, l’incapacité à l’accepter et à la mettre en œuvre se soient accrues. C’est l’hypothèse de base de la théorie d’Elias sur le processus de civilisation. Dans ces conditions, l’exercice brutal et manifeste de la violence contre le groupe-cible provoque l’indignation et le dégoût d’une grande partie de la population, bien qu’elle ne se sente pas directement menacée. Un régime qui se prépare à lancer des actions de persécution, de déporta-tion et de meurtre à grande échelle doit, d’une manière ou d’une autre, préserver sa population d’une compré-hension des souffrances qu’il s’apprête à inf liger en accentuant la compartimentation de la société.
Lorsque commence la véritable campagne d’exter-mination, dans la plupart des cas, la tuerie est perpétrée dans des lieux reculés, isolés, « hinter den Kulissen » (en coulisses) dirait Elias, de façon à épargner la sensibilité du peuple du régime et protéger si possible l’identité des bourreaux pour leur assurer l’impunité. Les deux phases de l’holocauste nazi – l’exécution par balles et l’extermination au gaz – se sont ainsi déroulées
dans des régions isolées de Pologne occidentale et d’Ukraine, loin du centre de l’Allemagne et des pays occupés d’Europe de l’Ouest.
Toutefois, même au cours de ces épisodes d’exter-mination massive, soigneusement compartimentés, ce qui se passait n’est pas resté entièrement secret. Par exemple, les hommes du 101e bataillon de réserve de la police allemande reçurent la visite de leurs femmes qui assistèrent à des exécutions ; des soldats de la Wehrmacht vinrent observer le meurtre de juifs nus alignés et un certain nombre d’entre eux n’hésitèrent pas à y participer14. Nombreux ont été les « bons » villageois à aider à la fouille des victimes pour collecter pièces et bijoux, avant de revenir ensuite pour prélever seuls sur les cadavres tout ce qui pouvait avoir de la valeur15. S’agissant des camps d’extermi-nation, un témoin a par exemple déclaré : « Secret ? Bon sang, il n’y avait pas de secret autour de Treblinka ; tous les Polonais d’ici à Varsovie devaient être au courant, et en tiraient des bénéfices. Tous les paysans venaient faire du troc, les prostituées faisaient affaire avec les Ukrainiens – c’était un vrai cirque pour eux tous16. » Quant au commandant des camps de Treblinka et de Sobibor, Franz Stangl, il a déclaré à Gitta Sereny : « L’ensemble du camp dégageait une puanteur perceptible à des kilomètres à la ronde. Beaucoup disaient qu’ils ne pouvaient plus manger pendant deux semaines après avoir traversé – ou « visité » – le camp. Mais non, ils n’ont rien vu et ne savaient rien, bien sûr…17 »
Malgré tout, les SS ont recouru à des moyens extrêmes pour tenter de garder secrète la destination finale des juifs européens, afin de faciliter les dépor-tations et éviter l’opposition du reste de la population. Lorsqu’il est apparu que la défaite était inévitable, ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour effacer les traces et éviter d’être emprisonnés par les alliés.
Même en supposant une compartimentation extrême, l’extermination de tant de millions de personnes n’a pu ainsi s’accomplir dans un secret total. Et moins la compartimentation est avancée, plus le secret est diffi-cile à protéger. À l’autre extrémité du spectre, on trouve les massacres du Rwanda ou les émeutes meurtrières de la Partition des Indes, au cours desquels les groupes de tueurs rassemblaient des spectateurs pour en faire les témoins et les complices de leurs actes. En un sens, ces provocations et ces cruautés affichées, par leurs rituels
Abram de Swaan
31
18. Voir Uğur Ümit Üngör, The Making of Modern Turkey. Nation and State in Eas-tern Anatola, 1913-1950, oxford/New York, oxford University Press, 2011, p. 70 sq., sur le génocide arménien par les turcs en anatolie orientale ; P. Desbois, Porteur de mémoires…, op. cit., p. 183, sur l’extermi-nation des juifs par les allemands en Ukraine.19. Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des Ter-rors: Das Konzentrationslager, Francfort-sur-le-Main, Fischer Verlag, 1997, p. 104 : „Der Unbeteiligte ist keineswegs ahnungslos. Er
weiss so viel, wie er wissen will. Wass er nicht weiss, das will er nicht wissen. Das aber heisst, dass er sehr wohl genug weiss, um zu wissen dass er nicht mehr wissen will“ (pour la version française: L’Organisation de la terreur, Paris, Calmann-Lévy, 1995, trad. de l’allemand par olivier Mannoni).20. „Er macht sich nicht wissen“, comme me l’a dit le fils d’un survivant citant son père.21. Mark Danner, “america and the Bos-nia genocide”, New York Review of Books, 4, décembre 1997, p. 59.
22. Mark Levene, The Meaning of Geno-cide. Genocide in the Age of the Nation State, vol. I, Londres/New York, I.B. tauris, 2005, p. 121, 124-125 ; Mark Levene, “the changing face of mass murder: massacre, genocide and postgenocide”, International Social Science Journal, 54(174), décembre 2002, p. 443-452 et notamment p. 446, sur les massacres des arméniens : « […] si les tortionnaires peuvent être autori-sés ou habilités à infliger les tortures les plus sauvages, le contexte dans lequel
ils agissent est, à l’inverse, très orga-nisé ». Voir aussi Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Providence/oxford, Berghahn Books, 1995 ; C. Sorabji, “a very modern war: terror and territory in Bosnia-Herce-govina”, in Robert a. Hinde et Helen E. Watson (éds), War: A Cruel Necessity? The Bases of Institutionalized Violence, Londres, I.B. tauris, 1995, p. 80-95.
atroces et pervers perpétrés devant la foule, créaient une compartimentation instantanée : il fallait prendre le parti des tueurs ou risquer à son tour d’être victime.
Dans les situations de compartimentation avancée, le sale boulot est laissé à des spécialistes, généralement des militaires, des membres de milices, de la police, ainsi que quelques médecins ou juristes. Des criminels de droit commun peuvent aussi être mis à contribu-tion, sous réserve qu’ils soient capables d’observer un minimum de discipline et d’obéir à leurs supérieurs. La séparation entre groupe-cible et peuple du régime se poursuit, la « fraternisation » est strictement interdite, aucun secours ne doit être apporté à ceux qui sont arrachés de leurs foyers ; ceux qui céderaient à la tenta-tion de venir en aide aux futures victimes risqueraient de subir un destin similaire. Ceux dont on a constaté qu’ils cachaient des personnes-cibles ou les protégeaient d’une quelconque façon ont pu subir le même sort ou être exécutés sur le champ, comme ce qui s’est produit en Anatolie durant l’extermination des Arméniens18.
Même lorsque le processus de compartimentation est entièrement achevé, dans un sens psychologique et social aussi bien que spatial et temporel, la séparation n’est jamais parfaite et le processus n’est pas néces-sairement entièrement réalisé. Il arrive souvent que les lieux d’exécution soient visibles, voire accessibles, au reste de la population. Même dans ce cas, la compar-ti mentation se poursuit, au moins sur les plans mental et social. Toute interaction avec les victimes est évitée, les gens s’efforcent de ne pas s’identifier à elles et les ignorent autant que possible. D’après Wolfgang Sofsky : « Ceux qui ne s’impliquent pas ne sont pas innocents pour autant. Ils en savent autant qu’ils veulent en savoir. Ce qui signifie qu’ils en savent assez pour savoir qu’ils ne veulent pas en savoir davan-tage19. » En bref, « ils font en sorte de ne pas savoir »20. Dans de nombreux épisodes d’extermination massive, le reste de la société a conservé ses manières policées, et la grande majorité des citoyens ont continué à être protégés par la loi, la coutume et l’étiquette. De la même façon qu’il ne viendrait pas à l’esprit du boucher d’utiliser son couteau hors de son échoppe ou de découper autre chose que de la chair animale, la police et les soldats n’imagineraient pas d’attaquer
qui que ce soit n’appartenant pas à la catégorie désignée, ni de brutaliser leurs victimes en dehors des espaces réservés aux actes d’extermination. On assiste alors à une évidente bureaucratisation de la barbarie. Les actes les plus barbares sont commis, d’une manière détachée ou exaltée, avec passion, luxure et abandon. Mais ils se limitent à des espaces circonscrits, à des épisodes définis, cloisonnés du reste de la société et de l’existence quotidienne des citoyens du régime. La barbarie est compartimentée.
Mark Danner écrit, à partir du récit des témoins du génocide bosniaque : « Western et ses collègues furent choqués non seulement par la cruauté de ces abus mais par leur nature systématique ; ils ont rapidement compris que si les soldats serbes et, en particulier, les troupes “paramilitaires” respon-sables du “nettoyage” commettaient des actes sadiques d’une brutalité extrême sous l’influence de l’alcool, leurs officiers faisaient un usage rationnel et systé-matique de la terreur comme technique de guerre. Viols, exécutions de masse et mutilations n’étaient pas des événements distincts du combat, regrettables mais inévitables, mais une part essentielle…21 »
La sauvagerie et la brutalité ne sont pas seulement tolérées ou insufflées mais aussi instrumentalisées à des fins précises dans des espaces délimités et à des moments déterminés. C’est un archipel d’enclaves où la cruauté, si elle est ailleurs maîtrisée, se développe ici sans entraves22.
Parfois, lorsque la violence est monopolisée par l’État, un certain degré de civilisation est maintenu à presque tous les égards pour une vaste majorité de la population, tandis que parallèlement le régime isole un groupe-cible, le sépare du groupe dominant et, dans les cas extrêmes, crée et entretient des compartiments de destruction et de barbarie, dans une isolation méticuleuse, presque invisible, et dont il est quasiment impossible de parler. C’est un peu comme si le processus de civilisation se poursuivait pour certains tout en prenant un tournant opposé pour d’autres. Dans les compartiments où le groupe-cible est isolé et exterminé, se produit un proces-sus de barbarisation, de décivilisation. Norbert Elias parle alors d’effondrement de la civilisation. Mais il serait plus exact de parler de processus de décivilisation
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
32
De la violence symbolique et physique chez Pierre Bourdieu
Si, plus que tout autre chercheur en sciences sociales, Pierre Bourdieu s’est penché sur ce qu’il nomme la « violence symbolique », il a peu abordé la question de la violence physique. Il ne mentionne qu’à peine la violence de masse et la limite à sa manifestation dans la guerre, lorsqu’elle oppose des parties plus ou moins symétriques. or, à ma connaissance, il n’en traite jamais lorsqu’elle se manifeste sous la forme d’une exterminat-ion de masse, entre deux parties cette fois-ci totalement asymétriques. Certes, on ne peut tenir rigueur à l’auteur d’une œuvre aussi vaste, couvrant autant de domaine des sciences sociales, de l’histoire et de la philosophie, de ne pas avoir abordé un point particulier. Mais pourquoi, malgré l’intérêt qu’il portait à l’État et à son exercice de la violence symbolique, Pierre Bourdieu n’a-t-il pas traité de la destruction physique de masse ?
tout en se plaçant dans la filiation de Max Weber, Norbert Elias et Charles tilly lorsqu’il étudie la socioge-nèse de l’État dans un système d’États, Pierre Bourdieu critique leur approche « économique » qui se concentre principalement sur la monopolisation de la violence et de l’impôt. Certes, il reconnaît que Max Weber porte un intérêt particulier à la « légitimité » de la violence et il apprécie la théorie de Norbert Elias sur le processus de civilisation comme excroissance de la monopolisa-tion effective de la violence par l’État. Sur ces aspects particuliers, ces auteurs ont dépassé les interprétations purement économiques, anticipant l’intérêt de Pierre Bourdieu pour la dimension symbolique de la domination d’État. Mais comme Bourdieu s’était donné comme objectif principal d’explorer la genèse de l’État et de la nation, on peut comprendre qu’il ne soit pas revenu sur la question de la destruction physique, du moins dans ses recherches conduites après son retour d’algérie.
Pourtant, Pierre Bourdieu aurait certainement été le premier à souligner que la violence de masse, comme guerre « symétrique » ou extermination de masse « asymétrique », n’est pas seulement le produit d’un processus physique ou mécanique. Ces deux formes ne peuvent en effet se réaliser que dans un contexte de violence symbolique intense où se crée un corps de professionnels appelés à combattre à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’État. Il faut un important et nécessaire travail symbolique
pour que des recrues obéissent et risquent leur vie sous le feu de l’ennemi (et qu’elles y répondent), et pour transformer des hommes – bien plus que des femmes – en combattants potentiels. De même, pour l’État, convertir les masses populaires en « amis » ou en « ennemis » requiert l’exercice de toute sa capacité de violence symbolique. Le travail social que j’ai désigné sous les termes d’« identification » et de « dés-identification », et qui s’opère en continu au sein et entre les groupes, se nourrit d’une violence symbolique qui trouve son origine au cœur même de l’appareil d’État. Pierre Bourdieu a montré avec justesse comment cette violence symbolique transforme des êtres humains en « citoyens », en « gens simples », en « élites », etc. Il a ainsi créé des outils analytiques qu’il est possible d’utiliser dans un contexte certes différent, mais lié : la définition de certaines personnes comme étant « étrangères » à la commu-nauté (« outsiders »), leur exclusion progressive, leur réduction à un état de « non-personnes », voire de « sous-humains ». tout ceci se produit sous la forme d’une violence symbolique qui s’exacerbe et, à un certain point, peut évoluer vers la violence physique. Mais la stigmatisation voire la destruction des corps est aussi fortement symbolique. Discriminer, expulser, frapper, mutiler, torturer, violer, tuer, tous ces actes sont chargés de sens, même si celui-ci révulse la plupart des individus.
Contrairement à ce qui s’observe avec la violence symbolique « ordinaire », lorsque la violence symbo-lique s’accompagne de destruction physique, on ne note aucune intention ou aucun effort pour obtenir des « dominés » qu’ils acceptent la vision qu’ont d’eux les « dominants » – pour reprendre les termes usités par Pierre, Bourdieu. Une société dominée par les hommes peut, par exemple, imposer aux femmes leurs idées sur la féminité et la masculi-nité ; une société fondée sur la suprématie des Blancs peut imposer aux Noirs une certaine vision de leur infériorité raciale. Mais dans les cas d’extermination de masse, les dominés sont tout simplement éliminés. Il y a « intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux » pour reprendre la formulation de la Convention sur
Abram de Swaan
33
le génocide des Nations Unies. Pour autant, l’extermi-nation de masse comprend encore une dimension de violence symbolique. Elle vise bien sûr les personnes du groupe ciblé qui sont parvenues à survivre. Mais elle concerne aussi – voire surtout – les individus en charge de l’extermination, comme les observa-teurs ou le « front intérieur » (« la population du régime »). Par la négation de la négation, l’extermination de masse permet de transformer symboliquement la population du régime en « purs aryens », en « vrais Hutus » ou en « véritables communistes ».
D’après Pierre Bourdieu, la monopolisation des monopoles implique la création d’un « capital étatique » qui permet l’administration de toutes les autres formes de capital. Elle implique en même temps une certaine « universalisation ». Par un investissement conséquent de capital symbolique, les États sont en mesure d’obte-nir la compartimentation de la société, des institutions, de la population, mais aussi des discours en leur sein. Ce processus accroît encore la séparation entre la population du régime et la population ciblée, par une succession d’événements qui peut conduire à l’exter-mination de masse. Pour autant, un État qui comparti-mente n’en est pas moins universaliste : il exerce sa violence symbolique sur son propre peuple comme sur ses « outsiders », par des voies parfaitement complémentaires, modelant une catégorie pour en faire le « négatif » de l’autre. La destruction physique, à l’inverse, est réservée à la seule population ciblée.
toute violence physique est symbolique1. toute violence est porteuse d’une signification, d’un message, à l’intention de la victime ou de l’obser-vateur (celui que Reemtsma nomme le « tiers »). Mais l’acte de violence contient aussi un message à destination de celui qui perpétue l’acte. Il fait sens pour lui ; il peut signifier que la revanche a eu lieu et que l’équilibre des maux est rétabli ; il peut apaiser ses angoisses en lui montrant qu’il contrôle la vie de l’autre (et donc la sienne aussi) ; il peut le convaincre que c’est le pouvoir et la gloire d’un homme que de décider de la vie et de la mort d’un autre ; il peut lui montrer qu’il n’est pas faible mais qu’il est ce soldat endurci et déterminé qu’il entend être…
Certes, dans la plupart des cas, la violence symbolique n’est que symbolique. Elle n’implique pas de briser des os, de broyer des crânes, de violer, de torturer, de mutiler ni de tuer. Mais, à l’inverse, qu’une violence puisse être physique ou matérielle ne l’empêche pas d’être aussi symbolique.
Ceci dit, je reste parfois gêné par l’expression « violence symbolique ». Peut-être existe-t-il une nuance sémantique entre l’usage du mot « violence » en français et en anglais ? Il semble en effet que ce terme s’utilise plus souvent et plus facilement en français pour désigner quelque chose de « brutal » et « d’intense » (Larousse ). En anglais, à l’inverse, le lien entre violence et force physique semble plus fort ; l’Oxford English Dictionary la définit comme un « comportement impliquant l’usage de la force physique avec l’intention de blesser, d’abîmer ou de tuer quelqu’un ou quelque chose » (behavior involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something).
Un programme de recherche constitué dans l’esprit des écrits de Pierre Bourdieu devrait d’abord s’attacher à décrire avec précision la violence symbolique néces-saire à la transformation « d’hommes ordinaires » (volon-taires, enrôlés ou jeunes recrues) en tueurs loyaux et dévoués au service d’un régime génocidaire ; celle qui a formé les agents du NKVD et les SS, ou encore les troupes néerlandaises de la KNIL en Indonésie et les Interahamwe au Rwanda. on a un certain nombre d’informations sur l’entraînement des militaires à qui les forces armées enseignent à tuer les ennemis. En revanche, la fabrique des génocidaires n’a été que très peu étudiée2.
1. Voir Jan Philipp Reemtsma, Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne, Hambourg, Hamburger Edition, 2008.2. Voir notamment Christopher R. Browning, Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, New York, HarperCollins, 1992 ; trad. fr. : Des hommes ordinaires. le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, Paris, Les Belles Lettres, 1994 [1re éd. 1992] ; Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust, New York, alfred a. Knopf, 1996 ; trad. fr. : Les Bourreaux volontaires de Hitler. Les Allemands ordinaires et l’Holocauste, Paris, Seuil, 1997 [1re éd. 1996].
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
34
23. Variation à partir de l’expression psychanalytique « régression au service du moi », voir Ernst Kris, Psychoanalytic Explorations in Art, New York, International Universities Press, 1952 [1ère éd. 1936], p. 312 : « […] dans certaines conditions le moi régule la régression […] ». [Psy-chanalyse de l’art, trad. de l’américain par Béatrix Beck et Marthe de Venoge, avec la coll. de Claude Monod, Paris, PUF, 1978].24. W. Sofsky (Die Ordnung des Terrors…,
op. cit., p. 226) rejette complètement la notion de régression dans ce contexte : « […] le déchaînement de la violence absolue n’est pas une régression vers l’état primitif, la condition première de la psyché [Seele]. La violence est elle-même le produit de la culture humaine, le résultat d’une expérience culturelle. »25. Voir Jacques Sémelin (« Rationalités de la violence extrême », Critique Internationale, 6(1), 2000, p. 122-124) qui parle de l’« ins-
trumentalisation de l’irrationnel » ; ou Saul Friedländer (The Years of Extermination. Nazi Germany and the Jews, 1939-1945, New York, HarperCollins, 2007, p. 472) sur l’allemagne nazie : « […] parangon du style de la propagande du régime : le déchaîne-ment d’une passion démentielle soigneuse-ment mise en scène et orchestrée. ».26. Norbert Elias, The Germans: Power Struggles and the Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth Centu-
ries, New York, Columbia University Press, 1996, chap. 4.27. W. Sofsky, Die Ordnung des Terrors…, op. cit., p. 262 : plus les tortionnaires sont maintenus à l’écart, moins leurs normes sont remises en question ; J. Sémelin (art. cit., p. 123) parle de « situation de huis clos », dans laquelle la violence peut dépasser toute limite. toutefois, comme indiqué précédem-ment, la réclusion n’est pas une condition nécessaire à la violence collective extrême.
localisée, se produisant où et quand le régime et ses hommes de main déportent, concentrent et exterminent leurs victimes. Au sein de ces compartiments, la civilisa-tion est suspendue ; dans des conditions soigneusement contrôlées, on permet que se produise la décivilisation et que la barbarie soit délibérément provoquée et déchaînée contre la population-cible.
Sur les plans mental et social, on peut décrire la décivilisation comme une décomposition des formes civilisées d’interaction, comme une régression vers un stade d’existence antérieur, plus primitif et moins structuré. Dans leurs enclaves meurtrières, les tueurs subissent une régression au service du régime23. Devenus plus durs et plus brutaux, ils se conforment néanmoins aux limites et aux conditions que le régime leur impose pour atteindre ses objectifs. Le régime mobilise alors la barbarie à ses fins propres tout en la confinant méticuleusement dans des comparti-ments de décivilisation localisée24. Même la capacité de destruction la plus sauvage est instrumentalisée, et s’inscrit dans la campagne menée par le régime contre ses ennemis désignés25.
Mais la civilisation ne se décompose pas partout, ni à tous les niveaux. L’ordre social ne vole pas en éclats, la barbarie n’envahit pas tout ; la décivi-lisation se limite à des moments et des espaces bien définis. Le processus de civilisation prend alors une voie différente, celle de la dyscivilisation, qui permet des îlots isolés et circonscrits de décivilisation. À maints égards, l’État continue de fonctionner d’une manière bureaucratique, planifiée, « moderne » voire même « rationnelle ». Mais, à l’intérieur de ce cadre, il agence des enclaves étanches d’atrocité.
La compartimentation est le mode d’arrangement social et le mécanisme de défense psychique par excel-lence dans une société où des groupes-cibles sont exclus de la protection de l’État et de la solidarité des autres citoyens, maltraités et assassinés dans des enclaves d’atrocité, alors même qu’un certain degré de civilisation continue à prévaloir dans le reste de la société. Elle requiert, dans le même temps, une parti-tion stricte et une organisation minutieuse de l’évolution des différents stades émotionnels et interactionnels. La transition vers un ensemble plus souple et plus
varié de modes relationnels et émotionnels – comme ce qu’observe Norbert Elias lorsqu’il étudie le processus de civilisation en l’Europe occidentale – est ici suspendue, voire inversée.
Les sociétés fortement compartimentées développent des modèles de contrôle social et d’autocontrôle solides mais aussi très rigides. Ainsi, des codes de conduite et d’expression très sophistiqués peuvent être maintenus et s’appliquer dans leur moindre détail. Mais il suffit de passer le seuil du compartiment de la barbarie pour que toutes les cruautés et sauvageries soient autorisées jusqu’à ce que l’on en ressorte et que l’on reprenne ses manières policées, comme si de rien n’était : la conduite aussi est compartimentée.
La « régression au service du régime » est l’exact opposé de ce que Norbert Elias appelle « le relâchement contrôlé des contrôles émotionnels ». Avec la première c’est le régime qui contrôle et l’individu qui « relâche » dans les limites qui lui sont imposées, avec le second c’est l’individu qui « relâche » intentionnellement certains contrôles et en maintient d’autres. Elias qualifie d’« effondrement de la civilisation » ce qui s’est passé dans l’Allemagne nazie : un processus de barbarisation ou de décivilisation26. Mais cette caractérisation, bien que saisissante, n’est pas suffisante. Elle signale une perte sans préciser les transformations du compor-tement civilisé ni les limites qui lui sont imposées. Elle ne montre pas davantage comment les enclaves de barbarie sont contrôlées et contenues par la société environnante. Plus qu’un effondrement total, la civili-sation a subi une rigidification et une ritualisation dans la société en général en même temps qu’une destruction dans les enclaves localisées où régnait la barbarie. Or, seule une compartimentation rigou-reuse à tous les niveaux peut maintenir la société dans un équilibre aussi précaire.
Les tortionnaires, eux aussi, sont fréquemment exclus du reste de la société. Ils font partie d’unités secrètes et exclusives postées dans des lieux reculés et isolés. Souvent, ils sont tenus au secret par serment. Il n’est pas rare que les informations extérieures ne leur parviennent pas, vu que toute communication avec le monde hors des lieux de massacre est censurée et que nulle personne extérieure ne peut les joindre27.
Abram de Swaan
35
28. Voir « scène » (front stage ) et « cou-lisses » (backstage) chez Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Garden City (NY), Doubleday, 1959 [La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi, trad. alain accardo, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1973].
29. Voir un rapport non publié de Bas Heerma van Voss sur les témoignages au procès de Zigic mentionnant les conditions dans lesquelles celui-ci pouvait pénétrer dans le camp à sa guise pour tuer et torturer.30. Ces aspects spatiaux sont souvent mentionnés mais presque toujours en passant et sans commentaires.
31. aafke Sanders, “the evil within: geno-cide, memory and myth making in Cam-bodia”, thèse sous la direction de Frans Hüsken, arnhem, Radboud University Nijme-gen, novembre 2006, p. 35, citation tirée d’un entretien avec un témoin oculaire.32. alexander Laban Hinton, Why did they kill? Cambodia in the Shadow of Genocide,
Berkeley, University of California Press, 2005, p. 155-156.33. a. Sanders, “the evil within…”, op. cit., p. 36-37.34. Loïc Wacquant, “Elias in the dark ghet to”, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 24(3-4), décembre 1997, p. 340-348.
Pour mieux saisir les processus à l’œuvre, il faut aussi s’intéresser aux transitions, aux « rites de passage » récurrents d’une conduite « civilisée » à une conduite « brutale ». Comment le soldat rentre-t-il chez lui après sa journée de travail ? Faut-il qu’il se lave, se change, se coiffe, adopte un nouveau visage, ne dise rien de son activité à la maison, qu’il nie en bloc, qu’il mente ? Ou, à l’inverse, raconte-t-il avec force détails macabres les événements de la journée ? Existe-t-il un seuil précis à passer, un horaire et un calendrier stricts à respecter ou, au contraire, gardes et bourreaux se glissent-ils temporairement dans leur rôle sans difficultés, d’une manière chaque fois différente28 ? Les sites sont-ils cachés, inaccessibles, séparés par des déserts, des marais, des bois, camouflés par des murs et des clôtures ou, au contraire, assez visibles pour être remarqués des passants qui peuvent avoir la possibilité d’y entrer, d’observer à leur guise voire, parfois, dans certains cas extrêmes, de participer au carnage29 ? Lorsqu’il n’existe pas de camps d’exter-mination spécialement aménagés, les bourreaux emmènent généralement leurs victimes faire un tour à l’écart des zones habitées, jusque dans un lieu reculé, hors du regard des spectateurs qui ne font pas l’effort de venir voir ce qui se passe. Cette séparation spatiale marque aussi, très probablement, la différence entre ceux qui doivent être mis à mort et ceux qui sont épargnés, entre ceux qui tuent et ceux qui ne tuent pas (et ne sont pas tués)30. Dans les camps, les Khmers rouges tuaient les prisonniers devant les autres détenus, certainement parce qu’ils étaient tous destinés à mourir bientôt. « Ils tuaient en public. Par exemple, quand quelqu’un trouvait un escargot en travaillant et essayait de le manger, si le chef des Khmers rouges le voyait, il s’approchait de lui et le tuait. Il ne l’emme-nait pas ailleurs, il le tuait immédiatement, devant tout le monde31. » Il est aussi arrivé que les victimes soient entassées dans des camions qui les emmenaient en forêt ; elles y étaient exécutées, souvent de nuit32. « Angkar [le Parti] disait toujours que nous ne devions pas y aller. Ils disaient que la forêt était hantée, que les fantômes nous feraient peur avec leurs bruits étranges. » Mais c’était en réalité les hurlements des personnes en train d’être massacrées33.
Que pensent d’eux-mêmes les gardes, les bourreaux et les miliciens ? On les découvre généralement en train de se défendre, obligés de s’exprimer face à leurs
juges. Mais nous savons peu de choses de ce qu’ils étaient en pleine action, lorsqu’ils étaient à l’offensive et qu’ils devaient prouver leur zèle, leur motivation, leur ardeur, leur conviction, leur loyauté et leur dévouement à la tâche. Mais, à nouveau, que pensent-ils d’eux-mêmes lorsqu’ils changent de compartiment ? Se voient-ils alors comme « une personne différente » ? Suspendent-ils toutes émotions ? Essaient-ils « de ne plus penser » ou, au contraire, sont-ils fiers et satisfaits d’eux-mêmes ? Autant de questions qui portent sur la nature de la compartimentation mentale et sociale.
Il n’est pas nécessaire que la compartimentation soit si extrême. Elle peut se produire dans des conditions bien plus inoffensives, en comparaison. Ainsi par exemple, dans les sociétés de consommation contem-poraines, la boucherie est reléguée dans des compar-timents qui lui sont propres : les abattoirs, porcheries, élevages de poulets industriels, etc., sont cachés au regard du public ; étant hors de vue, ils sont d’autant plus faciles à oublier. Même lorsqu’ils apprécient leur viande, les consommateurs parviennent à oublier qu’ils sont en train de manger les restes d’un être vivant et à occulter la façon dont il a été élevé, abattu, découpé quand bien même ils le savent parfaitement.
De même, dans la plupart des sociétés, la prostitution est isolée du reste de la vie sociale : il existe des espaces enclavés (« zones de tolérance », « quartiers réservés », « maisons closes »), et des séparations temporelles (« obscurité », « filles de la nuit »). Les prosti-tuées comme leurs clients réussissent généralement à entrer et sortir de ces limites sans se faire remarquer. Les prisons, les services psychiatriques ou les autres espaces chers à Michel Foucault fonctionnent selon les mêmes logiques.
L’isolement spatial et l’exclusion sociale d’une population désignée se retrouvent également dans le phénomène de ghettoïsation des centres-villes américains, comme expliqué par Loïc Wacquant34. La description détaillée qu’il en fait est d’autant plus intéressante qu’il l’analyse explicitement en termes de « décivilisation » : au fur et à mesure que l’État se désengage des zones urbaines centrales, les chaînes d’interdépendance se délitent, l’autocontrôle disparaît une « dépacification » s’opère et la violence s’accroît sans que la police ne cherche à intervenir ; la différenciation sociale s’inverse et seules les activités économiques informelles subsistent. Des îlots de « décivilisation »
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
36
35. Il suffit « d’un seul faux-pas » pour se retrouver empêtré dans le compartiment de décivilisation du ghetto, comme l’a montré tom Wolfe, Le Bûcher des vanités,
Paris, Le Livre de Poche, 1990.36. Jonathan Fletcher (Violence and Civili-zation: An introduction to the work of Nor-bert Elias, Cambridge, Polity Press, 1997,
p. 286) définit la civilisation comme « une expansion du périmètre d’identification mutuelle au sein ou entre des groupes ».37. Michael Mann, The Dark Side of
Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 5.
émergent ainsi au cœur d’une société relativement civilisée qui continue pourtant à fonctionner sans s’en préoccuper outre mesure. En dehors de ces « ghettos », la vie se poursuit « comme d’habitude »35. Wacquant souligne la nécessaire dés-identification qui maintient la catégorie généralement désignée par le terme d’« underclass », en tant que catégorie séparée, hors des limites de la citoyenneté normale et morale. Il décrit en fait une situation de compartimentation efficace qui maintient une séparation précaire entre sphères « civilisée » et « décivilisée », bien qu’elle reste très éloignée de l’extermination effective.
Mais ce qui nous importe ici c’est la manière dont ces poches de décivilisation sont efficacement isolées de la société environnante, éloignées des consciences et dispensées d’identification affective ou morale. À n’en pas douter, il y a déjà un début de « brutalisa-tion » dans cet apartheid de fait. Le passage du désin-térêt et de l’indifférence à une véritable extermination impliquerait cependant le déploiement de mesures considérables et tout à fait improbables.
La notion selon laquelle des niveaux minimaux de comportement civilisé subsistent dans toutes les circonstances, et sont sensiblement équivalents pour tous, est au cœur de la théorie d’Elias sur le proces-sus de civilisation dans sa phase avancée. Il formule en fait l’hypothèse implicite d’une égalité minimale de traitement et d’estime. Un tel degré minimum implique que toute personne d’une même société identi-fie ses pairs comme ses semblables, plus ou moins36. Cela suppose, en outre, un certain degré d’égalité devant la loi, voire même une certaine égalisation des conditions de vie. Lorsqu’une catégorie est exclue de cette égalité minimale, le processus de civilisation peut changer d’orientation et suivre une voie différente. Mais un régime radical et exterminateur est requis pour prendre le virage de la compartimentation extrême.
Les étapes avancées de la compartimentation présen-tent une incompatibilité croissante avec la liberté de la presse et d’association, ou avec des garanties légales telles que la liberté de mouvement et de parole qui, toutes, par nature, tendent à transgresser ou transcender les frontières nécessaires au maintien des compartiments. Sauf, naturellement, si la population exclue est privée de ces droits et si les autres citoyens s’accordent implici-tement pour se désintéresser de ce qui lui est infligé comme, par exemple, la société esclavagiste du Sud des États-Unis avant la Guerre de Sécession ou la situation du début du XXe siècle dans les plantations des Indes
néerlandaises. Dans ces conditions, le groupe privilégié jouit d’une liberté de la presse et d’association restreinte, sans jamais transgresser les limites qui le séparent du groupe exclu. Il est même possible qu’un État-provi-dence généreux existe dans une société compartimentée, dégagé de ses fondements universalistes et égalitaires, sous réserve que les victimes désignées soient exclues de son bénéfice (on peut ici penser notamment aux politiques sociales mises en place par l’Allemagne nazie).
Si un certain degré de compartimentation sociale est nécessaire à l’extermination de masse, ce n’est toutefois pas une condition suffisante. Certaines sociétés ont été fortement compartimentées sur de longues périodes sans que jamais ne se produisent des massacres à grande échelle. On pense notamment aux sociétés esclavagistes, où la population-cible potentielle détenait une valeur économique pour la population dominante. Au cours de brefs accès de violence collective à petite échelle – comme, par exemple, des manifestations de rue –, il peut arriver que des victimes soient exécutées au hasard ou en fonction de griefs particuliers. Cette situation est néanmoins très diffé-rente des épisodes de violence plus longs et à plus grande échelle, où les cibles ont été préalablement définies sur la base de critères stables. Les membres du groupe agressif se sont alors progressivement dés-identifiés de leurs cibles et leurs relations de plus en plus compartimentées.
Même s’il le voulait, un régime agressif ne pourrait pas fabriquer un groupe-cible de toutes pièces. Toute société présente des lignes de clivage potentiel qui n’ont pas toutes été activées en un lieu ou une période donnés. Comme le souligne Michael Mann, les tensions de classe sont presque omniprésentes et les frictions ethniques quasi universelles. À un moment donné, quelque entrepreneur politique peut chercher à sonder les sentiments du peuple pour repérer les signes de conflit latent susceptibles de fournir un appui maximal. Et c’est alors, pour reprendre les termes de Michael Mann, que « l’appartenance ethnique supplante la classe sociale » ; l’inverse est valable également37.
Un régime radical se doit de travailler avec un vocabulaire et une imagerie de la mémoire collective, qu’ils soient latents ou actifs.
Ainsi, une fois qu’il a choisi son thème, le régime peut l’exploiter pour attiser la haine contre le groupe-cible correspondant. Il peut partir d’une compartimen-tation existante pour l’étendre et l’intensifier à l’extrême. Au fur et à mesure qu’un groupe est dressé contre un autre,
Abram de Swaan
37
38. U. Ü. Üngör, The Making of Modern Turkey…, op. cit. 39. titre sarcastique d’un recueil de lettres, journaux intimes et photos de tortionnaires de l’Holocauste, voir E. Klee, W. Dressen et V. Riess (éds), “The Good Old Days”…, op. cit.
le groupe-cible se dessine plus clairement, de même que « le peuple du régime ». La menace d’un camp peut inciter l’autre à serrer les rangs et à se préparer au combat, ce qui conduira le premier à faire de même. Fanatisation et radicalisation acquièrent alors une dynamique propre. Au fur et à mesure que les relations de pouvoir s’intensifient entre le peuple du régime et le groupe-cible, il devient de plus en plus difficile à ce dernier de s’organiser et de se défendre. Même si le groupe-cible a peu de poids vis-à-vis du régime et de ses tenants, le régime s’efforce de convaincre sa population que le groupe-cible représente une menace imminente, parce qu’il aurait le soutien de forces extérieures, ferait partie d’une conspiration mondiale, ou disposerait de ressources secrètes, d’armes miracu-leuses ou de pouvoirs surnaturels. Les militants du régime ne se contentent pas de répandre la haine parmi leurs semblables, ils instillent aussi la peur d’un groupe qui apparaît pourtant bien plus faible. La peur, bien plus que la haine, justifie l’agression d’un adversaire présenté non pas comme une victime mais comme une menace. Les bourreaux se présentent volontiers comme les victimes de leurs victimes.
Le régime s’appuie sur les conditions de compar-timentation existantes qu’il s’efforce d’intensifier et d’étendre. Au fur et à mesure qu’il parvient à isoler le groupe-cible, à le calomnier et à le diaboliser, une dialectique sociale de menace et de peur s’installe, acquiert sa propre dynamique et accentue le processus dans la société toute entière. La population demande alors à être protégée de la menace que le régime a si bien réussi à fabriquer ; elle exige des mesures radicales contre les ennemis que le régime a si effica-cement désignés. Ce faisant, elle devient de plus en plus le « peuple du régime » : elle soutient la propa-gande officielle en racontant des histoires horribles ou en provoquant des affrontements avec des personnes du groupe-cible, ce qui renforce encore les sentiments d’hostilité et de mépris. Dans l’intervalle, toute opposi-tion ou toute information contraire à la propagande, qu’elle vienne de l’intérieur ou d’une source étrangère, doit être stoppée et réprimée.
Bien que les politiques radicales d’un régime qui vise l’extermination découlent rarement d’un projet rationnel, optimisé, éclairé et soigneusement planifié, ses chefs et sympathisants ont beaucoup à gagner. En effet, chaque fois qu’un responsable est démis de ses fonctions, qu’un emploi est perdu, qu’une affaire est transférée ou qu’une maison est abandonnée par une personne du groupe-cible, les protégés du régime profitent de l’occasion. Toujours au bénéfice du régime
et de sa population, des taxes peuvent être imposées au groupe-cible, ses membres chassés de leurs champs ou de leurs maisons ; ses églises et ses temples pillés. Ainsi par exemple, dans le cas du génocide arménien, « en procédant à [leur] liquidation totale, du moins en Anatolie orientale, l’État s’est octroyé un accès direct à un grand nombre de terres, de propriétés et de capitaux qui ont ensuite été redistribués ou mis au service de ses objectifs dirigistes pour accélérer le processus d’accumulation de capital mené par l’État38. »
En outre, l’humiliation du groupe-cible stimule le peuple du régime et l’encourage. Quel que soit son degré de pauvreté, d’ignorance, de laideur ou d’insignifiance, chacun de ses membres se sent supérieur au meilleur des membres du groupe-cible, si méprisables et détestables ; cette croyance peut être en soi d’une grande consolation. La clarté, la simpli-cité, l’exhaustivité d’une vision du monde qui attribue au groupe-cible la responsabilité de tous les maux donne à ceux qui l’adoptent le sentiment que le monde est enfin intelligible, que leur vie a un sens moral et qu’il existe désormais des moyens d’améliorer la société.
Une forte dés-identification par rapport aux autres permet une identification plus étroite avec son propre peuple. Les rangs sont resserrés et l’on peut avoir un sentiment de loyauté plus fort vis-à-vis de ses pairs et du régime. Il semble qu’en période de crise, ce rapprochement réponde à un vif besoin. Très souvent, lorsque les gens se remémorent longtemps après cette période éprouvante, ils ressentent une certaine nostalgie pour une époque « plus conviviale », « plus généreuse », plus unie que « la période froide et égoïste d’aujourd’hui » ; en bref, « c’était le bon temps »39.
Les partisans de l’extermination sont souvent, eux aussi, des idéalistes, prêts à sacrifier un nombre incalculable de vies pour atteindre un monde meilleur. La tâche qui les attend peut être sanglante et rude, mais elle est néces-saire. À quelques rares exceptions près, tous les régimes qui s’engagent dans l’extermination de masse prétendent que leur société est à un tournant de son histoire. « C’est maintenant ou jamais » : c’est le moment d’agir, d’agir radicalement et de manière décisive pour changer le cours des événements une fois pour toute. C’est l’avè-nement d’un moment unique où un groupe restreint mais déterminé a le pouvoir d’influer véritablement sur le destin de tous. Le temps historique se trouve réduit à un instant unique, celui du changement.
Les radicaux sont prêts à accéder à la fin de l’histoire. Après un dernier effort consenti par une avant-garde héroïque, l’histoire se figera dans un monde idéal. Dans de nombreux cas, ce futur visionnaire est d’ailleurs
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
38
40. Randall Collins, Violence. A Micro-sociological Theory, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008, p. 88 41. Ibid., p. 127-132, p. 97. Collins (ibid.,
p. 99-100) exclut les massacres perpétrés sur ordre exprès de supérieurs hiérarchiques (comme l’exécution massive de juifs par les allemands sur le front de l’Est). Cependant
ce n’est pas un critère très efficace pour distinguer les cas, car les supérieurs nient souvent avoir donné de tels ordres.42. J. a. a. Van Doorn et W. J. Hendrix,
Ontsporing van geweld: Het Nederlands-Indonesisch conflict [Le Déraillement de la violence. Le conflit Pays-Bas/Indonésie], Dieren, De Bataafsche Leeuw, 1985.
un retour vers un passé mythique et idéalisé. Toutefois, pour accomplir cette grande tâche, une formidable transformation est encore nécessaire : l’élimination de tous ceux qui gênent l’avènement de la société idéale. Mais ce n’est qu’un petit prix à payer (par d’autres, en plus) pour réaliser une utopie éternelle.
Cette perception dichotomique du monde, cette mentalité du « nous » contre « eux » dérive facilement vers une vision magique : les autres sont souillés, impurs et risquent donc de nous infecter et de nous polluer. Les bourgeois risquent de contaminer les sobres prolé-taires en leur transmettant leur cupidité, leur matéria-lisme et leurs vices médiocres. Ils savent comment séduire un esprit innocent. Les races différentes, et donc inférieures, peuvent nous souiller de leur luxure, de leur paresse et de leur rapacité. Pire encore, la débauche et les croisements entre races vont produire une race impure de bâtards dégénérés.
Au XXe siècle, la pensée magique s’est souvent travestie en discours scientifique : théories pseudo-darwiniennes d’une bataille sans fin entre les races pour leur espace vital et leur survie ou théories pseudo-marxistes de la guerre totale et implacable entre classes possédantes et dépossédées. Jacques Sémelin a notam-ment souligné la prévalence d’une obsession magique de la pureté et d’une purification radicale qui passe par la destruction du sale : cette « folie meurtrière » relève alors d’une véritable « logique », aussi irrationnelle puisse-t-elle apparaître.
Quatre modes d’extermination de masse
J’ai formulé jusqu’à présent une série d’observations générales sur les régimes qui s’orientent vers une exter-mination de masse ou s’y livrent effectivement. Aucune de ces observations n’est valable pour la totalité des cas mais toutes sont applicables, à des degrés variables, à la plupart. Quatre modes d’extermination de masse peuvent être distingués : la frénésie des conquérants, le règne par la terreur, le triomphe des perdants et le « megapogrom ».
Parmi ces quatre modes, trois concernent des situations où le régime est directement impliqué. Le premier, la frénésie des conquérants fait référence aux exterminations de masse perpétrées à la suite d’une conquête ou d’une occupation. Le second, le règne par la terreur, désigne la violence de masse que des régimes plus ou moins établis emploient pour mettre en œuvre leur politique. Le troisième, la victoire des perdants concerne la violence de masse commise
par des régimes confrontés à une défaite imminente. Enfin, le quatrième mode, le megapogrom correspond à la violence de masse perpétrée par des bandes armées ou des groupes civils sur un territoire donné, sans implication directe du régime (mais avec son appui). Certains cas relèvent de plusieurs catégories, d’autres évoluent d’un mode à l’autre.
Le premier mode d’extermination de masse, la frénésie des conquérants, se produit souvent après la victoire ou la conquête. S’il prolonge la lutte armée et requiert des moyens similaires, il concerne un type particulier de population : les personnes qui ne sont plus en état de menacer les tueurs ni de se défendre contre eux. Cette catégorie englobe de nombreux massacres perpétrés par les armées coloniales sur les populations indigènes. Le commandement militaire espère soumettre la popula-tion conquise par la terreur. Il veut chasser les habitants de leurs maisons et de leurs terres pour que les colons de la nation victorieuse ou ses alliés locaux puissent en prendre le contrôle. Mais cette frénésie s’explique aussi par des motifs moins « rationnels » ou « calculés ». Les soldats ont dû faire face à une résistance féroce ; leur peur s’est muée en rage et en soif de vengeance. Ils aspirent à jouir des privilèges du vainqueur : le viol et le pillage. Trop souvent, ils brûlent, torturent, pillent et massacrent les populations vaincues et sans défense simplement parce qu’ils peuvent le faire impunément, sans avoir à redouter une quelconque sanction.
Randall Collins utilise le terme de forward panic ou « fuite en avant » pour désigner ce type d’accès meurtrier au sein d’un groupe restreint : « C’est la facilité de battre un ennemi que l’on traque depuis longtemps qui transforme la tension et la peur en une attaque frénétique qui relève de la fuite en avant. C’est d’autant plus vrai lorsque l’ennemi n’est pas là où on l’attend et que l’on trouve à sa place des victimes sans défense liées au camp ennemi40. » Si Collins traite principalement des explosions de violence locales et transitoires, il applique néanmoins cette idée de « fuite en avant » à des massacres perpétrés sur des périodes plus longues dans le cadre d’émeutes comme, par exemple, lors du massacre de Nankin par les Japonais41. Van Doorn et Hendrix remarquent que ce « déraillement de la violence » de la part d’unités militaires en terrain inconnu parmi une population étrangère et hostile est si fréquent qu’il s’agit presque d’un risque professionnel. Le commandement militaire et les officiers de terrain doivent se préparer à cette éventualité pour prévenir et maîtriser ce type d’agissements42.
Abram de Swaan
40
Les unités militaires qui connaissent un tel accès meurtrier agissent parfois sur ordre du régime de leur pays. Les instructions qui leur sont données peuvent aussi leur parvenir des quartiers généraux de campagne, à l’insu des autorités du pays d’ori-gine ou même en contradiction complète avec leur politique déclarée. Ces ordres peuvent aussi être donnés par des officiers de terrain, de leur propre initiative. Généralement, les échelons supérieurs de la chaîne de commandement préfèrent d’ailleurs ne pas endosser la responsabilité de la violation patente d’un traité ou d’une règle de guerre. Une simple al lusion de la hiérarchie suff it parfois à faire comprendre aux officiers subalternes que l’on fermera les yeux sur les incartades de leurs hommes.
Quoi qu’il en soit, mener des campagnes éloignées présuppose au minimum l’existence d’un État capable d’envoyer des armées à l’étranger et d’organiser la logistique nécessaire pour les maintenir en état de combattre. Le régime est donc toujours impliqué dans les événements qui se déroulent dans la zone de guerre, même si les responsables politiques peuvent plaider l’ignorance ou prétendre qu’ils n’avaient pas la capacité d’empêcher ces exactions. D’ailleurs, ils sont généralement très efficaces quand il s’agit de couvrir leurs hommes, de minimiser, voire de nier les événements, en collusion avec les autorités militaires et le commandement de terrain.
La présence d’une armée de conquête ou d’occupation dans des pays étrangers, souvent éloignés, assure déjà un haut degré de compartimentation. La distance géographique est un séparateur physique naturel pour le peuple du régime, l’ignorance étant un isolant psychique entre les citoyens du pays d’origine et le peuple vaincu. L’armée coloniale est constituée de spécialistes de la violence, de personnels militaires, parfois de professionnels aguerris ou de conscrits qui peuvent être mal à l’aise mais sont généralement dociles. La guerre entre armées indigènes, entre parties plus ou moins symétriques, est souvent un préalable à des massacres commis entre deux parties inégales : des forces militaires victorieuses, bien armées et organisées, s’opposent alors à des combat-tants vaincus, désarmés, désorganisés et démoralisés, ou à une population civile sans défense contre la furie des conquérants.
Le peuple envahisseur et le peuple autochtone s’identifient rarement : chacun considère l’autre comme étranger, différent de lui, à peine humain. Les sites où les massacres sont perpétrés sont bien au-delà du champ de perception des citoyens du pays d’origine, qui le plus souvent ne sont pas informés de ce que commettent leurs armées et préfèrent d’ailleurs ne pas être au courant des détails sordides.
La distance qui les sépare de la zone de guerre aide les citoyens du pays d’origine à maintenir une distance émotionnelle et morale par rapport aux exactions commises lorsqu’ils en ont connaissance. La hiérar-chie militaire avance invariablement les mêmes arguments (à supposer qu’elle ait besoin de se justifier) : c’est l’ennemi qui, le premier, s’est rendu coupable d’atrocités ; il fallait briser la résistance de la population locale et le soutien qu’elle apportait aux combattants ; les gens sur place sont incapables de comprendre des arguments raisonnables ; il faut leur montrer qui commande, etc.
Quant aux tueurs, ils ont beaucoup à gagner de ces attaques meurtrières. Il y a d’abord la satisfaction de prendre leur revanche sur les épreuves, les souffrances et les pertes qu’ils ont eux aussi subies. Il y a aussi le plaisir brut de voir des gens terrorisés, terrifiés, implorants, suppliant qu’on leur laisse la vie sauve ; la jubilation de détruire des huttes et des champs, des églises, des constructions érigées et chéries par des ennemis haïs ; l’excitation, la sensation de pouvoir et la satisfaction qui accompagnent le viol après de longues périodes de frustration ; le sentiment de triomphe procuré par la mise à mort d’un étranger sans défense.
Cependant, nombre de ces hommes doivent aussi ressentir des sentiments et des pensées contradictoires. « Au fond d’eux-mêmes », ils savent qu’ils agissent mal. Mais ce sentiment, peut-être trop profondément enfoui, est ignoré pendant les épisodes d’euphorie et de frénésie. En outre, trop souvent, les victimes ne sont pas considérées comme des êtres humains : elles sont trop méprisables ou trop barbares pour avoir droit à une quelconque protection d’ordre éthique ; par ailleurs, tous les autres compagnons d’armes agissent de même et les officiers laissent faire, nul n’en saura jamais rien. Et ces croyances se vérifient d’ailleurs assez souvent.
L’histoire récente fournit de nombreux exemples de frénésie des conquérants, notamment durant le dernier quart du XIXe siècle lorsque les nations impérialistes d’Europe ont conquis l’intérieur de leurs colonies et soumis les résistants indigènes armés. Les guerriers autochtones ne pouvaient guère rivaliser avec les armées européennes et leur défaite s’est souvent traduite par le massacre des vaincus. D’ailleurs, les conquérants ne se sont pas arrêtés là et ont pu tuer massivement – et de manière arbitraire – les habitants non armés de la région.
Au début du X Xe siècle, l’armée al lemande s’est aussi tristement illustrée dans le Sud-Ouest africain en exterminant la nation rebelle des Hereros qui avait osé résister à l’occupation. Sous le règne du roi Léopold II, de la fin des années 1880 à 1908,
Abram de Swaan
41
43. Des éléments récents sont donnés dans les rapports (intermédiaires) de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIDPRK/Questions_answers.pdf.
des mercenaires et des négociants belges ont tué des millions de Congolais et entraîné la mort de plusieurs millions d’Africains supplémentaires qui, dans un pays dévasté, ont succombé à l’épuisement et à la maladie. À la fin du XIXe siècle, les armées coloniales hollandaises ont tué environ 100 000 personnes au cours de la longue conquête d’Aceh. Dans les années 1930, alors qu’elles avançaient sur le territoire chinois, les forces japonaises ont exécuté soldats vaincus et civils par centaines de milliers. Le pire cas de frénésie des conquérants s’est certai-nement produit lorsque les Allemands ont envahi la Pologne, les pays d’Europe de l’Est puis, à partir de 1941, une grande part de l’Union soviétique : des « partisans », des « commissaires du peuple » et des millions de juifs ont été abattus par des pelotons d’exé-cution tandis qu’un nombre similaire de prisonniers de guerre soviétiques sont morts de faim.
Aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, les nouveaux arrivants ont souvent tué les peuples autochtones qui occupaient des terres qu’ils voulaient récupérer ou, après les avoir expulsés, les ont laissés mourir de faim ou d’épidémie sans que jamais leur pays d’origine n’intervienne.
Le deuxième mode d’extermination de masse, le règne par la terreur, s’observe dans des sociétés où le régime est bien établi et dispose d’une armée, d’une police, de services secrets et d’un système de camps. Dans ces conditions, la répression et l’extermination sont du domaine des professionnels, des spécialistes de la surveillance, du renseignement, de l’investigation, de l’interrogation, de la condamnation, de la dépor-tation, de la détention, de l’exploitation et de l’exter-mination. Ces régimes de terreur peuvent rester en place pendant des décennies et continuer de déporter, d’enfermer et de tuer des millions, voire des dizaines de millions de personnes. Ils apparaissent généralement après une guerre, une guerre civile, une révolution ou un coup d’État. Le souvenir, l’anticipation, et les images de la guerre ne sont jamais loin, même pendant les longues périodes de paix extérieure. À l’intérieur, l’opposition est dépeinte comme la cinquième colonne, l’ennemi intérieur, un adversaire irréductible et mortellement dangereux. Le conf lit n’est pas présenté comme une question politique mais comme une bataille décisive dans la guerre perpétuelle entre races indigène et étrangère, ou comme la confrontation finale de la guerre éternelle que se livrent classes laborieuse et possédante. Les prétendus opposants doivent, à tout prix, être mis dans l’incapacité de nuire. Dans les cas extrêmes, le régime rassemble tous ceux
dont il se méfie, les emprisonne ou les déporte vers des camps reculés où ils seront exploités à mort ou tués sur le champ. Il est parfois difficile de détermi-ner ce qui déclenche ces campagnes de terreur mais, dans bien des cas, la rivalité entre factions du régime est à l’origine d’attaques concertées contre une part de la population qui, pour une raison ou une autre, est alors associée à l’une des parties. Au bout d’un certain temps, la vague de terreur s’épuise et se retire, laissant la place à un interlude relativement tranquille jusqu’à l’épisode suivant.
Les deux exemples les plus saisissants de gouvernement par la terreur au XXe siècle restent l’Union soviétique et la Chine communiste. Dans son étude, Rudolph Rummel les classe dans la catégorie des « dekame-gamurderers », ces régimes ayant chacun fait plus de dix millions de victimes civiles sur leur territoire. Les conséquences du coup d’État conduit par l’armée indonésienne en 1965 fournissent un exemple plus ambigu : dans les villages, des forces spéciales et des groupes d’« étudiants » musulmans ont tué près d’un million de personnes soupçonnées de commu-nisme. La Corée du Nord continue encore aujourd’hui à régner par la terreur : elle réprime sa population dans un vaste système pénal, exerce une oppression extrême et organise la pénurie, usant délibérément et régulièrement de la famine43.
Le troisième mode d’extermination s’observe lorsque le régime, confronté à une défaite imminente, poursuit ou initie une campagne contre des ennemis intérieurs présumés. Le plus souvent, ce dernier sursaut est considéré comme prioritaire et les dernières ressources sont consacrées à l’extermination plutôt qu’à la lutte contre l’ennemi extérieur. Si le régime doit tomber, il aura au moins réalisé sa mission historique de destruction de la race méprisée, de la classe détestée. C’est le « triomphe des perdants ». D’un point de vue psychologique, c’est une manière de « transfor-mer le passif en actif » : le régime ne pouvant plus éviter la défaite, choisit de mener une autre bataille – potentiel-lement victorieuse – malgré le fait qu’elle fragilise encore davantage l’effort de guerre contre l’opposant militaire. Le régime s’emploie alors à détruire une population-cible qui n’est pas en mesure de répliquer. Cette manière d’agir est aussi destructive qu’autodestructive. Si, d’un point de vue militaire, cette stratégie est complètement irrationnelle, elle découle inéluctablement de la manière dont le régime conçoit le monde.
Ce triomphe des perdants peut, lui aussi, nécessiter un effort soutenu de compartimentation de la part du régime. Il peut par exemple s’appuyer sur le vocabulaire
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
42
44. Donald L. Horowitz, The Deadly Ethnic Riot, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 1 : « Un soulèvement ethnique meurtrier est une attaque intense, soudaine (ce qui n’implique pas nécessairement une absence totale de planification) et mortelle par des membres civils d’un groupe ethnique contre un autre groupe ethnique, les victimes étant choisies en raison de leur appartenance au groupe. », voir aussi p. 20.
de la discrimination pour renforcer l’identification au sein du peuple du régime et sa dés-identification par rapport au groupe-cible. Il lui faudra alors mettre en place une législation d’exclusion, obliger les médias à soutenir sa propagande, exclure le groupe-cible des institutions (écoles, hôpitaux, etc.), lui interdire l’accès à la plupart des emplois, décourager les rencontres entre son peuple et les membres du groupe-cible, assigner à ce dernier des zones de vie et des infras-tructures séparées, etc. De tels efforts présupposent l’existence d’un État capable de faire appliquer sa politique dans toute la société, c’est-à-dire d’être épaulé par des services de renseignement, une force de police, des inspecteurs des impôts, des directeurs d’école, des censeurs et des médias aux ordres. Toutefois, presque par définition, les régimes qui transforment ainsi le passif en actif au moment même où ils sont poussés dans leurs derniers retranchements par des forces extérieures, ne réussissent à se maintenir que quelques années, à l’inverse des régimes de terreur qui peuvent durer plusieurs générations. Les agissements de l’Allemagne nazie sur le front de l’Est constituent un parfait exemple du triomphe des perdants. À peine avaient-ils déclaré la guerre à l’Union soviétique que les nazis ont commencé à exterminer tous les juifs de l’autre côté du front de l’Est, cédant à une fréné-sie de conquête extrême. En revanche, lorsqu’il est apparu que la guerre allait être perdue sur les deux fronts, Hitler a concentré ses forces dans la seule bataille qu’il pouvait encore gagner : l’extermination des juifs d’Europe.
Il y a bien d’autres exemples, quoique très différents, d’exterminations correspondant au modèle du triomphe des perdants. On pourrait ainsi comprendre les principaux aspects du génocide arménien perpétré par les Turcs lorsqu’ils se sont repliés face aux forces alliées durant la Première Guerre mondiale. De même, en 1973, quand le Pakistan (occidental) a envahi la partie orientale du pays – qui allait bientôt devenir le Bangladesh –, l’armée a tué de 300 000 à 3 000 000 de Bangladais. La sécession était pourtant quasi inévi-table et l’armée indienne se préparait à soutenir son voisin nouvellement indépendant. Dans les années 1970, le régime de Pol Pot a tué un million de compa-triotes, provoquant l’invasion vietnamienne. Mais une fois les Vietnamiens arrivés, les Khmers rouges ont continué et même intensifié leur campagne d’extermi-nation. Le Rwanda constitue certainement l’exemple le plus flagrant du triomphe des perdants. Si, en 1994, le pouvoir hutu fit peu d’efforts pourrésister à l’invasion
du FPR tutsi venu du nord, il continua à massacrer les Tutsis et les Hutus suspects, tuant au total près d’un million de victimes. Mus par une obsession similaire de « nettoyage » visant à éliminer les Croates et les musulmans des territoires qu’elles occupaient, l’armée et les milices serbes ont tué des dizaines de milliers de personnes, après l’intervention internationale pourtant destinée à apaiser le conflit.
On peut distinguer, enfin, une quatrième forme d’extermination de masse : celle qui se produit de manière plus ou moins indépendante du gouvernement central et de son commandement militaire. C’est ce que l’on observe lorsque des foules ou des bandes – presque toujours poussées par des responsables politiques locaux et des agitateurs – attaquent un groupe-cible. En règle générale, ces groupes sont peu organisés, et peu équipés. Au niveau local, cette extermination ressemble à un pogrom, ou à un soulèvement meurtrier44. Mais ces tueries apparemment improvisées et spontanées s’ins-crivent en réalité dans une suite d’événements bien plus longue qui implique le déplacement de millions de personnes : c’est un megapogrom.
En règle générale, les groupes-cibles sont attaqués par des groupes qui les dépouillent, les chassent de chez eux, se livrent souvent au viol et au meurtre de masse. S’il est ardu d’établir le rôle des notables locaux, puisqu’ils s’efforcent généralement de masquer leur rôle dans ces événements, les liens avec les autorités régionales et le régime central sont encore plus difficiles à retracer. Mais souvent, le nettoyage ethnique qui se déroule au niveau local sert les objectifs des hauts responsables et des hommes politiques pour qui une nation homogène est bien préférable. La déportation et l’extermination sont des basses besognes qui leur sont ainsi épargnées ; elles sont prises en charge par des agitateurs avec l’appui implicite des responsables politiques locaux, des chefs de bandes ou de la police.
Deux des plus grands megapogroms du siècle dernier se sont produits dans les années 1940. En Europe centrale et orientale, plus de dix millions d’Allemands ont été expulsés sans distinction entre les familles qui vivaient là depuis des siècles, les nazis venus comme occupants ou les gens qui se trouvaient simplement habiter dans des territoires allemands qui allaient être rattachés à la Pologne ou à la Tchécoslo-vaquie. Près d’un million de personnes sont mortes dans des conditions terribles ou ont été tuées sur le champ. De même, avant et après la Partition de 1947, les émeutes locales qui ont éclaté en Inde et au Pakistan contre les minorités de l’autre confession ont entraîné
Abram de Swaan
43
l’expulsion de près de dix millions de musulmans, d’hindous et de sikhs. Près d’un million de personnes ont succombé à la faim et à la maladie, ou sont mortes dans des massacres perpétrés par la foule.
La compartimentation est une caractéristique commune à toutes les exterminations de masse, bien qu’à des degrés variables. Elle est menée à l’extrême, à tous les niveaux, lorsqu’un régime établi l’utilise pour régner par la terreur. L’État peut faire plein usage de son appareil de propagande et de son système de répression pour isoler les groupes-cibles, et mobiliser un personnel
spécialisé pour les exterminer à l’écart, dans des compartiments de la mort. Mais la compartimentation est bien moins sophistiquée dans les sociétés où se produisent des megapogroms. En effet, le régime garde alors une certaine distance avec les massacres et les groupes semblent s’assembler spontanément pour tuer leurs victimes en pleine lumière, dans un bref accès de frénésie meurtrière. Toutefois, même dans de tels cas, les lignes d’identification et de dés-identification préexistent depuis longtemps et les groupes se contentent de créer leurs propres compartiments transitoires.
Traduit de l’anglais par Françoise Wirth
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
44
Joseph Jurt
TIRADENTES, Décio Villares.
Le Brésil : un État-nation à construireLe rôle des symboles nationaux : de l’empire à la république
45ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 44-57
1. http://www.museudarepublica.org.br/principal2.html (traduit par l’auteur).2. anne-Marie thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècles, Paris, Seuil, coll. « L’univers his-
torique », 1999, p. 14 ; voir à ce sujet aussi Pierre Bourdieu, Sur l’état. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, coll. « Cours et tra-vaux », 2012, p. 253, 462.
3. José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas : O Imaginário da República no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 1990.4. armelle Enders, Histoire du Brésil contem-
porain XIXe-XXe siècles, Bruxelles, Complexe, coll. « Questions au xxe siècle », 1997, p. 14.5. Bartolomé Bennassar et Richard Marin, Histoire du Brésil 1500-2000, Paris, Fayard, 2000, p. 173.
À l’entrée de la salle des symboles du Musée de la République à Rio de Janeiro, qui fut pendant 63 ans le siège de la présidence de la République du Brésil, on peut lire ceci : « Les symboles font partie de l’identité des États. Leur existence même signifie que le monopole du pouvoir et les instruments juridiques ne suffisent pas pour garantir la légitimité des gouver-nements. Aussi les États s’affirment-ils à travers un système de signes et d’emblèmes qui traduisent leurs valeurs et leurs idéaux. Reconnus sur un plan symbolique, ces signes créent un contexte qui favorise la légitimité et la reproduction de l’ordre social »1.
L’État constitutionnel et la symbolique politique
Les symboles nationaux se révélèrent nécessaires dès la constitution d’États-nations dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Les États ne se définissaient plus à travers une dynastie (et ses armoiries) à l’égard de laquelle la loyauté était un devoir. Le point décisif fut le transfert de la souveraineté de la personne du monarque à la nation ainsi que la garantie des droits fondamentaux par une constitution. Les nouveaux États-nations, obligés de créer un sentiment d’appar-tenance, se servirent de toute une série d’instruments à cet effet. Anne-Marie Thiesse a établi une liste des éléments utilisés pour créer des identités nationales : « une histoire établissant la continuité avec les grands
ancêtres, une série de héros parangons des vertus nationales, une langue, des monuments culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité particulière » et nomme enfin « des représentations officielles – hymne et drapeau – [...]2. » Aux symboles nationaux incombe une fonction centrale parce qu’ils donnent à voir d’une manière marquante les valeurs et les contenus de l’autodéfinition politique d’une communauté à travers lesquels les citoyens connaissent et reconnaissent leur identité politique. Ces symboles omniprésents et facilement identifiables, contribuent à « former les âmes », pour reprendre une expression de l’historien brésilien José Murilo de Carvalho3.
La réalité constitutionnelle dans l’empire du Brésil
Cet article se consacre aux symboles nationaux du Brésil pour saisir la présence d’une tradition européenne, mais aussi les éléments authentiquement nationaux qui nous frappent plus aujourd’hui. La république, qui ne s’est constituée au Brésil qu’en 1889, a dû se doter de nouveaux symboles politiques. Mais cette république ne fut pas une rupture fracas-sante avec le régime antérieur, l’empire du Brésil, qui n’était pas un « Ancien Régime », mais s’était formé avec l’indépendance du Brésil en 1822. On a parlé pour cette raison d’« un processus insolite d’émancipation »4 et d’« une émancipation atypique »5.
Le Brésil : un État-nation à construireLe rôle des symboles nationaux : de l’empire à la république
Joseph Jurt
46
6. a. Enders, Histoire du Brésil…, op. cit., p. 25.7. Patricio Nolasco, « L’état de l’État-nation : une approche de la question brésilienne », Lusotopie, 1997, p. 114.
8. Homogénéité de formation (une immense majorité issue des quelques institutions universitaires du Brésil qui remplacent progressivement le séjour à Coimbra) et d’origine sociale (le plus
souvent des propriétaires exerçant une profession libérale), ibid., p. 115.9. Ibid., p. 110.10. Voir Walther L. Bernecker, Horst Pietschmann et Rüdiger Zoller, Eine kleine
Geschichte Brasiliens, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2000, p. 127.11. Luiz Felipe de alencastro, « Le versant brésilien de l’atlantique-Sud : 1550-1850 », Annales HSS, 2, mars-avril 2006, p. 369.
Pendant le conf lit militaire opposant la France napoléonienne à l’Autriche et à la Prusse, puis à l’Angleterre, le Portugal tenta de maintenir une position neutre. À la fin de 1807, Napoléon exigea du Portugal la fermeture de ses ports à l’Angleterre, pays avec lequel les relations commerciales étaient intenses. Après le refus opposé par la cour de Lisbonne, les troupes françaises envahirent le Portugal. La veille de leur entrée dans Lisbonne, Dom João, le prince-régent, quitta le pays avec sa cour et son administration (entre 8 000 et 15 000 personnes) pour gagner Rio de Janeiro qui allait devenir la capitale de l’Empire portugais.
À la suite des révolutions libérales à Porto et à Lisbonne en 1820, l’Assemblée constituante portugaise entendit mettre fin à la dépendance du Portugal à l’égard de la cour de Rio et exigea le retour du roi João VI en métropole. Ce dernier revint en juillet 1821, son fils aîné, Dom Pedro, restant au Brésil et y assurant la régence. Le Portugal voulait adminis-trer l’ensemble de nouveau depuis la métropole et annonça l’envoi de troupes au Brésil. Là, on redoutait un retour à l’ancien statut colonial et la perte de la liberté commerciale, d’autant plus que les cortes portu-gaises exigeaient le retour immédiat de Dom Pedro. Celui-ci, qui avait dix ans lors de son arrivée au Brésil en 1808, s’était attaché à son nouveau pays et à la suite de la campagne en faveur de son maintien au Brésil, il répondit, le 9 janvier 1822, résolument « Fico » (« Je reste »). Lorsqu’il apprit sur les rives de l’Ipiranga, au sud de São Paulo, que les cortes entendaient mettre fin à ses pouvoirs, il lança, le 7 septembre 1822, le célèbre grito de Ipiranga (« le cri d’Ipiranga » : « l’indépendance ou la mort !». Le 1er décembre 1822 il fut couronné empereur du Brésil sous le nom de Pedro Ier. Le royaume du Brésil se transforme ainsi en empire. L’idée impériale s’alliait à l’indépendance ; elle semblait en mesure « de conci-lier l’Ancien Régime et la Révolution, la continuité dynastique avec les Bragance et l’avènement d’une nouvelle Nation »6.
L’indépendance n’était naturellement pas due à la seule initiative de Dom Pedro. Elle n’émanait pas non plus, comme ce fut souvent le cas en Europe, d’un sentiment national suscitant l’idée de l’apparte-nance à une nation commune. Ainsi, Patricio Nolasco souligne l’importance de la volonté d’autonomie qui habitait les élites provinciales, mais aussi un élément complémentaire, manifeste surtout dans la capitale, qui aurait joué un rôle crucial dans le rassemblement
pour l’indépendance : « La question du retour du roi au Portugal. Le retour de la cour à Lisbonne, conjugué avec le maintien d’une forme de souveraineté portu-gaise sur le Brésil, aurait en effet profondément affecté les groupes sociaux qui avaient construit leur existence autour de la cour à Rio de Janeiro […]. C’est auprès de ces groupes, formés par des hommes souvent nés au Brésil, que la volonté d’indépendance, dans l’unité, était la plus marquée7. » Il s’agit ici, selon le même auteur, du groupe des « serviteurs de l’État » au sens le plus large dont l’homogénéité de recrutement a pu atténuer les clivages8.
D’autres facteurs ont pu favoriser l’indépendance. Derrière la façade unitaire se profilait l’autonomie des différentes provinces qui semblait être mieux garantie par Rio que par le gouvernement portugais. Le principal point commun aux différentes régions brésiliennes était la stratification sociale profondé-ment inégalitaire reposant sur l’esclavagisme. Patricio Nolasco se demande si l’esclavage n’a pas été, malgré l’exclusion qu’il véhicule, « un des piliers de l’unité brésilienne que l’on prétend nationale : l’indépen-dance et l’unité brésiliennes sous la souveraineté d’un empereur, fils du roi du Portugal, apparaissent moins comme l’éveil d’une conscience nationale uniformé-ment partagée que comme un compromis entre les désirs d’autonomie et de stabilité des provinces – plus exactement de ceux qui les dominent – craignant avant tout que l’on ne perturbe l’ordre9. »
L’un des supports du mouvement indépendantiste avait été la couche des grands propriétaires qui enten-daient obtenir l’indépendance tout en maintenant les structures sociales et économiques existantes. La personne du monarque fonctionnait comme symbole d’identification et comme garant de la stabilité sociale10. Affichant ses liens avec les dynasties européennes et son statut de seule monarchie américaine, « alliée de la “politique européenne” contre la “politique américaine” (républicaine), la stratégie de Pedro Ier [et de son successeur] consistait à tergiverser devant les pressions britanniques [demandant l’abolition de l’esclavage] pour apparaître aux oligarchies régionales comme leur mandataire privilégié auprès des autres monarchies européennes11. »
Dans l’Assemblée constituante de 1823 et plus tard au Parlement s’esquissèrent au Brésil trois courants politiques importants : d’abord les exaltados qui adoptèrent une attitude assez critique à l’égard de l’empereur et de la monarchie, sans être pourtant
Joseph Jurt
47
Le Brésil : un état-nation a construire
12. D’après Eckhard Rumpf, „Unterent-wicklung der politischen Parteien und der Dominanz Eliten in Brasilien“, thèse, Berlin, Freie Universität Berlin, 2004, p. 24.13. Benjamin Constant, écrits politiques, Paris, Gallimard, coll. Folio/Essai, édition de Marcel Gauchet, Paris, 1997, p. 322-337 : « De la nature du pouvoir royal
dans une monarchie constitutionnelle ».14. au sujet du règne de Pedro II, voir aussi Lilia Moritz Schwarcz, As barbas do impera-dor. D. Pedro II, um monarca nos trópicos, São Paulo, Companhia das Letras, 1999.15. Voir Júlio Bandeira, Pedro Martins Cal-das xexéo et Roberto Conduro, A Missão Francesa, Rio de Janeiro, GMt Editores, 2003.
16. Beaucoup de portraits de Debret sont reproduits dans le volume A Missão Francesa (p. 25-41). Mais Debret a laissé de plus beaucoup d’images « ethnogra-phiques » de la vie quotidienne à Rio qu’il publiera dans un ouvrage comportant trois volumes : Voyage pittoresque et historique au Brésil, ou séjour d’un artiste
français au Brésil (Paris, Firmin Didot Frères, 1834-1839) qu’il publiera après son retour à Paris en 1831. Voir aussi xavier-Philippe Guiochon, « Le Brésil face au regard artistique français : Debret et la Mission artistique de 1816 », Cahiers du Brésil contemporain, 23-24, 1994, p. 39-58.
un groupe très important. Les gouvernements furent dirigés à tour de rôle par les moderados (ou libéraux) et les conservadores. Les premiers approuvaient la monarchie, mais entendaient limiter les préroga-tives du monarque par un cadre constitutionnel ; les conservadores, en revanche, approuvaient sans hésiter l’ensemble des prérogatives de l’empereur que celui-ci avait définies à travers la charte « octroyée » en 182412.
Si la pensée politique dans l’empire du Brésil s’inspirait fortement du modèle de la monarchie constitutionnelle britannique, on accordait pourtant à l’empereur une fonction prééminente. Le texte de la charte s’inspirait du concept de « Pouvoir modéra-teur » (Poder Moderador) contenu dans les Principes politiques que Benjamin Constant avait rédigés pour le Napoléon des Cent Jours. Le « pouvoir royal » y est défini comme un pouvoir neutre, arbitre des autres pouvoirs et devant veiller à leur équilibre13. Cette fonction de contrôle constituait de facto un quatrième pouvoir à côté des trois pouvoirs classiques. L’empe-reur pouvait nommer les sénateurs ; il disposait du droit de dissoudre l’Assemblée ainsi que d’un droit de nomination aux charges publiques. En 1831, face à une opposition grandissante contre son gouverne-ment très lusophile, Dom Pedro Ier abdiqua, regagna le trône du Portugal et fit proclamer empereur son fils Pedro né en 1825 au Brésil. Celui-ci n’ayant que cinq ans, le pouvoir fut confié d’abord à une triade de régents. Pedro II règnera à partir de 1840, et ce pendant 49 ans, en s’appuyant pleinement sur la charte de 182414.
Les positions des partis dominants n’étaient pas seulement marquées par leur attitude face aux prérogatives de l’empereur, mais également par leur attitude envers l’État central. Les branches tradi-tionnelles du secteur économique (les latifundistes et les commerçants tournés vers l’exportation) ainsi que la haute administration étaient en faveur de la conception « centraliste » de l’État prônée par les conservateurs. L’agriculture tournée vers la consom-mation locale ainsi que les producteurs de café des provinces de São Paulo et du Minas Gerais plaidaient plutôt pour l’autonomie régionale et se sentaient donc plus proches du parti libéral ; les intellectuels des professions libérales et la classe moyenne des villes optaient également pour les libéraux parce que ceux-ci
défendaient les libertés individuelles. Les deux camps, en lutte continuelle, forgèrent pourtant, entre 1853 et 1862, une coalition (conciliação), à l’intérieur de laquelle les conservateurs donnaient le ton.
La symbolique politique de l’empire du Brésil
Le Brésil ne se trouvait plus sous un statut colonial depuis 1815, avant d’atteindre en 1822, son indépendance complète, reconnue en 1825 par le Portugal, se consti-tuant ainsi comme un nouvel État-nation. En l’absence d’une conscience nationale largement répandue, la référence à la nation était étroitement associée à la création de l’État. Les élites politiques avaient dans ce contexte le plus grand intérêt à construire un ordre symbolique apte à exprimer une identité nationale.
Joachim Lebreton (1760-1819) était devenu premier secrétaire de l’Académie des beaux-arts de Paris sous le Premier Empire. Privé de ses fonctions à la Restau-ration, Lebreton, comme beaucoup d’autres membres de l’Académie, souvent bonapartistes, dut s’exiler. Début 1816, il arriva à Rio de Janeiro avec un groupe relativement important d’anciens membres de l’Acadé-mie des beaux-arts, parmi lesquels figurait également le peintre d’histoire Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Ce groupe, appelé la Missão Artística Francesa, joua un rôle important dans la nouvelle vie culturelle brési-lienne introduisant le style néo-classique dans un Brésil marqué jusque-là par le baroque colonial15. L’influence économique de la Grande-Bretagne, prédominante à partir de 1815, allait être en quelque sorte compensée par l’activité culturelle des Français. En août 1816, João VI signa le décret créant une École royale des arts et des sciences (Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios) à l’intérieur de laquelle les Français jouèrent un rôle important.
Le peintre Jean-Baptiste Debret, neveu et élève de David, fut chargé de mettre sur pied l’académie de peinture et, étant en contact avec Pedro Ier avant son couronnement, il devint un des peintres préférés de la cour impériale16. Pedro Ier le chargea de dessi-ner pour l’empire indépendant du Brésil un drapeau destiné à devenir le symbole de la nation en voie de constitution. La proposition de Debret consistait en un rectangle vert au centre duquel figurait un losange
48
17. L. F. de alencastro, « Le versant brésilien de l’atlantique-Sud… », art. cit., p. 373. 18. Ibid., p. 373. 19. Ibid., p. 377.
jaune. Le vert correspondait à la couleur de la dynastie de Pedro, les Bragance, et le jaune à celle de sa femme, les Habsbourg.
Le drapeau symbolisait donc la tradition dynastique et non le vert des forêts amazoniennes ni l’or du sous-sol comme on le réinterprétera plus tard. Sur le losange jaune se trouve un écusson bleu avec la sphère armil-laire sur une croix rouge de l’Ordre du Christ, entourée d’un anneau d’azur chargé de vingt étoiles d’argent, ceinte de deux branches (l’une de caféier, l’autre de feuilles de tabac). La sphère armillaire, figurant la sphère céleste locale, aussi connue sous le nom d’« astro-labe sphérique », se trouvait dès 1645 sur le drapeau du Principado do Brasil. L’écusson ainsi que la forme typique de la couronne impériale renvoyaient à la tradition portugaise. Les vingt étoiles rappelaient les vingt provinces du Brésil tandis que les deux branches nommées plus haut évoquaient la réalité agricole brési-lienne. Le drapeau du Brésil se distingue ainsi dès l’indé-pendance par son profil spécifique avec les deux couleurs vert et jaune et la forme losangée. Dans sa structure de base, il ne variera plus.
L’histoire de l’hymne national n’offre pas la même continuité. L’empereur Pedro Ier avait composé lui-même la musique d’un hymne sur des paroles d’Evaristo da Veiga sous le titre de Hino constitucional Brasiliense, rebaptisé en 1822 Hino da Independência do Brasil. Après l’abdication de Pedro Ier (1831) cet hymne fut abandonné. L’un des compositeurs brésiliens les plus connus, Francisco Manuel da Silva, élève du compo-siteur Sigismund von Neukomm (lui-même élève de Haydn et membre de la Mission artistique française), avait proposé dès 1822 un autre hymne, une marche patriotique composée dans le style du romantisme italien, avec des paroles d’Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva. Il sera vite très populaire. Adapté avec de nouvelles paroles du poète Joachim Osório Duque Estrada après le départ de Pedro Ier, on ne le dénomma pas hymne national mais Hino do 7 de abril (1831), par référence au jour de l’abdication de Pedro Ier, ou simplement Marcha Triunfal. Sous Pedro II ce nouvel hymne fut joué lors d’événements solennels sans les paroles pourtant, jugées trop hostiles à Pedro Ier et au Portugal. Son entraînante mélodie, en revanche, resta très populaire, au-delà du régime impérial.
L’abolition de la traite, l’immigration et la naissance d’un « nationalisme d’État »
La période de l’empire a été relativement limitée en symboles, l’empereur lui-même, garant de l’unité nationale, en étant le symbole le plus important. Cette unité était
cependant menacée à cause des grandes inégalités sociales et du maintien du système esclavagiste. La reconnaissance de l’indépendance du Brésil par le Royaume-Uni fut soumise à la condition du respect de l’embargo sur le trafic d’esclaves. Le Brésil temporisa en avançant qu’un arrêt « précipité » de l’importation d’esclaves mettrait en danger l’existence même de l’État du Brésil. En 1831, une loi fut adoptée pour répri-mer le trafic d’esclaves, mais elle ne fut pas appliquée. Le gouvernement britannique revint alors plus ferme-ment à la charge. Conformément à la loi Aberdeen, les trafiquants, assimilés à des pirates, furent poursuivis jusque dans les ports brésiliens et traduits devant les tribunaux de la marine britannique. Le ministre de la Justice, Eusébio de Queirós, descendant d’une famille portugaise d’Angola, fit alors voter, le 4 septembre 1850 par le Parlement une loi arrêtant définitivement la traite. Les Africains saisis par les autorités deviendront les « esclaves de la Nation » et seront placés sous la tutelle de l’État. Pour Luiz Felipe de Alencastro cet arrêt irréver-sible de la traite était une « seconde naissance de l’État brésilien »17, il avança une explication à ce changement d’attitude : « L’assimilation, par le Bill Aberdeen, de la traite brésilienne à la piraterie rabaissait l’empire au rang des “nations barbaresques” donnant un tour concret à la menace d’intervention britannique. Ce glissement catégoriel discréditait la caution civilisatrice que la monarchie des Bragance prétendait assurer au pays. La double attribution de la Couronne – pouvoir central dans l’espace national et mandataire des oligarchies régionales auprès des cours européennes – se trouvait atteinte dans sa consubstantialité politique18. »
En complément à l’économie esclavagiste, il y eut dès les années 1820 une immigration européenne ; des terres publiques furent distribuées à des colons européens dans des zones menacées par des tribus indiennes ou par des Marrons. Le roi João VI ne croyait plus à l’exploitation des mines d’or, mais misait sur l’agriculture et, sachant le système esclavagiste condamné à long terme, il souhai-tait des hommes libres pour peupler ses terres. Alors que les planteurs souhaitaient avoir une main-d’œuvre qui pourrait prendre la relève des esclaves après l’abolition de la traite, l’administration impériale, l’intelligentsia et une partie de la population urbaine, « soucieuses de la composition sociale et culturelle de la nation », « cherchaient à faire de l’immigration un instrument de la “civilisation”, autrement dit du blanchiment du pays19. » Les immigrants ne contribuèrent cependant pas plus que l’abolition de l’esclavage à une homogénéisation ethnique et culturelle du pays. « Creusée par l’esclavage, puis par l’arrivée d’immigrants européens, levantins et asiatiques, ses disparités culturelles conduisent
Joseph Jurt
49
20. Ibid., p. 382.21. B. Bennassar et R. Marin, Histoire du Brésil…, op. cit., p. 246.22. Wilma Peres da Costa, A Espada de Dâmocles: o Exército, a Guerra do
Paraguai e a crise do Império, São Paulo, Hucitec/Unicamp, 1996 (je dois cette remarque à afrânio Garcia).23. D’après W. L. Bernecker, H. Pietsch-mann et R. Zoller, Eine kleine Geschichte
Brasiliens, op. cit., p. 165.24. Edouardo Bruno, Brasil: uma História, São Paulo, atica, 2003, p. 239-240.25. Gilberto Freyre, Casa-grande e senzala: formação da família brasileira
sob o regime da economia patriarcal, Recife, Imprensa oficial, 1966, p. 521.26. Luciana Stegagno Picchio, La Littéra-ture brésilienne, Paris, PUF, 1981, p. 27.
les classes dirigeantes à s’unir dans un “nationalisme d’État”, dont le corollaire est la reconstruction de la société : puisque l’organisation du travail dans les latifundia incorpore continuellement des étrangers, déstructurant le corps social, les hauts commis, les lettrés, les inten-dants – l’intelligentsia étatique et paraétatique […] – s’adjugent la mission historique de civiliser la nation20. » Cette élite était convaincue que c’est en premier lieu par des structures étatiques que l’on pouvait construire une certaine unité de la nation, d’où l’importance des symboles de l’État devant exprimer cette unité ou plutôt contribuer à la créer.
Mais un autre groupe social devait jouer dans ce contexte un rôle important : l’armée, notamment après la guerre de la Triple Alliance (1865-1870), qui opposa le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay au Paraguay, conduisant à des pertes énormes du côté de ce dernier qui perdit les deux tiers de sa population ; pendant cette guerre, tous les projets de réforme que l’empereur avait esquissés furent ajournés et les libéraux renforcèrent leur opposition au régime. Cette guerre du Paraguay suscita cependant des modifications importantes de la société brésilienne. Depuis la création de la Garde nationale en 1831, l’armée n’avait occupé qu’une place marginale dans la société brésilienne. Cela allait changer avec la guerre qui créa un esprit de corps militaire jusque-là inexistant au Brésil21. Wilma Peres da Costa, dans A Espada de Dâmocles, souligne que la frustra-tion des officiers était alimentée par leur opposition à la Garde nationale qui assurait des milices armées aux mains des élites agraires et de maîtres d’esclaves. L’esprit de corps de l’armée, seul corps en dehors du clergé catholique, à être structuré dans tout le territoire, visait aussi à assurer la monopolisation des instruments de violence légitime22. S’il existait quelques grandes familles de militaires comme les Fonseca, et si, dans les années 1920-1930, une bonne partie des étudiants des écoles militaires était issue des élites agraires menacées de déclin, l’institution s’ouvrit dans la deuxième moitié du XIXe siècle à des couches sociales plus modestes, les officiers provenant alors souvent de la petite bourgeoisie urbaine qui se défiait des professionnels de la politique. De plus il y eut au sein des troupes des esclaves affran-chis grâce au service militaire. À la suite de la guerre du Paraguay, l’armée acquit une place importante dans la société, avec sa situation particulière et son sentiment d’être dotée d’une vocation messianique à l’égard de la nation, elle devint un facteur décisif. Elle se présenta et se considéra désormais comme garante de l’intégrité
nationale et comme une institution au sein de laquelle les Brésiliens étaient présents indépendamment de leur origine ethnoculturelle23.
L’armée était pourtant loin d’être une unité cohérente. À l’intérieur de l’institution, deux factions s’étaient développées. Il y avait d’une part les militaires traditionnels qui s’étaient formés « sur le tas », et de l’autre les jeunes officiers, issus de l’Académie militaire de la Praia de Vermelha de Rio, qui était pour eux le « tabernacle de la science »24. On y ensei-gnait autant la philosophie et les mathématiques que la stratégie militaire. La formation privilégiait les matières scientifiques, surtout les mathématiques, et la carrière d’ingénieur était liée à celle d’officier. Ainsi la « jeunesse militaire » était-elle ancrée dans un genre de formation qui semblait s’opposer fortement aux « études littéraires » des écoles de droit où était formée la plupart de l’élite politique.
À la recherche d’un mythe littéraire des origines
Le régime entendait également contribuer à la naissance d’un sentiment national par des moyens culturels. En 1838 fut créé sur le modèle français de l’Institut historique l’Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro qui publia une revue très remarquée. L’empereur assista à maintes reprises aux réunions de cet insti-tut. C’est dans ce contexte que Francisco Adolfo de Varnhagen publia en 1854 une monumentale histoire du Brésil (História geral do Brasil) qui devait esquisser le fondement de la nation.
Dans le domaine littéraire, on favorisait un roman-tisme conservateur qui se distinguait de la tendance néo-classique du Portugal. À l’instar d’autres nations, on cherchait un fondement à travers la construction d’un passé, d’une origine, que l’on reliait au peuple autoch-tone, les Indiens. Ce phénomène ne fut pas unique-ment littéraire, selon Gilberto Freyre, on constata dès l’indépendance une vague indiophile et des membres de la noblesse rurale se donnèrent des noms indiens25. On procéda également à de premières recherches ethnographiques qui furent soutenues par l’empereur. La cour contribua à construire ce mythe, en témoigne un portrait de Pedro Ier que l’on doit à Jean-Baptiste Debret, représentant le monarque « vêtu du manteau jaune de plumes de toucan que portait Guatimozim, symbole d’une continuité historique qui relie ainsi les caciques indiens à l’empire. »26
Le Brésil : un état-nation a construire
50
27. Voir L. Moritz Schwarcz, As barbas do imperador…, op. cit., p. 132-134.28. L. Stegagno Picchio, La Littérature brésilienne, op. cit., p. 32.29. Voir L. Moritz Schwarcz, As barbas do imperador…, op. cit., p. 138-144 ; voir par exemple la sculpture Indio sim-bolizando a nação brasileira (1872) de Manuel Chaves Pinheiro.
30. antônio Carlos Gomes avait composé un opéra O Guarani, s’inspirant du roman de José de alencar, avec le soutien de Pedro II, opéra qui fut présenté à la Scala de Milan en 1870, correspondant parfai-tement à l’exotisme européen. En 1889, on demanda par ailleurs à Carlos Gomes de composer l’hymne de la République, ce qu’il refusa, voir E. Bruno, Brasil: uma
História, op. cit., p. 200.31. Roger Bastide, « Iphigénie en tauride ou agar dans le Désert ? Essai d’analyse critique des mécanismes de pénétra-tion culturelle au Brésil », in Idéologies, l i t térature et société en Amérique latine, Bruxelles, Institut de sociologie, 1975, p. 15.32. L. Stegagno Picchio, La Littérature
brésilienne, op. cit., p. 32.33. P. Nolasco, « L’état de l’État-nation… », art. cit., p. 117.34. Ibid., p. 118. Cette reconnaissance de l’apport de la population « de couleur » ne sera acquise qu’avec les travaux du sociologue Gilberto Freyre et notamment son ouvrage fondamental Casa-Grande e senzala (1933).
C’est l’intelligentsia française qui encouragea les Brésiliens à représenter leur particularité culturelle à travers une littérature indianiste idéalisant l’indi-gène candide, le bon sauvage américain. À Paris, de jeunes Brésiliens avaient créé dès l’indépendance du Brésil la revue Niterói et s’étaient choisi Gonçalves de Magalhães comme leader. Il sera l’un des initiateurs de l’indianisme littéraire. En 1856, il publia le poème épique en dix chants A Confederação dos Tamaios qui évoque la révolte indienne de 1506. Il avait conçu le livre comme une épopée nationale mettant au centre des héros indigènes se distinguant par leur héroïsme. Tentant d’allier une vision romantique avec le résultat des recherches historiques, il entendait prouver qu’il était possible de dépasser les spécificités régionales par un mythe fondateur national. Le livre était dédié à l’empereur Pedro II ; si les Portugais colonisateurs y apparaissaient comme de « vilains » conquérants, l’Empire brésilien était présenté comme un règne de la liberté qui protège la population autochtone27.
En poésie lyrique, Gonçalves Dias chanta dans ses recueils (Primeiros cantos, 1847 ; Segundos cantos, 1848 ; Ultimos cantos, 1851) l’héroïsme et les sacrifices des Indiens tupi, les présentant comme des modèles animés par le sens de l’honneur. L’Indien, rebelle au joug portugais, devint pour l’idéologie romantique du Brésil impérial l’équivalent stylistique d’un Ossian européen28.
Mais l’auteur le plus connu qui illustre le mythe indianiste est José de Alencar. Ses deux livres les plus remarqués ont été O Guarani (1857) et Iracema (1865). Dans le premier, il évoque Peri, un Indien de la première phase de la colonisation, s’alliant à la fille d’un Portugais qui l’admire comme le noble et souverain maître de la nature exubérante du Brésil. Au centre d’Iracema, une jeune indienne est aimée d’un guerrier portugais ; de leur alliance naît un peuple nouveau. La mort de l’héroïne est présentée comme la rançon pour ce nouveau peuple qui est en train d’émerger.
La présentation de l’indien comme symbole national a été assez répandue, notamment auprès d’une élite proche de la cour. Cette projection littéraire dans le passé (qu’on trouvait aussi dans les arts visuels29 et même en musique30) n’avait rien à voir avec la situation présente du pays. L’indianisme brésilien de l’époque romantique est certes, selon Roger Bastide, l’expression d’une « volonté de rupture avec le Portugal et d’enracinement
dans le pays », mais avec des Gonçalves Dias et José de Alencar ce n’est que la création « d’un Indien mythique, genre Chateaubriand ou F. Cooper, tandis que l’Indien réel est exploité et refoulé ou exterminé31. »
Si l’Indien idéalisé est pour le romantisme brésilien le véritable protagoniste de l’histoire du pays, c’est cepen-dant contre toute vraisemblance historique, « puisque le pays est infiniment plus marqué par la présence active du Noir et du Métis que par un Indien défini-tivement arraché à tout contexte sociologique. »32 Si Bernardo Guimarães évoque dans son roman A escrava Isaura (1875) le destin d’une esclave qui s’était évadée et qui sera libérée par un jeune noble qui l’épou-sera, cette figure n’est pas décrite comme une représen-tante des Noirs, mais comme une « mulata clara » (noire d’origine, mais blanche de peau et d’éducation).
Si tout État-nation suppose, selon Patrice Nolasco, au moins la croyance en une identité nationale rassem-blant la population de l’État, « force est donc de constater que l’exclusion et les préjugés qui frappent la majorité de la population du Brésil y posent un problème majeur. En d’autres termes, l’identité brésilienne ne pouvait indéfiniment se construire en excluant la communauté noire à partir du moment où la revendication de son intégration sociale acqué-rait un impact politique considérable. Devenant au moins formellement partie constitutive de la nation, la population noire devait aussi “se retrouver” dans l’identité brésilienne imaginée33. » Or ceci était loin d’être acquis. Si les positivistes vont se réclamer de la fusion des trois races, ils la prévoient comme un processus à long terme34. Les partisans de la république ne se référeront plus à un mythe d’origine, mais partiront plutôt de la situation actuelle, tout en esquissant un mythe de l’avenir.
Des conceptions variées de la république, positivistes, libérales ou jacobines
Un groupe de jeunes officiers, la mocidade militar défendait majoritairement des idées républicaines et positivistes, avec à sa tête Benjamin Constant Botelho de Magalhães (1836-1891), professeur de mathéma-tiques et directeur de l’École militaire dès 1872, après avoir exercé un commandement en tant qu’ingénieur lors de la guerre du Paraguay. Excellent connaisseur
Joseph Jurt
52
35. Voir J. Murilo de Carvalho, A Formação das Almas…, op. cit., p. 27-29. 36. Ibid., p. 111.
de la philosophie positiviste d’Auguste Comte, il avait fondé en 1876 la Société positiviste du Brésil et il initiait des promotions entières de futurs officiers à ces nouvelles idées.
Lorsque le gouvernement élabora en 1883 une loi qui semblait léser leurs intérêts, les vétérans de la guerre du Paraguay et les jeunes émules de Benjamin Constant (ainsi le nommait-on en abrégé) se liguèrent et la « question militaire » commença à occuper le devant de la scène. Deodoro da Fonseca (1827-1892), héros de la guerre du Paraguay, et Benjamin Constant fondèrent alors le Clube Militar. Cette alliance de deux tendances de l’armée fut une première étape vers la proclama-tion de la république. Les positivistes s’opposaient à la monarchie parce que celle-ci relevait du stade théologique, selon la théorie des trois stades d’Auguste Comte, alors que la république était considérée comme la forme d’État de la troisième phase, la phase positi-viste. Dans la formation des jeunes officiers, la compo-sante technico-scientifique primait. L’école militaire se sentait pour cette raison proche de l’idée comtienne d’une « dictature républicaine » qui devait œuvrer en faveur d’un développement industriel du Brésil35. Le positivisme reçut nombre d’adhérents provenant non seulement de la mocidade militar, mais également, dans les provinces au sud du pays, de Rio de Janeiro jusqu’au Rio Grande do Sul, des classes moyennes, des universités et des académies.
Par ailleurs dans la société civile deux courants étaient également proches de l’idée républicaine. D’une part, il y avait l’oligarchie des planteurs de café de l’État de São Paulo qui ne voyait pas sauvegardés ses intérêts par l’État central. Ces planteurs plaidaient pour une structure fédérale du Brésil. Leur philoso-phie était celle d’un libéralisme économique : le bien public étant considéré comme la somme des biens particuliers. Ce groupe s’inspirait du modèle des États-Unis, mais il oubliait que la société coloniale de l’Amérique du Nord était beaucoup plus égalitaire, alors que leur idéal « républicain » de planteurs de café consistait à cimenter une société extrêmement inéga-litaire. Parmi les membres du Partido Republicano Paulista, fondé en 1873, la majorité était composée de grands propriétaires.
Le républicanisme s’était cependant d’abord manifesté dans la capitale avec le Partido Republicano qui y avait lancé son manifeste dès 1870. Les membres de ce courant de Rio de Janeiro se recrutaient parmi les professions libérales et la presse, ils s’inspiraient du concept jacobin de la république se réclamant des principes (restés relativement abstraits) d’égalité et de liberté. L’État fort était pour eux l’instrument
décisif pour réaliser leurs buts politiques. Ce groupe relativement restreint était le seul à envisager la parti-cipation du peuple aux affaires politiques.
La guerre des symboles dans la république proclamée
L’empire fut renversé dans la nuit du 14 au 15 novembre 1889 essentiellement par un groupe de militaires qui n’était pas particulièrement républicain mais entendait défendre ses intérêts corporatistes face au gouvernement ; il lança son action en commun avec les républicains oligarchiques de São Paulo, hostiles à la monarchie à cause de l’abolition de l’esclavage (décrétée en 1888). Parmi les conspira-teurs se trouvait également Benjamin Constant, l’idole des cadres positivistes de l’École militaire ainsi que l’avocat bahianais Rui Barbosa qui était passé de l’abolitionnisme au fédéralisme. Le personnage le plus important, au moins du point de vue stratégique, était le chef de l’état-major de l’armée, le maréchal Manuel Deodoro da Fonseca, qui entendait surtout empêcher que son ennemi intime Gaspar Silveira Martins soit nommé chef du gouvernement. Au petit jour du 15 novembre, Deodoro da Fonseca fit envahir la salle du Conseil des ministres par ses soldats et contraignit le cabinet à la démission. Cédant à la pression des républicains, le maréchal proclama la « république des États-Unis du Brésil », du haut du balcon du conseil municipal de Rio alors que la foule enton-nait La Marseillaise. L’empereur et sa famille partent en exil le 17 novembre, d’abord au Portugal puis à Paris où l’empereur mourut en 1891.
La république proclamée par des républicains « de la onzième heure » sans participation directe du peuple se devait d’exprimer sa légitimité à travers des symboles. Les symboles officiels essentiels, le drapeau et l’hymne national, devant être fixés par des décrets. Dans ce contexte eut lieu une « guerre de symboles », portant sur l’interprétation et le programme qu’on entendait donner à la république. Dès la procla-mation de la république apparut un nouveau drapeau des États-Unis du Brésil : une version verte et jaune du Stars and Stripes nord-américain avec vingt étoiles sur un carré noir. Le drapeau qu’on nommera plus tard le « drapeau de la proclamation » flotta au moins jusqu’au 19 novembre au mât d’un bâtiment de la Câmera Municipal de Rio de Janeiro36. Le modèle des républicains de Rio avait été plutôt la République française ; mais il s’agissait par-là peut-être de gagner la faveur des libéraux de São Paulo qui s’inspiraient du modèle nord-américain.
Joseph Jurt
53
37. auguste Comte, Système de politique positive ou traité de sociologie, instituant la religion de l’humanité. t. I, Paris, Librairie scientifique industrielle de L. Mathias, 1851, p. 387.38. Ibid., p. 388.39. Pour une certaine élite brésilienne, la science devient la valeur-clé devant contribuer à la modernisation et à l’indus-
trialisation du pays, voir Raymundo Faoro, Existe um pensamento político brasileiro?, São Paulo, atica, 1994, p. 102-108.40. D’après J. Murilo de Carvalho, A Formação das Almas…, op. cit., p. 40.41. Sur les liens entre le positivisme et la (troisième) République française, voir aussi Claude Nicolet, L’Idée répu-blicaine en France (1789-1924). Essai
d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982, p. 249-280 : « Idéalisme, positivisme et République ».42. Le Brésil devint donc un État fédéral avec vingt États ; les anciennes provinces obtenaient de nouvelles compétences. La constitution promulguait la sépara-tion des pouvoirs entre une haute cour de justice, le Sénat et le président. Il
n’y avait plus ce « quatrième pouvoir » attribué à l’empereur dans la constitution antérieure ; mais dans la pratique l’armée intervint à maintes reprises comme « pou-voir modérateur », voir W. L. Bernecker, H. Pietschmann et R. Zoller, Eine kleine Geschichte Brasiliens, op. cit., p. 216.
Les positivistes et notamment Teixeira Mendes, de l’Église positiviste, s’indignèrent de ce drapeau si peu national. Ils chargèrent le peintre Décio Villares de dessiner un modèle alternatif à proposer au Gouvernement provisoire, par l’entremise de Benjamin Constant. Les positivistes suivirent presque textuellement la conception d’Auguste Comte en ce qui concerne l’idée du drapeau, la philosophie positiviste de l’État entrant ainsi dans la symbolique politique du Brésil. Aux yeux de Comte, l’Occident se trouvait à un passage « organique » du stade métaphysique vers le stade industriel-scientifique et il avait conçu l’iconographie politique correspondant à ce passage. Il propose ainsi dans son Système de politique positive un drapeau pour l’État positiviste de l’Occident censé dépasser les États nationaux. Il conçoit d’abord une « bannière religieuse » contenant « la formule sacrée des positivistes : L’Amour pour principe, l’Ordre pour base, et le Progrès pour but, sur un fond vert, couleur naturelle de l’espérance, propre aux emblèmes de l’avenir »37 et ensuite le « drapeau politique » : « La formule fonda-mentale s’y décompose, sur les deux faces vertes, dans les deux devises qui caractérisent le positivisme : l’une politique et scientifique, Ordre et progrès ; l’autre morale et esthétique Vivre pour autrui38. » Le modèle positiviste résumé par la devise « Ordem e Progresso » signifiait un nouveau départ national, une dernière étape de l’évolu-tion civilisatrice et non pas une rupture révolutionnaire39.
Dans le nouveau projet de drapeau réalisé selon les indications de l’« Apôtre » positiviste, Teixeira Mendes, on maintenait le fond vert, le losange jaune et la sphère bleue centrale pour signifier la transition entre le passé et le présent, mais on supprimait ce qui rappelait le régime impérial : la croix de l’Ordre du Christ, la sphère armillaire, la couronne impériale, mais aussi les branches de feuilles de tabac et de caféier, le progrès ne résidant plus, selon les positivistes, dans les grandes plantations, mais dans l’industrie et l’exploitation des ressources naturelles.
Sur le drapeau, à la place des symboles monarchiques Décio Villares propose une sphère bleue céleste constellée d’étoiles et entourée d’un bandeau avec la devise (positiviste) « Ordem e Progresso ». Les étoiles, de tailles différentes, ne sont pas placées selon un ordre symétrique comme sur le drapeau des États-Unis, mais représentent exactement la disposition des principales étoiles au-dessus de Rio le 15 novembre
1889, le jour de la proclamation de la république. Au centre de la sphère, la Croix du Sud (le Cruzeiro do Sul) qui, dès les premières grandes expéditions, avait été le point d’orientation dans les mers de l’hémisphère Sud.
Les étoiles ne reproduisaient pas seulement la sphère étoilée au moment de la proclamation de la république, elles symbolisaient en même temps les vingt États du Brésil conformément à leur taille et leur position. La correspondance entre microcosme (géographique) et macrocosme (céleste) vient de la philosophie d’Auguste Comte marquée par une vision « organique » de l’His-toire. Les couleurs du nouveau drapeau étaient certes celles de la Bandeira Impérial, mais on réduisit la dimen-sion du losange qui ne touchait plus le bord extérieur du drapeau. Malgré le nouveau dessin du symbole central, on est frappé par la continuité, d’abord celle des couleurs. La Croix du Sud renvoyait à la tradition des navigateurs portugais, cette idée de la continuité corres-pondait également à la philosophie de l’Histoire comme évolution, chère à Auguste Comte. Soulignons qu’on ne trouve en effet sur ce drapeau brésilien aucun rappel de la symbolique politique de la Révolution française.
Le drapeau républicain renoue donc au niveau des symboles avec la tradition antérieure, tout en étant marqué par la philosophie positiviste. On peut s’en étonner, les positivistes n’ayant pas joué un rôle décisif lors de la proclamation de la république. Les officiers placés sous l’égide de Deodoro da Fonseca ne plaidaient pour cette nouvelle forme d’État que pour restaurer le rôle de l’armée. En déclarant à la veille de la procla-mation de la république40 « La République, c’est le salut de l’armée », Deodora da Fonseca donnait une légiti-mation minimale et en même temps très particulariste, corporatiste, de la nouvelle forme de l’État.
Pour ce changement de régime inspiré par des motifs contingents, les positivistes disposaient, avec leur concept d’une évolution en trois stades, d’une « théorie » qui permettait d’interpréter le changement survenu41. Malgré beaucoup d’objections, notamment contre la devise « Ordem e Progresso », ils avaient réussi à imposer leur interprétation au plan de la symbolique politique. Ce qui frappait cependant c’est que la nouvelle constitution du Brésil de l’année 1891 suivait plutôt le modèle des États-Unis et non pas le concept de « dictature républicaine » d’Auguste Comte42.
Le Brésil : un état-nation a construire
54
43. Les quatre hymnes sont réunis sur le CD « Hinário Nacional » (Manaus, Festa Irineu Garcia). 44. Voir Bernard Richard, Les Emblèmes de la République, Paris, CNRS Éd., 2012, p. 77-124 : « Marianne, représentation féminine de la République en France ». 45. J. Murilo de Carvalho, A Formação das Almas…, op. cit., p. 77-96.
Le Brésil se dénommait pour cette raison « República dos Estados Unidos do Brasil » – une dénomination qui se maintint jusqu’en 1968 pour devenir « República Federativa do Brasil ». Le drapeau de la république de 1889 resta identique malgré plusieurs changements de régime et de constitution. La plupart des citoyens associèrent la devise « Ordem e Progresso » non pas vraiment à l’idée d’une « dictature républicaine », mais plutôt à un programme politique et économique qui entendait allier un programme droitier de l’« Ordre » avec l’option optimiste du « Progrès ». La Bandeira Brasileira est devenue dès 1889 le symbole essentiel du Brésil, son « emblème ».
Le deuxième symbole officiel important est l’hymne national. L’hymne impérial de 1831 (Hino do 7 de abril ou Marcha Triunfal) avait été très populaire. Dans le petit cercle des républicains de Rio, La Marseillaise avait la même qualité ; on la chanta ainsi le jour de la procla-mation de la république. Le gouvernement provisoire ouvrit fin novembre 1889 un concours pour trouver la meilleure mélodie pour un texte esquissé par Medeiros e Albuquerque. 36 compositeurs y participèrent ; c’est la composition de Leopoldo Miguez qui fut choisie. Le peuple avait cependant manifesté sa prédilection pour l’hymne impérial. Aussi, par le décret 171 du 20 janvier 1890, cet ancien hymne fut-il déclaré hymne national tandis que la version de Miguez fut déclarée Hymne de la proclamation de la république (Hino da Proclamação da República).
C’est donc l’hymne de 1831 qui devient hymne national. Joaquim Osório Duque-Estrada (1870-1927) rédigea en 1908 de nouvelles paroles qui furent déclarées texte officiel de l’hymne en 1922 à l’occasion du centenaire de l’indépendance. Ce nouveau texte évoque « le soleil de la liberté », liberté que le « peuple héroïque » avait conquise avec le « cri d’Ipiranga » et la « patrie bien-aimée, adorée » (« Pátria amada, idolatrada ») qui veille sur ses enfants comme une mère. On y mentionne aussi la justice et la Croix du Sud. On y évoque aussi le drapeau, mais Francisco Braga et Olavo Bilac composèrent en 1906 un hymne spécial en son honneur (Hino a Bandeira), soulignant ainsi la centralité de la Bandeira parmi les divers symboles nationaux43.
Une allégorie de la république ?
À côté des symboles officiels, il y eut d’autres tentatives de symbolisation politique. Dans un système monar-chique c’est le monarque qui incarne son pays, dans la république des personnifications ou des allégories
nationales assument cette fonction. En France, ce fut l’allégorie féminine de la liberté qui devint l’incarnation de la nation ; son enracinement dans la mémoire populaire se manifesta par le nom de « Marianne » que l’on rencontre massivement à partir du milieu du XIXe siècle. L’interprétation révolutionnaire de la figure est indiquée par le bonnet phrygien, l’interpré-tation plus consensuelle et modérée par la couronne, solaire ou végétale. En France, la figure de la liberté est devenue l’allégorie de la nation, justement parce que c’est la république et non pas la constitution, variable quant à elle, qui est l’expression représentative de l’identité nationale44.
Il y eut aussi au Brésil quelques tentatives pour représenter la république par une allégorie féminine. Mais ce ne furent souvent que de pâles imitations de la Marianne française. L’exemple le plus célèbre a été la « República » du peintre positiviste Décio Villares (le créateur du drapeau républicain de 1889), une femme en vert et jaune, coiffée d’un bonnet phrygien. Dans la salle des symboles de l’ancien palais présiden-tiel à Rio de Janeiro, devenu musée de la république, on trouve à côté du tableau de Décio Villares un buste de la république à bonnet phrygien, en bronze et marbre, œuvre du sculpteur français Paul-Louis Loiseau-Rousseau (1861-1927), « Marianne, símbolo da Repùblica ». Cette « Marianne d’intérieur » est très connue du public brésilien pour lequel elle a qualité d’icône républicaine.
Mais il n’y eut guère de tradition iconographique autonome au Brésil d’une figure unissant liberté, nation et république. Il y avait certes chez les positi-vistes une tradition de l’allégorisation de la femme, mais en tant qu’incarnation de l’humanité. Décio Villares esquisse ainsi en 1890 pour l’église positi-viste un drapeau pour les processions avec une figure maternelle aux traits de l’inspiratrice de Comte, Clotilde de Vaux, qui devait représenter l’humanité45. Il n’y eut pas au Brésil de tableaux illustres et célébrés comme que La Liberté guidant le Peuple (1831) de Delacroix ou La République (1848) de Daumier. La république comme femme apparaissait surtout dans la presse illustrée, notamment dans la Revista Illustrada à travers des gravures sommaires et un peu naïves. Au moment de la conclusion d’un contrat d’ami-tié entre le Brésil et l’Argentine en décembre 1889, on pouvait voir sur la couverture de la revue, deux femmes coiffées d’un bonnet phrygien, leurs drapeaux nationaux en main et tenant ensemble une pique surmontée par un bonnet phrygien. Dans le numéro du 21 juin 1890, une gravure représentait une jeune
Joseph Jurt
55
46. Reproduit in L. Moritz Schwarcz, As barbas do imperador…, op. cit., p. 476-477.47. J. Murilo de Carvalho, A Formação das Almas…, op. cit., p. 89-94.48. Voir Marie-Louise von Plessen (éd.), Marianne und Germania 1789-1889, Berlin, argon, 1996, p. 23.49. Cette répression brutale qui a fait plus de 15 000 victimes est restée
présente grâce à l’œuvre d’Euclides da Cunha, Os Sertões (1902), en français : Hautes Terres : la guerre de Canudos, Paris, Métailié, 1993. L’auteur a eu une formation d’ingénieur à l’École militaire de la Praia Vermelha ; républicain convaincu, il entendait contribuer par une littérature, fondée sur les sciences, à un avenir meil-leur. Il abandonna la carrière militaire pour se consacrer au journalisme et assista
comme reporter à la répression à Canu-dos. Dans ce « livre vengeur » il montrait aux intellectuels de la capitale un Brésil qu’ils méconnaissaient. Essai sociolo-gique, structuré comme une épopée, Os Sertões a été au fond « une anti-épopée d’un Brésil qui prend soudain une dou-loureuse conscience de son corps et de son identité », voir L. Stegagno Picchio, La Littérature brésilienne, op. cit., p. 74.
50. D’après Rafael alves Pinto Junior, « Manoel Lopes Rodrigues e a Alegoria da República (1896): do cotidiano da política à imortalidade do Panteão », 19&20, Rio de Janeiro, 5(4), août-décembre 2010. Disponible : http://www.dezenovevinte.net/obras/mlr_rapj.htm.51. Reproduit in L. Moritz Schwarcz, As barbas do imperador…, op. cit., p. 58.
République brésilienne regardant avec admiration la République française plus grande s’élançant sur un chemin couvert de roses46. La république sous les traits d’une femme apparaissait souvent dans des caricatures exprimant la déception face à cette nouvelle forme d’État représentée alors par quelques dessinateurs comme une prostituée47.
En 1895, le président de la République Prudente de Morais commanda auprès du peintre bahianais Manoel Lopes Rodrigues une image quasi officielle de la république. Le peintre, qui se trouvait depuis 1886 à Paris et comptait parmi ses maîtres Jules Lefebvre, s’inspira fortement de modèles français, notamment de la sculpture La République de Joseph Chinard (1794) montrant une femme hiératique, assise sur un trône représentant stabilité et sécurité48. La République de Manoel Lopes Rodrigues est égale-ment assise sur un trône, vêtue d’une robe blanche (renvoyant à la paix) et s’appuyant sur une épée. Le bonnet phrygien est entouré par une couronne de branches de caféier. Par là le peintre renvoie à la double tradition, française et brésilienne, alors que Décio Villares s’était contenté de vêtir la Marianne traditionnelle de vert. Aux pieds de la figure, on trouve les palmes de la victoire. Le fond est couvert par les armes du Brésil et le drapeau stylisé entouré d’une bande « Estados unidos do Brasil ». Le trône est orné de l’animal symbolique des Bragance, le serpent, suggérant ainsi l’idée que la république s’est instal-lée sur l’ancien trône monarchique. Mais la période de la présidence de Prudente de Morais (1894-1898) ne correspondait pas du tout à l’image d’une république stable et sereine suggérée par le tableau de Rodrigues. Le pays avait été ébranlé de l’extérieur par la chute des cours du café et à l’intérieur par la révolte millénariste de Canudos dans l’arrière-pays de Bahia, réprimée brutalement par l’armée (1896-1897)49. Cette allégorie de la république n’avait ainsi aucun impact sur l’imaginaire collectif et elle fut cantonnée plus tard dans le musée local de Bahia50.
S’il ne se développa guère au Brésil de tradition d’une allégorie féminine de la république, il y eut selon Murilo de Carvalho plusieurs raisons à cela. D’une part, la fonction de la femme comme symbole, dans ce pays très marqué par la tradition catholique, était déjà
occupée par la figure de Marie. Comme la république imposa, conformément au programme de laïcisation des positivistes, la séparation entre Église et État, les milieux ecclésiastiques opposèrent avec succès la figure de la Vierge à celle de la République. D’autre part, si au moment de la Révolution française mais aussi lors de mouvements révolutionnaires ultérieurs en France, des femmes avaient joué un rôle actif, en revanche au Brésil on n’attribua à la femme aucun rôle dans la vie publique. Même dans le Parti républicain, relativement radical, il n’y avait pas de membres féminins.
En outre en France, il s’agissait de remplacer avec vigueur la figure masculine forte et multiséculaire du roi. L’iconographie française de la femme comme allégorie de la république provient directement de l’allégorie classique de la liberté. Au Brésil, dans une république où presque tous les postes administratifs allaient être occupés par des officiers, la liberté (comme valeur et comme allégorie féminine) ne pouvait pas être propulsée au premier plan, occupé par des valeurs plus militaires de discipline et d’ordre.
C’est plutôt la princesse Isabelle, régente du Brésil au moment où son père l’empereur Pedro II était absent pour des raisons de santé, qui avait pu incarner la réalité de la liberté. C’est en effet sous sa régence que fut promulguée, en 1888, la « Loi d’or » (Lei Aurea) qui marquait l’abolition totale de l’esclavage au Brésil. On glorifia la princesse du titre d’« Isabelle la rédemptrice » (Isabel a Redentora) et sur des médailles du mouvement abolitionniste elle figurait au centre avec les chaînes rompues dans une main et le décret d’abolition dans l’autre51. Mais les représentants de la nouvelle république n’allaient pas promouvoir une telle figure importante de la monarchie défunte.
L’invention du héros de la république : tiradentes
Lors de la construction de l’identité nationale, des figures de héros jouent souvent un rôle non négligeable. En Suisse c’est la figure de Guillaume Tell ou aux États-Unis les « founding fathers ». La république du Brésil avait aussi ses « pères fondateurs », les instigateurs de la proclamation de la république le 15 novembre 1889.
Le Brésil : un état-nation a construire
56
52. J. Murilo de Carvalho, A Formação das Almas…, op. cit., p. 67.
Mais ils défendaient des conceptions de la république très divergentes : Deodoro da Fonseca optait pour une république militaire, Benjamin Constant pour une république « sociocratique » (suivant la termino-logie de Comte) et Guintino Bocaiúva (1830-1912) pour une république libérale. Significativement, les républicains radicaux n’étaient pas représentés dans le gouvernement. Les trois hommes politiques qui défen-daient des conceptions très divergentes de la république n’étaient donc guère aptes à jouer un rôle consensuel de « pères fondateurs ».
C’est une figure historique qui devint leur substitut, à travers le processus classique de l’« invention of tradition » (Hobsbawm). Cette figure qui fonctionne comme une sorte de mythe d’origine, a été Joaquim José da Silva Xavier « Tiradentes » (surnom dut à ses activités occasionnelles de dentiste, d’« arracheur de dents »). La province du Minas Gerais souffrait des impôts très élevés qui étaient à payer bien que la production aurifère ait décliné constamment. Sous la direction de Tiradentes derrière lequel se cachaient des personnalités importantes de la province se fomenta une conspiration, plus tard appelée la Incon-fidência mineira (1789), qui envisageait une sécession de la province érigée en république avec un parlement et des assemblées dans chaque ville. Soulignons dans ce contexte l’importance ultérieure prise par la date « franco-brésilienne » de 1789 pour la construction de la légende de Tiradentes. Une université allait être créée à Ouro Preto. Les esclaves nés dans le Minas seraient libérés. On envisageait des contacts avec les provinces de Rio et de São Paulo dans le but de créer une confédération à l’image de celle des États-Unis. Les conjurés se réclamaient aussi des penseurs des Lumières françaises, de Diderot et de Voltaire, mais plus encore de Mably et de l’abbé Raynal qui avait opté pour l’abolition de l’esclavage.
L’un des conjurés trahit et dévoila toute l’affaire, Tiradentes fut arrêté en mai 1789. Après un long procès, il fut condamné à mort, pendu le 21 avril 1792 et écartelé. La condamnation de plusieurs autres conjurés fut commuée en déportation perpétuelle.
La littérature brésilienne s’est consacrée à la figure de Tiradentes avant les historiens. En 1848, Antônio Ferreira de Souza publia un roman sous le titre Gonzaga ou a conjuração de Tiradentes. Un Français, Charles Ribeyrolles, républicain radical de la Révolution de 1848, ami de Victor Hugo, qui dû s’exiler en 1851, d’abord à Jersey, puis à Londres et enfin au Brésil en 1858, glorifie Tiradentes dans son Brésil pittoresque (1859) qui sera traduit en portugais. En 1876, parut le conte « A cabeça de Tiradentes » de Bernardo
Guimarães et la même année fut représentée une pièce de théâtre de Castro Alves consacrée à l’insurrection du Minas Gerais ; dans un poème final on y évoque Tiradentes comme le « Christ des masses ».
La mémoire de Tiradentes fut revivifiée à la même époque par le livre d’un chercheur, Joaquim Norberto de Souza e Silva, Historiá da conjuração mineira (1872). Cet historien soulignait cependant que le rôle de Tiradentes n’avait pas été aussi important qu’on le croyait et que, en prison, son engagement politique se transforma en un engagement religieux. Beaucoup de personnalités républicaines contestaient cependant cette thèse, car Tiradentes s’était déjà transformé en mythe ; on le considérait comme un héros qui était mort pour ses idées. À Rio s’était formé un club Tiradentes. Après la proclamation de la république, le processus de « canonisation » de celui qu’on surnommait maintenant le « Christ des masses » s’intensifia. En 1890, le jour anniversaire de sa mort, le 21 avril, fut déclaré jour férié.
Pendant une manifestation organisée en son honneur, en 1890, l’artiste positiviste Décio Villares, déjà cité, distribua une lithographie de Tiradentes représenté sous les traits d’un Christ avec une barbe et les cheveux longs, décoré de la palme du martyre. La sacralisation était encore plus évidente dans un tableau d’Aurelio de Figuereido, « O martírio de Tiradentes », qui montrait le héros auprès d’un cercueil, un moine lui tendant un crucifix et le bourreau se cachant les yeux avec ses deux mains. Dans l’ico-nographie de Tiradentes, on mettait en relief l’analogie avec l’histoire de la Passion du Christ, bien connue dans ce pays aux traditions catholiques, ce qui contri-bua à la réussite de la construction de Tiradentes en héros républicain52. Ceci peut paraître de prime abord en contradiction avec ce que nous avons relevé chez Murilo de Carvalho expliquant l’insuccès relatif de la création d’une « Marianne » brésilienne par le fait que la Vierge Marie occupait déjà la place de figure féminine vénérée. Mais le martyre de Tiradentes était compatible avec la tradition chrétienne alors que la figure laïque de Marianne et la Vierge Marie ne l’étaient pas.
La figure de Tiradentes permettait de lier plusieurs thèmes : l’abolition de l’esclavage et la création de la république, le passé et le présent. À travers ce processus de sacralisation, le héros avait d’ailleurs cessé d’être le protagoniste des seuls républicains radicaux. Même les monarchistes pouvaient se réclamer de lui, parce que la monarchie avait réalisé deux grands buts : l’indé-pendance et l’abolition de l’esclavage. Le secret de la survie du mythe de Tiradentes repose peut-être, selon Murilo de Carvalho, sur son ambiguïté, car la figure au sujet de laquelle les connaissances historiques restaient
Joseph Jurt
57
53. Ibid., p. 73.54. Ibid., p. 129.55. B. Bennassar et R. Marin, Histoire du Brésil…, op. cit., p. 302.
56. a. Enders, Histoire du Brésil…, op. cit., p. 60.57. W. L. Bernecker, H. Pietschmann et R. Zoller, Eine kleine Geschichte Brasiliens,
op. cit., p. 217.58. Voir Renilson Rosa Ribeiro, « Republica(s) imaginada(s) », Revista Aulas, 2, 2006.59. Voir José Sergio Leite Lopes et Jean-
Pierre Faguer, « L’invention du style brésilien. Sport, journalisme et politique au Brésil », Actes de la recherche en sciences sociales, 103, juin 1994, p. 27-35.
minces, était devenue un écran de projection idéal soustrait en même temps à une instrumentalisation trop spécifique, trop partisane53.
José Murilo de Carvalho constate dans son étude que les positivistes se manifestèrent à propos de presque toutes les créations symboliques concernant la république au Brésil : le drapeau, la devise, le blason, la tentative de création d’une allégorie de la république, le mythe de Tiradentes. Selon la conception des positivistes, une petite élite devait reconnaître les lois de l’évolution historique indépendamment du consentement de majorités populaires ou parle-mentaires toujours versatiles. Il s’agissait de faire en sorte que le peuple accepte ou même aime cette forme de gouvernement. À cette fin, les positivistes s’engagèrent fortement dans ce processus de création de symboles de la nouvelle république, tentant de gagner à travers ces formes visuelles ‒ ou sonores ‒ une population qui était analphabète dans sa majeure partie54.
Cette tentative de création de nouveaux symboles, ne connut cependant qu’un succès restreint : les symboles qui s’imposèrent, le drapeau, les armoiries et l’hymne, reposaient sur la tradition impériale antérieure ; le mythe de Tiradentes fut l’adaptation d’une icono-graphie et d’une inspiration d’origine religieuse. Les symboles ne se seraient pas solidement ancrés dans la tradition iconographique du peuple, estime Murilo de Carvalho. La chute de la monarchie s’effec-tua sans le concours immédiat de celui-ci. Ce qui fut présenté comme une révolution républicaine a été de fait une conspiration symbolique menée par un petit nombre d’hommes politiques idéalistes et de militaires pragmatiques. Ce fut une « république sans peuple »55,
même s’il y avait certainement une aspiration plus large vers une république, comme vers l’abolition de l’escla-vage. Si la rue ne s’est pas manifestée pour proclamer la république, « elle ne s’est pas non plus précipitée au secours de la monarchie »56.
La nouvelle constitution, qui resta en vigueur pendant 43 ans, définissait les rapports entre les trois pouvoirs. La participation du peuple y était cependant minimale : seuls pouvaient voter les citoyens masculins de plus de 21 ans, disposant d’une certaine fortune et n’étant pas analphabètes : en 1894 ce n’était que 2,2 % de la population totale57. Si les symboles de la république avaient été esquissés au Brésil par une élite politique, il s’agissait de symboles étatiques et pas encore nationaux58. Mais du fait de leur survie jusqu’à nos jours, ces symboles du drapeau, de l’hymne et de Tiradentes, sont devenus des symboles nationaux – à côté des symboles « non-officiels » que sont aujourd’hui le football59 et le carnaval.
La recherche de symboles à laquelle s’était livrée la république est une preuve de l’importance immense de la communication politique. Cette politique symbolique s’est manifestée de nouveau au Brésil il y a un peu plus de cinquante ans, avec la création volontariste d’une nouvelle capitale, Brasilia, dont le tracé dessine à la fois une croix – la Croix du Sud – et un avion (« progresso ») avec une place des Trois Pouvoirs (« Praza dos Três Poderes ») autour de laquelle sont regroupés le Parlement (Sénat et Chambre des députés), le Tribunal suprême fédéral et le siège du Gouvernement. Un tel plan fait primer la dimension symbolique sur les considérations touchant aux exigences de la vie quotidienne, mais ceci est une autre histoire.
Le Brésil : un état-nation a construire
58
Brigitte Gaïti
La RÉHaBILItatIoN LIBÉRaLE à l’université : la deuxième vie de Maurice allais.
L’érosion discrète de l’État-providence dans la France des années 1960Retour sur les temporalités d’un « tournant néo-libéral »
59ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 58-71
1. on peut lire par exemple le travail de Richard Kuisel qui court sur la période 1900-début des années 1950, Le Capita-lisme et l’état en France. Modernisation et
dirigisme au XXe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèques des histoires », 1984.2. Bruno Jobert (dir.), Le Tournant néo- libéral en Europe, Paris, L’Harmattan, coll.
« Logiques politiques », 1994.3. Pour reprendre le terme de Pierre Müller qui le définit comme des idées en action, voir « L’analyse cognitive des
politiques publiques : vers une sociologie politique de l’action publique », Revue française de science politique, 2, 2000, p. 189-207.
De manière récurrente, les historiens de l’État et de l’action publique de l’après Seconde Guerre mondiale mettent l’accent sur le rôle moteur de l’administration, du secteur public et de la planification dans la reconstruc-tion du pays. Les éléments essentiels en sont connus : une place centrale de l’État, acteur et régulateur de l’économie et des pratiques de redistribution sociale assez larges1. Sous l’effet de la crise économique, ces politiques keynésiennes auraient été contestées durant les années 1970 avant que leur acte de décès ne soit signé politiquement un peu plus tardivement et de manière relativement inattendue. C’est en effet en mars 1983 que le gouvernement Mauroy, pourtant engagé depuis deux ans dans une politique de relance, annonce un plan de rigueur, signant là un « tournant néo-libéral »2 – jusqu’à aujourd’hui toujours en cours – des politiques économiques et sociales. Cette version propose une causalité économiste d’un tournant qui serait la réponse contrainte à l’internationalisation des économies, à la chute de la croissance et à la diminution des ressources publiques qui s’ensuit.
Une variante assez répandue dans l’analyse des politiques publiques repolitise le processus et montre que ce tournant est causé par une profonde transforma-tion des modes de construction de la réalité sociale, par la conversion des idées et représentations dominantes, parfois objectivées sous la forme de recettes et instruments
d’action. De nombreux auteurs s’attachent ainsi à décrire la mort de ce « référentiel » keynésien et modernisateur3 qui aurait imprégné les représentations des élites de l’après-guerre et nourri durablement les politiques des gouvernements successifs. Suivant des temporalités différenciées selon les secteurs concernés, le référentiel de la modernisation aurait, du milieu des années 1970 au milieu des années 1980, progressivement cédé le pas à un référentiel de marché.
Or, si la version économiste propose une causalité globale bien peu susceptible de rendre compte de la diversité des solutions trouvées par les gouvernements successifs aux situations qu’ils affrontaient, cette version plus cognitive de l’action publique affronte une autre question épineuse, celle des représentations comme matrices de l’action. Faut-il des libéraux convaincus ou encore une science économique gagnée par le marginalisme pour impulser le tournant libéral ? Certaines hypothèses alternatives ont été proposées par des tenants de l’analyse de l’action publique, visant à prendre en compte le poids des institutions, des routines et des compromis bureaucratiques, des négociations avec les partenaires sociaux afin de mettre au jour des phénomènes d’inertie ou d’irréversibilité bien propres à contourner ou ignorer les révolu-tions paradigmatiques. Les idéologies, les savoirs d’expertise ne prennent ici sens que dans les mobilisations
L’érosion discrète de l’État-providence dans la France des années 1960Retour sur les temporalités d’un « tournant néo-libéral »
Brigitte Gaïti
60
4. Philippe Bezes, Réinventer l’état. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, PUF, coll. « Le lien social », 2009.
institutionnelles ou dans les processus décisionnels qui, en les saisissant, les transforment considé-rablement. La redécouverte de ce moment crucial qui est celui de la mise à œuvre de l’action publique a également contribué à nourrir des réflexions intéres-santes sur la manière dont les tournants de politiques publiques peuvent se configurer sur le terrain, dans les relations de guichet par exemple ou encore dans les procédures de traitement des dossiers.
La notion même de tournant devient problématique dans la mesure où elle tend à créer deux moments, et avec eux, deux camps peuplés à chaque fois d’acteurs dominants partageant les mêmes valeurs. Or, nous disposons d’un ensemble de travaux qui nous permettent de sortir de cette impasse en situant pour commencer notre enquête dans l’espace politico-administratif dans un moment singulier, celui des années 1960 : l’émer-gence à cette époque d’un « souci de soi » de l’État détecté par certains analystes4 et l’impératif moder-nisateur et planificateur proclamé par le général de Gaulle au même moment invite à aller voir de plus près ce qui se joue alors dans l’espace politico-administratif. Il nous semble ainsi que le retour sur les années 1960 nous pousse à changer notre questionnement, peut-être parce qu’il oblige à penser le tournant néo-libéral sans la crise économique et à repérer dans un monde keynésien qu’on croyait stabilisé, des concurrences nouvelles, des manières de faire inédites et bien peu homogènes. Partant, c’est aussi à une histoire moins saturée d’idéologie, moins structurée autour de l’affron-tement de camps toujours déjà là, que nous voudrions contribuer. Ce projet est un projet collectif. Depuis les années 1990, ces versions de l’histoire des politiques économiques et sociales ont été amendées par toute une série de travaux, thèses, articles, colloques qui tentent de prendre la mesure de cette séquence libérale dont le prolongement et l’ampleur interrogent et obligent à retourner sur le passé et notamment sur la consistance de ce qui devient un « épisode » keynésien. L’hypothèse développée ici à la suite de ces travaux est celle de la fragi-lité des conversions au keynésianisme au sein de l’État et, associée à elle, celle des ambivalences des politiques menées dans les années 1960.
On verra dans un premier temps comment cette version, longtemps très robuste, d’une après-guerre peuplée d’acteurs politico-administratifs épris de croissance, de productivité associée à un souci de justice sociale, a été contestée, voire retournée dans une histoire alternative, retrouvant, parfois pour les réhabiliter, le rôle des libéraux, de marginalistes actifs aux sommets de l’État, et ce, bien avant les chocs pétroliers et la crise économique. Dans un deuxième
temps, on interrogera cette mise au jour de la pluralité des groupes, de leurs façons de penser, de compter et d’agir au sein de l’espace de l’administration moder-nisatrice ; pour ce faire, on reviendra sur les recom-positions de la haute administration des années 1960, liées aux institutions nées dans l’après-guerre, qu’il s’agisse de l’ENA et des nouvelles générations de hauts fonctionnaires dont elle garantit les compétences et nourrit les ambitions, qu’il s’agisse encore de la création du Commissariat général du Plan, de l’Insee ou du bureau des services des études économiques et financières du ministère des Finances ou encore du fonds de modernisation et d’équipement au sein de la direction du Trésor. L’émergence et le dévelop-pement de tout cet appareillage d’études, de prévision ou d’intervention économiques ont certes contribué à intéresser un grand nombre d’acteurs à une version d’un État porteur d’une rationalité supérieure et à renforcer les objectifs et les pratiques interventionnistes dans la conjoncture bouleversée de l’après-guerre. Pourtant ce consensus très situé, s’effrite progressive-ment au fur et à mesure qu’il est soumis aux concur-rences nouvelles qui surgissent au sein de ce nouveau dispositif administratif. Enfin, on reviendra sur les politiques mises en place dès le début de la Cinquième République ; souvent associée à un renouveau des politiques interventionnistes, à une remotivation de la planification et à une relance d’un aménagement conquérant du territoire, la période est susceptible d’une tout autre analyse que celle d’un retour de l’esprit de la Libération, pour peu que l’on s’intéresse aux transformations de la division du travail gouverne-mental (par exemple autour de la création de nouvelles directions administratives ou du poids pris par certains services budgétaires), ou encore à certains dispositifs discrets introduits dans des politiques sectorielles (qu’il s’agisse de la gestion des caisses de sécurité sociale ou des politiques de financement de l’État par exemple) ou pour peu, tout simplement, que l’on affronte, au-delà des discours les plus étatistes des gouvernants, les oscillations des politiques et des décisions, associant l’interventionnisme modernisateur et l’appel au retour des mécanismes de marchés, prônant à la fois planification et libéralisation.
On devine alors la difficulté de saisir un tournant néo-libéral dans la mesure où, si moment keynésien il y a eu, il s’est joué dans une conjoncture très atypique, brève, celle de la Libération, dans un espace social dominant structuré de manière inédite, peuplé de dirigeants au profil inusuel qui ont su affirmer leur promotion en investissant avec force les positions nouvelles et en brandissant l’argumentaire et les objectifs
Brigitte Gaïti
61
L’érosion discrète de l’état-providence dans la France des années 1960
5. Brigitte Gaïti, « Les modernisateurs dans l’administration d’après-guerre. L’écriture d’une histoire héroïque », Revue française d’administration publique, 102, avril-juin 2002, p. 295-306. 6. Cité dans François Fourquet, Les Comptes de la puissance. Histoire de la comptabilité nationale et du plan, Paris, Recherches, coll. « Encres », 1980, p. 87. 7. Ibid.
d’un keynésianisme dont ils se sont faits les porte-parole. Mais c’est ensuite la brièveté et la fragilité des adhésions à ces principes renouvelés qui doivent être prises en compte, au fur et à mesure de la normalisation des nouveaux services administratifs et de leur insertion dans les concurrences administratives ; c’est encore le carac-tère extrêmement composite des politiques gouverne-mentales menées dans les années 1960 qui peut être relevé et c’est pour finir un tropisme libéral, mâtiné parfois d’un interventionnisme bien propre à valoriser les positions gouvernementales que déploie sur la quasi-totalité de la période un personnel politique et administratif cumulant positions publiques et privées et toujours susceptible de voir à la fois dans l’État et le marché, les terrains possibles d’un maintien de leur statut et de leur capacité à agir.
Les retournements d’une histoire de l’après-guerre : les « trente Glorieuses » revisitées
Les promoteurs de la politique économique de l’immé-diate après-guerre, qu’ils soient hauts fonctionnaires, modernisateurs, comptables nationaux, planifica-teurs ou statisticiens, ont fait preuve d’une étonnante capacité à mettre leur histoire en récit5. Que l’on songe à François Bloch-Lainé, Claude Gruson, Pierre Uri, Jean Serisé, Simon Nora, Jean Saint-Geours, Pierre Massé, Pierre Delouvrier, et d’autres encore, produc-teurs d’autobiographies, de récits, de manuels associés aux cours qu’ils dispensaient à Sciences Po ou à l’ENA, grands témoins-analystes repris par les historiens de la période, régulièrement invités dans leurs colloques pour y délivrer la bonne parole de la modernisation économique et sociale de la France, y souligner leur rôle. Circulant entre le Commissariat général du Plan, le Service des études économiques du ministère des Finances (SEEF, transformé en 1965 en direction de la Prévision), la direction du Trésor ou l’Insee, ces fonctionnaires à la destinée spectaculaire apparaissent à l’analyse comme atypiques : détenteurs de propriétés sociales rares dans le monde la haute fonction publique (protestants ou juifs pour certains, en situation de forte ascension sociale ou de reconversion, issus de familles étrangères à la fonction publique), ayant suivi des trajectoires chaotiques (révoqués sous Vichy ou vichystes repentis, anciens résistants, commu-nistes, etc.), ils se voient promus à la Libération dans des positions administratives nouvelles et straté-giques. Leur environnement est lui-même bouleversé : le personnel politique se trouve alors largement déplacé
à gauche, les élites économiques sont pour la plupart disqualifiées et les impératifs de la reconstruction dévaluent les politiques d’inspiration libérale. Mais c’est aussi l’aide Marshall qui donne aux planifica-teurs une position-clé dans l’établissement (statistique) des besoins et dans la distribution des ressources publiques. Elle leur permet ainsi de peser sur les orien-tations et les méthodes de l’action publique. Pendant quelques années, les comptables nationaux et les experts du Plan, soutenus par les réseaux américains de Jean Monnet, sont les seuls à pouvoir prétendre au titre de partenaires des organismes internationaux, et notamment de l’OECE.
La mise en récit du rôle des « modernisateurs » en fait les précurseurs et les incarnations glorieuses d’un État-providence en construction. Ils ont longtemps réussi à convaincre de la robustesse d’un État keynésien, volontariste à hauteur de leurs capaci-tés à impulser les politiques économiques, à rénover, à bâtir, reconstruire, éduquer, soigner, aménager. On peut partir de cette remarque de Pierre Uri, membre du Plan de 1947 à 1952, sans doute porté à exagérer son rôle mais qui dit bien là le sentiment qu’ont pu ressentir certains des fonctionnaires appelés à partici-per à cette entreprise de modernisation économique et sociale : « On a fait la Reconstruction, le plan d’indus-trialisation, la stabilisation, la politique sociale ; on a fait la politique étrangère et on a terminé en faisant de la politique militaire. De mon bureau mansardé du Plan, j’ai largement inspiré la politique économique française […] Trois types clandestins qui faisaient tout ! Et les gouvernements faisaient ce qu’on leur disait »6. Ces témoignages ont longtemps empêché de s’émanciper de l’intrigue qu’ils bâtissaient. Ils ont tendu à généraliser et à pérenniser une représentation du progrès et de la modernité guidée par l’État.
Premières inflexions : les comptes de la puissance ou la puissance circonscrite des comptables nationaux
En 1980, François Fourquet propose une histoire de la comptabilité nationale et du plan qui met en scène le groupe des modernisateurs et le suit, des années 1940 aux années 19807. L’entreprise aurait pu être hagiogra-phique ; elle offre au contraire une vision saisissante des réseaux, des concurrences, des enjeux qui ont animé ces groupes et fait l’hypothèse d’une durée finalement restreinte de l’influence des modernisateurs au sein des espaces politico-administratifs. Laissant large-ment la parole à ces acteurs, hauts fonctionnaires économistes, statisticiens et hommes politiques,
62
8. Ibid., p. 114.9. Ibid., p. 257.10. Vincent Spenlehauer, « L’évaluation des politiques publiques, avatar de la plani-fication », thèse de science politique sous la direction de François d’arcy, Grenoble,
Université Pierre-Mendès-France, 1998.11. Henry Rousso (dir.), La Planification en crises (1965-1985), Paris, Éd. du CNRS, 1987.12. François Etner, « Les ingénieurs-économistes en France (1841-1950) », thèse de sciences économiques, Paris,
Université Paris Ix-Dauphine, 1978.13. Harold Mazoyer, « Les calculs de la puissance. Socio-histoire d’une science de gouvernement : l’économie des transports (1960-1982) », thèse de science politique sous la direction de Gilles Pollet, Lyon, IEP,
Université Lumière-Lyon 2, 2011.14. Séminaire d’économie du professeur Maurice allais, « Portée et limite de la notion de coût dans l’économie des trans-ports. Discussion », 18 février 1965, cité in H. Mazoyer, ibid., p. 113.
le livre retrace la formation « d’une équipe et de sa mystique8 », les étapes d’une conquête de l’administration des finances, puis d’une entreprise de conversion des politiques, des patrons ou des universitaires. Ce temps de la conquête s’étire de 1950 à 1961 ; et très vite, vient le temps de la « banalisation » entre 1961 et 19809. Vincent Spenlehauer, qui a écrit une histoire de l’évaluation adossée à l’entreprise de planification française10, adhère à ce découpage chronologique et, dans le prolongement de travaux d’historiens11, situe le délitement de la communauté des planificateurs au début des années 1960 – la scission entre la direction de la Prévision et l’Insee et le découplage entre le Plan et les Finances, entamé en 1961 sont analysés comme des événements décisifs. Les comptes de la puissance ressortissent désormais et, selon une tradition bien établie, du seul ministère des Finances. Les planifica-teurs, autour de Pierre Massé, entreprennent de recon-vertir leurs ambitions d’ordonnateurs de la politique économique du pays, et se résignent à prétendre à une fonction de coordination des relations entre ministères intersectoriels, devenus des opérateurs de la croissance. Voilà donc la période d’influence de l’administration modernisatrice réduite ici à celle de la décennie 1950. Cette révision n’est pas terminée et s’opère désormais dans certains travaux contemporains par la mise au jour de nouveaux acteurs administratifs et intellectuels au profil tout différent mais insérés de manière spécifique dans ces réseaux de l’interventionnisme étatique.
Deuxième inflexion : les calculs de la puissance ou la puissance des ingénieurs-économistes marginalistes
Cette dévaluation et cette réduction de la durée de l’influence des planificateurs et des comptables nationaux affaiblissent un premier récit héroïque de la modernisa-tion, qui en faisait un moment de croyance et d’enthou-siasme partagé, hors des routines et des concurrences bureaucratiques ordinaires ; il contredit aussi une version de l’ère keynésienne adossée à la période de croissance en montrant la fragilité des porteurs du keynésianisme dès le début des années 1960. Cet affai-blissement peut expliquer en partie l’intérêt renou-velé des chercheurs pour des acteurs différents de la période, jusque-là simplement entr’aperçus ou rappor-tés à des moments différents de l’histoire économique12. Harold Mazoyer propose par exemple de prendre en compte ce qu’il appelle, en référence à l’ouvrage de François Fourquet, « les calculs de la puissance13 ».
Son travail suit le renforcement du poids d’un groupe, celui des ingénieurs-économistes au sein du ministère des Transports et plus largement dans les instances de gouvernement ainsi que dans les espaces plus acadé-miques avec la consécration au CNRS et à l’univer-sité, de l’économie des transports. Le découpage retenu (1960-1982) situe cette promotion au moment du déclin de la planification.
Deux histoires parallèles, parfois tangentielles, surgissent alors. Elles dessinent un processus complexe d’économicisation des sommets de l’État et de l’action publique. Ainsi, les planificateurs et les comptables, de par leur mode de quantification des phénomènes sociaux en agrégats globaux, de par leur manière de décrire la modernité tout en la construisant autour de nouvelles priorités de l’action publique (investissements productifs, aménagement du territoire, mécanisation de l’agriculture, grands projets de voies de communication, etc.) ont forte-ment perturbé les circuits de la décision au sein des ministères sectoriels, obligeant ceux-ci à ouvrir leurs chiffres, et à outiller statistiquement leurs demandes. Les économistes en place dans les ministères gérant les grands équipements de l’aménagement du terri-toire deviennent ainsi les correspondants du Plan à qui ils proposent, voire à qui ils opposent, leur expertise propre. Ces interactions entre planificateurs et ingénieurs-économistes des ministères techniques modifient de ce fait toutes les hiérarchies en place. Ainsi, en 1960 est créé au ministère des Transports un service d’études économiques chargé d’épauler le ministre. Harold Mazoyer montre que celui-ci dispose de ressources nouvelles mobilisables tout au long du processus de décision et notamment dans les arbitrages interministériels, et qu’il est ainsi moins dépendant à la fois des expertises du Plan mais aussi de celle des grandes directions sectorielles. En 1964, la reconnaissance de ce savoir nouveau, adossé au calcul économique est consacrée par la création d’un séminaire de Maurice Allais dispensé à l’École des hautes études sur la socio-économie des transports. Les discussions au sein de ce séminaire sont l’occasion de critiques des comptables natio-naux, de leurs manières trop globales et imprécises de quantifier, inaptes à prévoir les coûts et avantages des décisions14. Aux grandes prophéties des planifi-cateurs s’opposent ici les choix raisonnés et calculés des ingénieurs-économistes.
Brigitte Gaïti
63
15. Jean-Claude thoenig, L’Ère des tech-nocrates. Le cas des Ponts et Chaussées, Paris, L’Harmattan, 1987.16. Voir François Etner, Histoire du calcul économique en France, Paris, Economica, 1987, p. 266-276.
17. Cf. les extraits de la lettre envoyée à l’automne 1961 reproduits in Pierre Massé, Aléas et progrès. Entre Candide et Cassandre, Paris, Economica, 1984, p. 177-180.18. Sur ce point : thomas angeletti,
« Le laboratoire de la nécessité. Écono-mistes, institutions et qualifications de l’économie », thèse de sociologie sous la direction de Luc Boltanski, Paris, EHESS, 2013, p. 172. Il s’appuie ici sur l’article de Roger Guesnerie, Pierre Malgrange
et Michel Deleau, « Planification, incerti-tude et politique économique. L’opération optimix. Résultats numériques », Revue économique, 24(6), 1973, p. 1072-1103.
Ces ingénieurs qui peuplent certains ministères sectoriels, ici le ministère des Transports, ou encore les cercles dirigeants des entreprises publiques, sont bien souvent des polytechniciens, ingénieurs des Ponts et Chaussées ; leur intérêt pour l’économie et le calcul évoque pour l’époque une probable marginalité dans un corps où le génie civil est le domaine de compétence15. Leur approche de l’économie est elle-même particu-lière ; portés plus que d’autres économistes à la forma-lisation mathématique, à distance de ce qui prévaut alors à l’université ou à l’ENA, ils défendent une écono-mie appliquée à la décision. Présents avant tout dans les ministères techniques, qui gèrent alors de lourds programmes d’équipement (routes, lignes de chemin de fer, métro, RER, canaux, hôpitaux, etc.), ils sont appelés à évaluer des grands projets, ce qui les conduit à des préoccupations, à ce moment peu fréquentes, de coût et de rationalisation des choix.
L’optimisation des choix publics, le calcul coûts-avantages, les outils de la microéconomie marginaliste se répandent dans les établissements publics et dans toute cette administration opérationnelle, porteuse de la croissance16. Cette promotion complexifie forte-ment la version d’une administration modernisatrice parce qu’imprégnée des schèmes keynésiens et travaillant à partir des grands agrégats proposés par les comptables nationaux. Le regard réflexif sur la dépense publique accompagne le mouvement d’économicisation de la décision publique. Il touche même le Commis-sariat général du Plan dès le début des années 1960. Nommé commissaire général du Plan en 1959, Pierre Massé prend acte de la perte de souveraineté directe du Plan sur les opérateurs économiques. Il engage alors résolument son institution vers une planification plus indirecte. Il le fait, en raison de ses expériences et dispositions personnelles sans doute (ce polytech-nicien a expérimenté au sein d’EDF une micro-économie fondant les investissements sur le calcul coûts-avantages et garde une certaine fierté d’avoir en 1961 fait part à Michel Debré, alors Premier ministre de ses doutes concernant l’opportunité de la construc-tion du canal Rhin-Rhône17), mais aussi du fait de la transformation des rapports de force bureaucra-tiques qu’il constate dès le tout début des années 1960. Plus étonnamment encore, les économistes du Plan et de l’Insee sont eux-mêmes partie prenante de cet aggiornamento ; durant la préparation du Ve Plan, ils entendent élaborer un programme d’optimisation,
à orientation plutôt micro-économique mais élargi à l’échelle nationale, appelé Optimix, destiné à définir « une fonction de préférence de l’État », pensé comme « un décideur public rationnel, semblable au consom-mateur rationnel de la théorie micro-économique18 ».
La réhabilitation libérale
On peut noter une révision plus idéologique de ce récit de la modernisation économique et sociale. Depuis la fin des années 1990, des colloques, journées d’études ou biographies consacrées à Marcel Boiteux, Maurice Allais ou Jacques Rueff par exemple portent trace d’une entreprise dispersée de réhabilitation libérale. Début 2008, la mission d’évaluation des politiques publiques adossée au tout nouveau secré-tariat chargé de la Prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’éco-nomie numérique créé en 2007, publie le périodique Les Cahiers de l’évaluation. Les numéros 1 et 2 de la revue comportent un dossier au titre évoca-teur : « Calculer pour décider ». L’introduction énonce ce qui pouvait être lu comme le projet d’une histoire parallèle des années de croissance, cette fois centrée autour de la figure de l’ingénieur-économiste. C’est toute une série d’amendements à l’histoire des politiques économiques et de leurs acteurs principaux qui est proposée tout au long des deux numéros : l’ingénieur-économiste et pas le comptable national, le polytechnicien-mathématicien plutôt que l’énarque-inspecteur des finances, le marginaliste plutôt que le keynésien, le haut fonctionnaire soucieux de la dépense publique et de l’optimisation des choix et pas l’expert épris d’investissement et de producti-vité globale, l’auxiliaire d’une décision rationnelle optimisée et pas l’ordonnateur aveugle de dépenses globalisées. La publication d’un entretien avec Marcel Boiteux étalée sur les deux numéros donne le ton. Né en 1922, ce normalien, agrégé de mathéma-tiques en même temps que diplômé de Sciences Po, commence une carrière de chercheur au CNRS en 1946 et trois ans plus tard, entre en tant qu’ingé-nieur commercial à EDF ; il fait ensuite carrière dans cet établissement : ingénieur au service des études économiques générales en 1956, puis directeur des études économiques à la direction générale en 1958, directeur général, enfin, en 1967. Il se fait connaître pour ses travaux sur la tarification en situation de monopole. À son arrivée à la tête d’EDF, il déplore
L’érosion discrète de l’état-providence dans la France des années 1960
64
19. Martine Perbet, économiste spécia-liste de l’évaluation, en poste à Bercy, est la rédactrice en chef des Cahiers de l’évaluation.20. Cette version d’une université férue d’une macroéconomie keynésienne dès l’après-guerre est sans doute contestable comme l’indique François Bloch-Lainé lorsqu’il fait état de l’ignorance ou du
retard des universitaires en matière de comptabilité nationale. Voir François Bloch-Lainé, Profession : fonctionnaire. Entretiens avec Françoise Carrière, Paris, Seuil, coll. « traversée du siècle », 1976, p. 151.21. Né en 1923, Jean Bénard est recruté en 1943 par François Perroux au sein du département économique de la Fondation française pour l’étude des problèmes
humains. Marxiste, il est secrétaire du centre confédéral d’études économiques et du cartel confédéral des ingénieurs et cadres de la CGt en 1946 dirigé par Pierre Lebrun. Nommé chercheur à l’INED en 1951, il rejoint le SEEF deux ans plus tard. Il mène ensuite une carrière universitaire avant d’être conseiller spécial à la Banque mondiale. Signalons qu’il a beaucoup écrit
sur l’état de la science économique et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse ici sur le calcul économique et la planification.22. F. Fourquet, Les Comptes de la puis-sance…, op. cit., p. 155.23. Citée et commentée in P. Bezes, Réin-venter l’état…, op. cit., p. 71.24. Ibid.
les rigidités administratives dans lesquelles s’est selon lui enlisé cet établissement et ne doit son salut dit-il qu’au courant réformateur de la gestion publique engagé autour du rapport Nora publié en 1964. Pour qui veut le lire ainsi, l’entretien pullule de petites corrections à une histoire de l’État et de l’action publique d’après-guerre.
À une question plutôt convenue posée par Martine Perbet19 sur l’arrivée d’une culture économique à la Libération, provenant d’outre-Atlantique et qui aurait touché alors les « décideurs publics », Marcel Boiteux fait une réponse plus inattendue, donnant une origine française à cette diffusion de l’économie et organisant en même temps tout un ensemble de micro-oppositions, de réhabilitations et d’excommuni-cations : « L’existence d’une génération d’ingénieurs-économistes et la réussite du calcul économique en France doivent beaucoup à Maurice Allais qui était, comme vous le savez, professeur d’économie à l’École des mines. Il y avait eu autrefois Augustin Cournot et quelques autres qui enseignaient à l’École des Ponts. Les ingénieurs qui étaient passés par ces formations étaient d’un bon niveau en microéconomie, alors que les étudiants des facultés de droit et de sciences économiques étaient surtout portés sur la macro-économie20. On n’y jurait que par Keynes, mais on ne savait pas vraiment ce qu’était un prix de revient ou un amortissement au sens économique. Keynes a d’ailleurs été un grand malheur pour les démocra-ties. Il a certes eu quelques idées géniales, mais ces idées requièrent idéalement, la présence d’un dicta-teur à la tête de l’État ». Maurice Allais, économiste libéral contre Keynes, les ingénieurs contre les juristes et les économistes de l’université, le calcul micro-économique contre la macroéconomie : Maurice Boiteux égrène tout au long de l’entretien les éléments d’une contre-histoire des filiations reconnues ordinai-rement. Cette concurrence entre comptables et ingénieurs-économistes était vécue fortement sur le moment ; ainsi Jean Bénard économiste membre du SEEF depuis 1953, agrégé par la suite (1958) en sciences économiques21 évoque dans un témoi-gnage les clivages de l’époque : « […] la plupart [d’entre nous] non seulement se méfiaient mais étaient assez violemment anti-microéconomie. On daubait volontiers sur les travaux d’Allais, de Boiteux,
c’est à peine si on reconnaissait à Massé qu’il savait se tenir entre les deux avec une certaine autorité. Pour les autres, c’étaient des recherches d’ingénieurs22 ».
tournant néo-libéral et recompositions de l’État
On a rappelé ici quelques-uns des points de révision de la chronologie, des figures et des corps dominants, des expertises légitimes, d’un récit établi de la modernisation. Un moment keynésien bref, composite et hétéroclite, se dessine dont la destinée doit être liée à l’émergence d’un espace administratif renouvelé et à son insertion complexe dans l’univers bureaucratique traditionnel.
Le retour du ministère des Finances
En 1964, Jean Saint-Geours membre du SEEF depuis 1962 et qui sera nommé directeur de la Prévision en 1965, écrivait une note pour le compte du club Jean Moulin intitulée « Néo-libéralisme et développe-ment politique »23 ; sans s’inclure à proprement parler dans ce développement des postures libérales au sein d’un appareil d’État jusque-là apparemment dévoué à l’interventionnisme, cet inspecteur des Finances, qui se reconvertit alors dans la microéconomie et le souci de l’optimisation de la dépense publique, note la recom-position du dicible chez les hauts fonctionnaires en position dans le secteur économique et financier. On y parle dit-il, de « limiter ou restreindre les interven-tions de l’État, de la nécessité d’une rénovation finan-cière et, corrélativement, d’une neutralité du budget de l’État ou encore l’urgence de la liberté complète des mouvements de capitaux ». La mise sur agenda d’un État inefficace parce que dépensant mal, semble ainsi d’actualité au milieu des années 196024 et ce, en dehors de toute contrainte économique mais sous l’effet de mobilisations de certains segments de la haute adminis-tration. Au diagnostic sur la pathologie des retards de la société française se rajoute et bientôt succède un diagnostic critique sur les performances de l’État.
Deux histoires parallèles (celles des comptables planificateurs d’un côté, celle des ingénieurs-écono-mistes de l’autre) se mettent à converger en ce début des années 1960 autour de ces amendements portés ici (au ministère des Transports) ou là (au Commissariat
Brigitte Gaïti
65
ExtRaIt D’UNE BRoCHURE de l’association pour la libre entreprise, Vive la liberté, Paris, 1948.
L’érosion discrète de l’état-providence dans la France des années 1960
66
25. Laure Quennouëlle-Corre, La Direction du Trésor, 1947-1967. L’état-banquier et la croissance, édition en ligne, générée en 2013, Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), disponible sur internet.
26. aude terray, Des francs-tireurs aux experts. L’organisation de la prévision économique au ministère des Finances (1948-1968), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France (CHEFF), 2002.
27. Ibid., p. 290.28. V. Spenlehauer, « L’évaluation des politiques publiques… », op. cit., p. 218.29. Daniel Benamouzig, La Santé au miroir de l’économie, Paris, PUF, coll. « Sociolo-gies », 2005, p. 67-127.
30. Jean-Claude thoenig, « Le PPBS et l’administration publique. au-delà du changement technique », Annuaire inter-national de la fonction publique, Institut international d’administration publique, 1971, p. 97-114.
général du Plan), autour de nouvelles manières d’outiller la croissance et la modernisation, autour des premières opérations administratives de rationalisation des choix. Les nouvelles manières de quantifier et de calculer gagnent les sommets de l’État et en premier lieu le ministère des Finances, jusque dans ses directions les plus modernisatrices, comme celles du Trésor25 ou de la Prévision26. De jeunes inspecteurs des Finances, sortis dans les premières promotions de l’ENA, réputées socialisées au keynésianisme, commencent à engager une conversion de leurs pratiques et promeuvent des outils de calculs nouveaux destinés à endiguer ce qui est perçu rue de Rivoli comme des demandes infla-tionnistes provenant des ministères « dépensiers ». Certains, parmi les fonctionnaires des directions centrales des Finances, et d’abord celle du Budget, ont sans doute envisagé au milieu des années 1960 sinon l’élaboration d’une véritable comptabilité analytique publique, du moins la mise en place d’outils permettant une appréhension plus fine des dépenses à engager. C’est là une des justifications de l’opération de Ratio-nalisation des choix budgétaires (RCB) ; lancée par le gouvernement Couve de Murville et le ministre des Finances Michel Debré en janvier 1968, la RCB vise à mettre en place à l’échelle de l’administration toute entière un vaste programme d’évaluation ex ante des politiques publiques et d’optimisation de la dépense à l’aide des outils micro-économiques du calcul coût-avantage. Si la RCB généralise des expériences d’évaluation engagées depuis quelques années, d’un point de vue organisationnel, elle acte la rupture entre les Finances d’un côté et les comptables natio-naux et les hommes du Plan de l’autre et elle amorce une alliance nouvelle des prévisionnistes avec la puissante direction du Budget. Le départ des plani-ficateurs à Matignon en 1962 (ils étaient auparavant sous la tutelle des Finances) a apparemment produit ses effets de dislocation d’un groupe dont l’identité se révèle finalement plus bureaucratique qu’intellectuelle. Hostile au rattachement du Plan à Matignon, le commissaire du Plan Pierre Massé voit ses craintes se confirmer lors d’une visite au ministre des Finances, Valéry Giscard d’Estaing qui fait jouer à plein les allégeances bureaucratiques : « […] désormais entre nous, tout est changé. Vous n’êtes plus de la Maison. Nous aurons des rapports de ministre des Finances à un service du Premier ministre, et non plus des rapports de ministre à un service de la Maison »27.
Les économistes du SEEF sont en quelque sorte rapatriés pleinement au sein du ministère des Finances et l’équipe se renforce et se « financiarise » encore au fur et à mesure de recrutements nouveaux qui viennent peupler la direction de la Prévision, créée en 1965 pour prendre la succession du SEEF. L’histoire de la RCB se situe dans cette coupure entre les Finances et le Plan et dans la production d’un nouveau groupe, composé d’adversaires d’hier, les hommes de la direction de la Prévision et ceux du Budget, « un petit milieu de hauts fonctionnaires férus d’études micro-économiques des décisions publiques et pouvant incarner l’établissement d’un pont entre ministères dépensiers et ministère des Finances28 » qui ferait pièce au monde des planificateurs29.
Les économistes de la direction de la Prévision découvrent dans le projet RCB leur ambition nouvelle : devenir les conseillers privilégiés du ministre des Finances et du Premier ministre en matière de politique économique. Le directeur du Budget de l’époque, Renaud de la Genière, poursuit lui des objectifs spéci-fiques : il entend, plus clairement que la direction de la Prévision, contrer le Plan, qui, selon certaines critiques des services budgétaires, agit de plus en plus en soutien des demandes de ministères dépensiers. Surtout, la RCB est comprise par certains membres de la direc-tion du Budget comme le moyen d’amorcer une compta-bilité analytique appliquée au secteur public à partir de l’élaboration de budgets de véritables programmes budgétaires dotés d’indicateurs d’objectifs, de résultats prévus et effectifs. Vue des années 2000, la RCB peut être lue comme « la LOLF avant la LOLF » et de fait, c’est la lecture qui prévaut aujourd’hui dans les milieux proches des écoles du pouvoir : la correction des copies de l’ENA des années 2000 à 2013 montre la montée en puissance de cette filiation RCB-LOLF, vraisemblable-ment diffusée dans les cours de Sciences Po et dans les Prep-ENA. Toute histoire de la réforme de l’État se doit apparemment de commencer par une évoca-tion de la RCB, érigée dans un raccourci saisissant en précurseur de la LOLF et de la RGPP. La réhabilitation est frappante : la RCB avait longtemps été oubliée dans la longue cohorte des expérimentations administra-tives sans lendemain. Elle avait surtout été passée sous silence dans le prolongement d’une lente agonie étirée de 1972 à 1977 alors que la direction du Budget a lâché l’affaire30. En dépit de quelques études qui ont fait date sur la sécurité routière ou la périnatalité par exemple,
Brigitte Gaïti
67
31. François Denord, Néo-libéralisme version française. Histoire d’une idéologie politique, Paris, Demopolis, 2007 ; Johann Michel, « Peut-on parler d’un tournant néo-libéral en France ? », Sens public (revue électronique
internationale), mai 2008, p. 1-17.32. Michel Margairaz, « La faute à 68 ? Le Plan et les institutions de la régulation économique et financière : une libérali-sation contrariée ou différée », in Michel
Margairaz et Danielle tartakowski (dir.), 1968 entre libération et libéralisation. La grande bifurcation, Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2010, p. 54.33. Exposé de Pierre Massé devant le
Conseil économique et social, 28 sep-tembre 1965, cité par M. Margairaz, ibid., p. 50.
le programme de la RCB est finalement abandonné après avoir provoqué des résistances administratives, des embauches pléthoriques et des dépenses jugées inquiétantes aux yeux de la direction du Budget. Le calcul coût-avantage n’a pas eu l’efficacité attendue par ceux qui entendaient endiguer grâce à cet outil l’extension des dépenses de l’État. Bref, avant cette réhabilitation des années 2000, la rationalisation des choix budgétaires était tombée dans un trou de l’histoire administrative.
Comme le montre l’analyse des ressorts des ralliements à des savoirs micro-économiques, ce « tournant d’avant le tournant néo-libéral » est moins affaire de convictions ou de conversion paradigmatique que de réponses situées à des transformations de concur-rences bureaucratiques : concurrence entre généra-tions d’énarques arrivant sur le marché des postes d’encadrement administratifs, entre inspecteurs des Finances et ingénieurs des Ponts, entre les Finances et le Plan ou entre les ministères transversaux et les ministères sectoriels, entre les directions administra-tives nées de l’interventionnisme de la reconstruction après-guerre et les directions traditionnelles attachés à d’autres modes de négociation avec les partenaires sociaux et à d’autres manières de décider. Le Plan ratta-ché au Premier ministre perd ses alliances précieuses avec les Finances et se trouve associé désormais aux ministères sectoriels ; quant aux financiers, dissociés désormais des négociations et des expertises du Plan, ils entendent reprendre la main et faire de la microéco-nomie l’expertise nécessaire à l’action publique, ce qui est aussi une manière de tenter de replacer certaines directions dépensières des ministères sectoriels sous leur coupe. Certaines dimensions du tournant libéral engagé dès le tout début des années 1960 se trouvent là. Dans ce cadre, l’arrivée de nouvelles générations de hauts cadres issus de l’ENA, davantage familiers des savoirs économiques que leurs prédécesseurs, contri-buent encore à modifier la nature et la distribution des capitaux puissants dans l’espace politico-administratif31. La socialisation keynésienne au sein de l’École nationale d’administration ou de Sciences Po, si tant est qu’elle ait eu lieu sur un mode aussi homogène qu’il est parfois présumé, y compris durant l’immédiate après-guerre, n’est pas l’antidote aux préoccupations gestionnaires nouvelles qui désormais caractérisent des pans entiers de l’administration des Finances et des bureaux d’études de certains ministères en concurrence avec les hommes du Plan ou de l’Insee pour l’orientation des politiques économiques et sociales.
L’histoire du tournant libéral est une histoire longue qui affecte l’ensemble de l’appareil d’État et les élites économiques. À la fin des années 1960, l’affaire semble entendue. Michel Margairaz évoque ainsi le « tournant libéral de la planification, qui précède mai 196832 » : les options retenues pour le Ve Plan donnent priorité à la compétitivité internationale, « la clé de tout le reste » selon Pierre Massé33 et la préparation du VIe Plan en 1968, est bouleversée du fait de l’investisse-ment des commissions par les représentants patronaux. En fait, l’histoire des politiques économiques et sociales françaises depuis le début du XXe siècle montre une sorte de sens commun libéral partagé par la plupart des élites. Dans ce temps long, le tournant keynésien de la Libération est resté très largement inachevé, faiblement consistant et surtout très conjoncturel, même si son inscription dans des dispositifs institu-tionnels durables a changé considérablement, et pour longtemps, la donne politico-administrative.
L’État-providence en action : brouillage des orientations et verrous politiques
Les politiques économiques et sociales qui vont de l’après-guerre aux années 1970 sont extrêmement composites : l’étiquette keynésienne offre un raccourci commode à qui veut décrire la mise en place et l’évo-lution d’une économie de croissance dirigée et de politiques sociales en expansion. Mais ce label ne dit que peu de choses des variations des politiques publiques engagées et des idéologies qui semblent les soutenir.
Une action publique dispersée
Sous la Quatrième République, très peu de temps après la Libération, des ministres ou des Premiers ministres particulièrement hosti les aux modernisateurs reviennent au pouvoir (c’est bien sûr le cas d’Antoine Pinay en 1952) et il faudrait partir à l’inverse sur les quelques moments, finalement très rares, où les gouvernements affichent ouvertement leur orienta-tion keynésienne, revendiquent un usage politique de la dépense budgétaire et surtout mettent en place des dispositifs et des mesures qui vont en ce sens. Ces conjonctions sont extrêmement brèves. De ce point de vue, le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958 est intéressant à analyser : en effet, en dépit d’un discours de révérence extrêmement appuyé à l’égard de l’État et de ses capacités d’action, on peut
L’érosion discrète de l’état-providence dans la France des années 1960
68
34. Jacques Rueff, Combats pour l’ordre financier. Mémoires et documents pour servir a l’histoire du dernier demi-siècle, Paris, Plon, 1972, p. 153.35. Michel-Pierre Chélini, « Le plan de stabilisation Pinay-Rueff, 1958 », Revue
d’histoire moderne et contemporaine, 48(4), 2001, p. 102-123.36. F. Denord, Néo-libéralisme version française…, op. cit., p. 262-263.37. Louis armand, ingénieur des Mines, est le patron de la SNCF depuis la Libé-
ration et préside l’Euratom entre 1958 et 1959. très atlantiste, il devient anti-gaulliste dans les années 1960.38. L. Quenouëlle-Corre, La Direction du Trésor…, op. cit., chap. Ix, « Le nouvel interventionnisme public, recentré, mais
revivifié, 1960-1967 », p. 451-495.39. M. Margairaz, « La faute à 68 ?… », op. cit., p. 44.
repérer dès les premières années, des orientations de l’action publique difficiles à interpréter de manière univoque : on y trouve des politiques volontaristes de modernisation sociale et de dirigisme économique mais aussi des mesures isolées ou des plans d’action, difficilement rapatriables dans un keynésianisme, même conçu largement. La présence aux côtés du général de Gaulle, de Jacques Rueff, économiste chef de file des anti-keynésiens en France, est troublante d’autant que celui-ci se montre particulièrement entreprenant et écouté : dès l’investiture de Charles de Gaulle, en juin 1958, il lui fait parvenir ainsi qu’à son ministre des Finances Antoine Pinay des notes pour les alerter sur les risques d’inflation, les inciter à restaurer les grands équilibres budgétaires et en finir avec les impasses des derniers gouvernements de la Quatrième République34. Le conseiller du prési-dent est le maître d’œuvre du plan de redressement économique et financier pris par ordonnance à la fin de l’année 195835. Il contrôle largement la composi-tion nettement libérale de la commission chargée de préparer ce plan, en y plaçant son ami Jean Guyot, gérant de la Banque Lazard, Jean Alexandre prési-dent du conseil des experts-comptables, ou encore Claude-Joseph Gignoux, ex-dirigeant de la Confé-dération du patronat français. Le Plan de 1958, en mettant en avant l’équilibre des finances publiques, l’ouverture à la compétition économique internatio-nale, consacre Rueff et l’option libérale qu’il défendait contre certains gaullistes comme Albin Chalandon ou non gaullistes comme Guy Mollet, plus disposés à jouer sur l’encadrement du crédit, la planification ou le contrôle des prix et hostiles à la réduction de la dépense publique. La teneur libérale du Plan de 1958 et la rigueur des mesures d’austérité propo-sées effraient les ministres socialistes qui envisagent de démissionner, ne cédant que devant le général de Gaulle qui met tout son poids dans la balance. Jacques Rueff, qui sait jouer des préoccupations étatistes du général de Gaulle et de son Premier ministre revient à la charge peu de temps après et propose une commission ouverte à des universitaires, des patrons, des hauts fonctionnaires, libéraux et/ou modernisateurs. Le dispositif semble copier celui de la planification, à ceci près que les participants sont choisis intuitu personae36. L’ensemble aboutira au rapport Armand-Rueff37 sur les « obstacles à l’expansion économique », rapport qui se situe
dans une perspective explicitement libérale de restauration du jeu de la concurrence et de destruction de tous les « corporatismes » et les secteurs protégés. On pourrait continuer ce repérage sur l’ambiguïté des politiques de la modernisation en évoquant, au-delà de la prise en compte de la croissance des dépenses publiques et de l’interventionnisme écono-mique, le plan de stabilisation lancé par Valéry Giscard d’Estaing en 1963. Là encore, c’est une alerte de Rueff face à un début de reprise de l’inflation qui est au départ de la mesure qu’endosse politiquement le ministre. Le blocage des prix, la recherche de l’équilibre budgétaire sont ainsi les maîtres mots du plan de 1963 qui se situe dans la droite ligne de celui de 1958.
On peut de fait rester perplexe devant ces exemples qui paraissent signifier l’engagement dans des orientations politiques diamétralement opposées : on sait qu’en 1958, le général de Gaulle propose le ministère des Finances au modernisateur François Bloch-Lainé qui décline l’offre. Or, le portefeuille échoit finalement à celui qui est un de ses adversaires résolus, Antoine Pinay. En fait cette schizophrénie apparente est révéla-trice des politiques de modernisation. Analysant le rôle du Trésor dans les années 1960, Laure Quenouëlle-Corre fait ce même constat d’un assemblage hétéroclite d’interventionnisme modernisateur d’un côté et d’appels répétés au retour des mécanismes de marché et à la rigueur budgétaire, de l’autre. Le rôle du Trésor dans les politiques d’industrialisation semble ainsi osciller tout au long des années 1960 entre plusieurs pôles d’inspiration opposée et forme un ensemble de décisions « dispersées » même si, note-t-elle, la logique qui les guide s’avère « de plus en plus financière38 ». Comme l’écrit Michel Margairaz : « Ce sont les mêmes respon-sables qui prônent la planification et la libéralisation » et le même de Gaulle qui évoque ainsi dans son discours du 8 mai 1961 « l’ardente obligation du Plan » et veut en faire une « institution essentielle… plus puissante par ses moyens d’action39 », tout en s’engageant d’emblée dans la l ibéralisation des échanges, et la restauration des grands équilibres.
Les verrous de l’action publique : l’irréversibilité de quelques mesures libérales
Une hypothèse formulée par le courant de la path dependancy est souvent mobilisée dans les travaux d’analyses de l’action publique et de ses tournants – elle trouve même toute son acuité dans la description
Brigitte Gaïti
69
40. Bruno Palier, « Un long adieu à Bis-marck. Les évolutions de la protection sociale », in Pepper D. Culpepper, Peter a. Hall et Bruno Palier (dir.), La France en mutation, 1980-2005, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 197-228.41. Frédéric Viguier, « La cause des pauvres. Mobilisations humanitaires et transformations de l’État social en France (1945-2010) », thèse de sociologie sous
la direction de Gérard Mauger, Paris, EHESS, 2010.42. Philippe Bezes, « Rationalisation sala-riale dans l’administration française. Un instrument discret », in Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, Gouverner par les ins-truments, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, p. 71-122.43. Benjamin Lemoine, « Les valeurs de la dette. L’État à l’épreuve de la dette
publique », thèse de socio-économie de l’innovation sous la direction de Michel Callon et Yannick Barthe, Paris, École nationale supérieure des Mines, 2011. on pourra lire aussi pour une version réduite de l’histoire de la dette, l’article que Benjamin Lemoine a publié à La vie des idées, « Dette publique, débat confisqué. Pourquoi la France emprunte-t-elle sur les marchés », laviedesidées.fr, 12 février 2013.
44. Cité par B. Lemoine, ibid., p. 94. La citation est extraite du fascicule de Jean-Yves Haberer sur « Les fonctions du trésor et la politique financière du trésor », Paris, Cours IEP, 1975-1976, p. 117-119.45. Laure Quenouëlle Corre, « Les réformes bancaires et financières de 1966-1967, in Michel Debré, un réfor-mateur aux finances, 1966-1968, Paris, CHEFF, 2005.
du tournant néo-libéral. Bruno Palier par exemple est de ceux qui l’ont le plus explicitée à partir de l’exemple de la Sécurité sociale. Le « long adieu à Bismarck40 », pour reprendre sa formule, décrit les méandres des réformes qui, depuis les années 1970, ont fini par atteindre le cœur du système de la protection sociale et de son organisation assurancielle. On prendra ici la question un peu différemment, à la lumière du travail de Frédéric Viguier41 lorsqu’il évoque cette préservation d’un univers de l’assistance dans le dispositif mis en place en 1945. Ainsi se recompose, s’autonomise et s’insti-tutionnalise la « cause de la pauvreté », portée par des groupes qui délimitent les contours du phénomène, en produisant des indicateurs de pauvreté et des études sur ses causes, qui gèrent conjointement des politiques réparatrices et distribuent des prestations obéissant à des régimes de financement spécifique. On pourrait voir là dans les failles de ce dispositif initial une sorte de verrou, devenu progressivement inviolable, protégeant en quelque sorte, y compris dans les temps de croissance économique, un « résidu » assistanciel.
L’installation progressive de verrous dans différentes politiques publiques peut ainsi devenir décisive pour comprendre comment s’organisent et se renforcent des tournants de l’action publique. Philippe Bezes développe un cas particulièrement intéressant, celui du raisonnement en termes de masse salariale élaboré en 1963 dans le cadre de la commission Toutée42 qui progressivement contraint l’ensemble des négociations au sein de la fonction publique. Ou encore Benjamin Lemoine montre comment la formation de la dette publique et sa financiarisation renvoient à des mesures discrètes, techniques, prises dans le cours des années 196043. Il décrit la mise à mort progressive du « circuit du Trésor », qui faisait du Trésor le dépositaire obligé des institutions bancaires ou de crédit par le mécanisme dit du « plancher de bons du Trésor » que devaient posséder les banques à hauteur de 20 % de leurs ressources. Le système est à l’époque dénoncé comme inflationniste par beaucoup des hauts fonctionnaires des Finances dans la mesure où l’augmentation de la masse monétaire, abonde une trésorerie gratuite de l’État. Jean-Yves Haberer, conseiller technique de Michel Debré en 1967, et futur directeur du Trésor, expose dans le cours qu’il donne à Sciences Po au milieu des années 1970
le point de vue qui est alors celui de l’encadrement du ministère des Finances « […] le plancher apportait une sécurité qui favorisait une mauvaise gestion des finances publiques, laquelle était génératrice d’infla-tion44 ». Jean-Yves Haberer, que Benjamin Lemoine interviewe en 2011 pour son rôle dans les réformes du circuit du Trésor, rappelle qu’il revenait alors des États-Unis et qu’il voulait « introduire un peu de libéra-lisme » dans le système financier français. Ces tenants du libéralisme insèrent progressivement des contraintes nouvelles au sein de ce circuit en remettant en cause le système du plancher. Une série de réformes est amorcée d’abord lorsque Valéry Giscard d’Estaing est aux Finances avec Jacques Rueff comme inspirateur, puis de nouveau en 1966-1967 sous la direction de Michel Debré45 : en 1960, les banques retrouvent une possibilité de choisir la composition de leur portefeuille ; en 1963, sous la houlette de Valéry Giscard d’Estaing qui entend renforcer une place financière parisienne émergente, une expérimentation est lancée en matière de mise en adjudication de bons du Trésor ; en 1964, les bons du Trésor émis par adjudication sont séparés des autres ; en 1967, le plancher des bons du Trésor est supprimé ; en 1973, le dernier pan du circuit du Trésor tombe quand la pratique de l’escompte direct auprès de la Banque de France est interdite. Benjamin Lemoine fait apparaître très clairement ce que peut être le verrouillage d’une action publique : cette réforme de 1973 ouvre en effet la véritable mise en marché de la dette publique, proscrit une politique de financement de l’expansion qui procé-derait à coup de création monétaire et tolérerait une part d’inflation. L’État devient ici monétairement neutre et les banques gagnent une large part d’autonomie.
Bien loin d’un impératif de la planification et d’un triomphe de la macroéconomie modernisatrice qui aurait marqué les politiques menées au cours de la présidence du général de Gaulle sous les auspices de « l’ardente obligation », c’est au fond une autre histoire, plus complexe, qui surgit.
La question de la datation : un premier tournant libéral dans les années 1960
Il s’agit de repenser aujourd’hui les séquences pertinentes de ces processus qui marquent la vie politique écono-mique et sociale depuis l’après-guerre. Un des découpages
L’érosion discrète de l’état-providence dans la France des années 1960
70
46. Céline Plessis, Sezin topçu et Chris-tophe Bonneuil (dir.), Une autre histoire des « Trente Glorieuses ». Modernisation, contestations et pollutions dans la France
d’après-guerre, Paris, La Découverte, 2013.47. M. Margairaz et D. tartakowsky, 1968 entre libération et libéralisation…, op. cit.48. P. Bezes, Réinventer l’état…, op. cit.
49. Pierre Bourdieu et Rosine Christin, « La construction du marché. Le champ administratif et la production de la “poli-tique du logement” », Actes de la recherche
en sciences sociales, 81-82, mars 1990, p. 65-85, notamment p. 66-68.50. F. Denord, Néo-libéralisme version française…, op. cit., p. 239-264.
les plus célèbres de la période est celui des « Trente Glorieuses », pour reprendre la formule proposée par Jean Fourastié avec le succès que l’on sait, visant à caractériser les années qui vont de la reconstruc-tion après-guerre aux chocs pétroliers et aux débuts de la crise économique au milieu des années 1970. Cette version présente les « évidences » de la causa-lité économique : le keynésianisme accompagne les années de croissance, la crise en signe la disparition, et ici au fond, qu’ils soient de gauche ou de droite, les gouvernants se soumettent au diktat des phénomènes économiques. Une version plus politique propose les années Giscard comme celles d’un tournant libéral contrarié, mais finalement consacré par la politique de rigueur du gouvernement socialiste. Des historiens se sont lancés récemment dans des opérations de redéfi-nition des cadres chronologiques, ainsi que l’indique par exemple très clairement le titre de cette publication collective intitulée « Une autre histoire des “Trente Glorieuses”46 ». C’est aussi le propos de deux histo-riens, Michel Margairaz et Danielle Tartakowsky, dans la réflexion collective qu’ils dirigent autour de 196847, érigée en date non seulement de libération sociale et culturelle mais aussi en moment particulier de freinage des réformes antérieures de libéralisation économique et financière engagées par des élites politico-adminis-tratives dans le secteur de la banque, de la fiscalité ou de la monnaie. Les années 1960 constitueraient un moment de libéralisation touchant à la fois l’expertise économique, le monde de l’administration et de la politique et pour finir les politiques publiques. On l’a vu à propos des politiques budgétaires, monétaires et financières, on l’a vu également avec l’émergence de ce « souci de soi de l’État » que Philippe Bezes situe au tout début des années 196048. C’est une chronologie approchante qui est mobilisée par Pierre Bourdieu et Rosine Christin dans l’analyse de la transformation des politiques du logement49 : un ouvrage, celui de Claude Alphandéry paru en 1965 qui met à l’agenda la réforme de ces politiques, un rapport celui de Pierre Consigny publié en 1969, un bilan de l’aide à la pierre établi dans une commission du VIe Plan. En 1970, des ingénieurs-économistes s’appuient sur un modèle de calcul micro-économique portant sur les décisions de logement qui outille la critique de l’aide en vigueur. À partir de 1971, c’est ainsi toute une série de réformes discrètes qui lézardent le système en place et précipitent les réformes globales engagées en 1975. Ainsi, les transformations du dicible et du pensable au début des années 1960
(on peut penser à ce tir nourri de propositions libérales que renferment les rapports de trois inspecteurs des finances, le rapport Nora écrit en 1964 appelant à une réforme de la gestion des entreprises publiques visant leur insertion dans un espace concurrentiel, le rapport Leca publié la même année sur la nécessité de développer un marché obligataire, ou encore le rapport de Maurice Lorain, sur le financement des investisse-ments rédigé en 1967) accompagnent des inflexions décisives, même si elles suscitent peu de débat public, de nombreuses politiques engagées à la même époque.
François Denord a montré combien le discours moder-nisateur keynésien était ambigu, pluriel et plastique50. Porté par quelques keynésiens intransigeants, parti-sans d’une planification fortement persuasive comme Claude Gruson, il devient le vecteur d’une technocratie triomphante prétendant faire entendre raison aux gouvernants au nom de la science. Porté par un humaniste comme François Bloch-Lainé, le keynésianisme s’apparente à une manière de défendre le progrès social qui s’accommode d’une association entre plani-fication souple et libre entreprise. Porté par nombre de fonctionnaires gagnés au savoir économique et par des ingénieurs économiques, il est leur voie d’entrée dans la décision politique débarrassée des arguties parlementaires. Porté par des hommes politiques gaullistes, il devient le mot de passe de la puissance et de la grandeur de l’État et le synonyme de volonta-risme politique et de dirigisme centralisé mais s’accom-mode tout à fait d’une recherche des grands équilibres et de tentatives répétées pour mettre fin à l’augmentation de la dépense publique. Cette plasticité invite à ne pas se laisser piéger par la recherche d’un véritable turning point, à ne pas viser à tracer de frontières immuables entre camps établis, avec d’éventuels traîtres ou conver-tis, à ne pas présumer de la cohérence des réformes et surtout à ne pas faire de tournants qui se révèlent massifs le produit de grandes décisions idéologiques. On l’a vu, ce sont des séries de mesures discrètes qui ont nourri des engagements irréversibles.
Quelques conclusions, provisoires, sont particulièrement contre-intuitives lorsqu’elles touchent à la mise en relation entre compétition politique et action publique. Faire de la période 1962-1968 une période de libérali-sation tous azimuts alors que le général de Gaulle est à la tête de l’État et que sa présidence abonde de discours planificateurs et étatistes, peu favorables à l’Europe, implique qu’il faut effectivement repenser les rapports
Brigitte Gaïti
71
51. La rapidité de la reconstruction du parti giscardien sous la bannière revendiquée du libéralisme, dès 1981, l'atteste, voir Brigitte Gaïti, « Des ressources politiques à valeur relative : le difficile retour de Valéry Giscard d’Estaing », Revue française de science politique, 6, 1990, p. 902-917.
entre le discours politique et l’action publique et, surtout, qu’il faut repenser bien plus largement le poids des convictions dans l’action. Ce n’est pas dire que dans ces offensives libérales, il n’y ait pas de libéraux à la barre (l’activisme et l’influence de Jacques Rueff nous le rappellent) mais on le voit, les concurrences affrontées (entre ingénieurs-économistes et comptables macro-économiques, entre financiers et dépensiers, entre énarques et polytechniciens, entre fonction-naires et universitaires), les compromis et les alliances nouées (entre Plan et Finances, entre direction de la Prévision et direction du Budget), le jeu des dispositifs adoptés (suppression du plancher des bons du Trésor, nouveau mode de calcul de la masse salariale au sein de la fonction publique, etc.), sont au principe de bien des amendements aux politiques de modernisation. En ouvrant sur une histoire plus longue, on pourrait faire l’hypothèse que le keynésianisme n’a jamais réelle-ment « pris » dans des univers dominants marqués par des pratiques, des représentations et des intérêts liées au jeu d’un marché faiblement régulé.
De ce point de vue, la séquence 1974-1981 offre un profil inattendu au premier abord ; des libéraux plus « décomplexés » sont au pouvoir derrière Valéry
Giscard d’Estaing mais ils sont « tenus » en quelque sorte du fait de la crise économique et des déchirements politiques internes à la majorité présidentielle qui restreignent leurs marges de manœuvre51. On pourrait alors construire cette séquence temporelle, autour de l’hypothèse d’une libéralisation contrariée durant laquelle les gouvernements se voient en quelque sorte contraints d’intervenir pour « colmater les dégâts de la crise » ; le programme de relance d’inspiration keynésienne lancé par le Premier ministre Jacques Chirac en 1975 en est une des illustrations. Quant aux plans d’austérité successifs présentés par les gouvernements dirigés par Raymond Barre, ils sont d’une portée limitée pour des raisons politiques : les menaces de défection du groupe gaulliste à l’Assemblée, les incertitudes des législatives de 1978 puis de la présidentielle de 1981. Le tournant de la rigueur de 1983, si on veut bien revenir à cette autre date de naissance souvent donnée au virage libéral, ne serait alors que la manifestation de la faible puissance du gouvernement socialiste face à un État déjà profondément transformé et à des élites depuis longtemps libéralisées qui ne croient plus à ce qui devient dès lors un « âge d’or » keynésien.
L’érosion discrète de l’état-providence dans la France des années 1960
72
Didier Fassin
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritairesLe chèque en gris de l’État à la police
« Le probLème, c’est qu’iLs sont souvent redevabLes à ces bac, parce que c’est La structure sur LaqueLLe en dernier recours iLs peuvent toujours se reposer. on est dans un système pervers dans LequeL iLs n’osent pas trop Les toucher parce qu’eLLes Les servent queLque part. Les bac sont Les bien-aimées de Leurs supérieurs parce que c’est eLLes qui font du chiffre. »
un inspecteur généraL de La poLice nationaLe, à propos des directeurs départementaux de La sécurité pubLique,
représentants de L’état auprès des préfets, janvier 2008.
73ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 72-86
1. Egon Bittner, The Functions of the Police in Modern Society, Cambridge (Ma), oelgeschlager, Gunn & Hain Publishers, 1980 [1re éd. 1970] ; albert Reiss, The
Police and the Public, New Haven, Yale University Press, 1975 [1re éd. 1971].2. Hélène L’Heuillet, Basse politique, haute police. Une approche historique et philoso-
phique de la police, Paris, Fayard, 2001 ; Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, coll. « armillaire », 2003.
3. Jean-Paul Brodeur, « La police : mythes et réalités », Criminologie, 17(1), 1984, p. 9-41.
La police est-elle un État dans l’État ou bien, à l’inverse, le bras armé de l’État ? Faut-il la considérer comme une institution jouissant d’une large autonomie et obéissant à ses propres règles ou, au contraire, comme un simple exécutant des politiques gouverne-mentales plus ou moins inféodé au pouvoir en place ? La question est depuis longtemps posée dans les sciences sociales. D’une part, en effet, dans la lignée des travaux théoriques d’Egon Bittner et empiriques d’Albert Reiss1, le pouvoir discrétionnaire constitue certainement, avec la capacité d’usage de la contrainte physique, l’un des deux traits considérés comme les plus aptes à définir la police de façon universelle. Mais d’autre part, dans une tradition historique et philo-sophique foucaldienne illustrée notamment par Hélène L’Heuillet et Paolo Napoli2, l’utilisation des forces de l’ordre par le pouvoir représente un élément essentiel de la gouvernementalité, dont on peut retracer la généa-logie jusque dans la naissance de la police politique. Faut-il alors trancher entre ces deux interprétations, ou bien tenter de les concilier ?
Dans un article classique, Jean-Paul Brodeur3 oppose « la thèse de l’insularité », selon laquelle les forces de l’ordre constitueraient « une instance autonome qui résiste victorieusement aux contraintes extérieures pour poursuivre son propre intérêt », et « la thèse dite instrumentale », d’après laquelle elles se compor-teraient comme un dispositif « relativement inerte qui s’animerait pour répondre mécaniquement aux commandes de l’État, lui-même au service des intérêts de la classe dont il est le mandataire ». Les deux thèses, on le voit, sont porteuses d’une potentialité critique, notamment mobilisée lorsqu’il s’agit de rendre compte de pratiques déviantes de la police, soit, dans le premier cas, pour lui en faire porter la responsabilité principale, et généralement du reste en la segmentant selon le principe de la « brebis galeuse » qui serait infiltrée dans le troupeau, soit, dans le second, pour déplacer la faute vers l’autorité politique, et plus largement les catégories dominantes de la société selon la logique du « sale boulot » qui serait imposé aux forces de l’ordre malgré qu’elles en aient.
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritairesLe chèque en gris de l’État à la police
« La BaC, c’est un mal nécessaire. »Un commissaire de la région parisienne
Didier Fassin
74
4. Patrice Mann, « Pouvoir politique et maintien de l’ordre. Portée et limites d’un débat », Revue française de sociologie, 35(3), 1994, p. 435-455. 5. Didier Fassin, La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Seuil, 2011. La scène décrite plus loin est tirée de cet ouvrage, mais il en est présenté ici une description plus détaillée et surtout une analyse plus serrée.
Le criminologue québécois récuse néanmoins cette alternative, en lui opposant des arguments à la fois empiriques, respectivement l’évidence de l’interven-tion du politique dans les affaires de la police et le rôle des organisations syndicales de policiers comme sources de résistance au politique, et théoriques, à savoir la réfutation de la cohésion tant de l’institution policière que de l’appareil étatique. D’une part, la police ne serait pas une bureaucratie, faute de « contrôle étroit des membres supérieurs de la hiérarchie sur les fonction-naires de niveau inférieur ». D’autre part, les forces de l’ordre et le pouvoir gouvernemental ne seraient pas dans une relation directe, car entre les deux existe une médiation qui est « tout simplement la loi, dont l’écheveau tisse dans une certaine mesure la substance des rapports qui s’établissent entre l’autorité politique et l’appareil policier ». Dès lors, il faudrait plutôt consi-dérer que « les mandats qui sont donnés à la police prennent la forme d’un chèque en gris ». La métaphore suggère que « la signature et les montants consentis sont assez imprécis pour fournir au ministre qui l’émet le motif ultérieur d’une dénégation plausible de ce qui a été effectivement autorisé », mais qu’ils « sont toutefois suffisamment lisibles pour assurer le policier qui reçoit ce chèque d’une marge de manœuvre dont il pourra lui aussi plausiblement affirmer qu’elle lui a été implicitement concédée ». Ainsi, « les deux parties se protègent » contre d’éventuelles critiques, voire poursuites.
La métaphore du chèque en gris ne réfute pas véritablement l’alternative de l’insularité et de l’instru-mentalité. Elle montre plutôt la compatibilité des deux termes, puisque le contrat tacite entre l’État et la police permet au premier d’exprimer ses choix sans le dire et à la seconde de les entendre sans qu’il y paraisse. Il s’agit donc d’un jeu de masques dans lequel chacun fait semblant de ne pas ordonner, pour l’un, ou de ne pas obéir, pour l’autre. On peut toutefois penser que, dans certaines périodes historiques, probable-ment moins rares qu’on ne l’imagine, les masques tombent : le pouvoir manifeste alors explicitement ce qu’il attend de la police, tandis que la police exerce ouvertement son pouvoir de manière autonome. La question n’est alors plus celle de la compatibilité entre les deux termes, mais de la possibilité, voire de la nécessité, de leur articulation.
L’hypothèse développée dans cet article est qu’au cours de la période récente, en France, l’insularisation de la police a été paradoxalement le mécanisme le plus efficace conçu par le pouvoir pour l’instrumentaliser. C’est en accroissant le pouvoir discrétionnaire des forces
de l’ordre que l’État a pu le plus productivement mettre en œuvre ses politiques sécuritaires. Il ne l’a cependant pas fait de manière uniforme et univoque sur l’ensemble du territoire ou à l’égard de toute la population. Il a opéré de façon sélective en ciblant certains lieux et certaines catégories. C’est en créant ces formes d’excep-tion – au sens politique et juridique – que l’apparente contradiction de l’insularité et de l’instrumentalité a pu être dépassée. Plutôt donc que de considérer que « ces deux logiques ne s’excluent pas mutuellement », voire se distribuent en fonction des activités de la police, la première valant pour les « missions de maintien de l’ordre » et la seconde pour les « missions dites de sécurité », comme le discute justement Patrice Mann4, il s’agit de montrer que, dans certaines conditions, elles se renforcent dans le cadre d’une même mission, ou plus exactement d’une même politique. L’analyse qui suit ne décrit donc pas la totalité de l’action de l’État en matière d’ordre et de sécurité publics, mais seule-ment la part de l’État policier qui prévaut là où, pour reprendre une formule classique de Walter Benjamin, l’exception est devenue la règle.
Pour conduire cette analyse, je ne chercherai pas à présenter d’abord les grandes orientations d’une politique pour décrire ensuite la façon dont elle est mise en œuvre sur le terrain. Je m’attacherai à l’inverse à l’observation des pratiques policières pour comprendre comment elles contribuent à la réalisa-tion des objectifs gouvernementaux. Je m’appuierai principalement sur l’enquête que j’ai conduite pendant quinze mois, entre le printemps 2005 et l’été 2007, dans le commissariat d’une grande agglomération de la région parisienne, suivant de jour et surtout de nuit des équipages circulant dans les quartiers de cette banlieue5. Il s’agit d’un travail essentiellement d’observation, incluant des conversations informelles avec les policiers, mais non des entretiens structu-rés, sauf avec des commissaires, des syndicalistes et des hauts fonctionnaires, autrement dit à l’écart du terrain. Sur ce dernier, j’essayais autant que possible de « faire oublier » ma présence en évitant les artifices habituels de l’enquête sociologique, ce qui était proba-blement plus facile vis-à-vis du public, dans la mesure où je « sortais » le plus souvent avec des policiers en civil et où j’apprenais parfois ensuite que les personnes auxquelles nous avions eu affaire me prenaient pour un « chef » car j’étais le plus âgé, qu’à l’égard des agents, qui me disaient à l’occasion avec un sourire que si je n’avais pas été là les choses se seraient « passées » bien plus mal pour les individus qu’ils interpellaient.
Didier Fassin
75
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires
6. Du côté de la sociologie, l’ouvrage pion-nier est celui de Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individuals in Public Services, New York, Russell Sage Foundation, 1980, dont les prolongements ont été réévalués dans le dossier “Putting street-level organizations first: new direc-tions for social policy and management research”, Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), 2011, p. 199-201, sous la direction d’Evelyn Brodkin ; pour la France, ce sont notamment les livres de Vincent Dubois, La Vie au guichet.
Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, coll. « Études politiques », 1999, et d’alexis Spire, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Paris, Raisons d’agir, 2008. Du côté de l’anthropologie, on peut songer en particulier à : James Ferguson, The Anti-Politics Machine: “Deve-lopment”, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; Michael Herz-feld, The Social Production of Indifference. Exploring the Symbolic Roots of Western
Bureaucracy, New York, Berg, 1992 ; et au dossier “Bureaucracy: ethnography of the state in everyday life”, Political and Legal Anthropology Review, 34(1), 2011, p. 6-10, coordonné par anya Bernstein et Elizabeth Mertz.7. Geneviève Pruvost, Profession : policier. Sexe : féminin, Paris, Éd. de la MSH, coll. « Ethnologie de la France », 2007 ; Jérémie Gauthier, « origines contrôlées. La police à l’épreuve de la question minoritaire à Paris et à Berlin », thèse de doctorat en sociologie, Guyancourt, Université
de Saint-Quentin -en-Yvelines, 2012 ; Gwénaëlle Mainsant, « L’État et les illéga-lismes sexuels. Ethnogaphie et sociohis-toire du contrôle policier de la prostitution à Paris », thèse de doctorat en sociologie, Paris, EHESS, 2012.8. Bruno Jobert et Pierre Muller, L’état en action. Politiques publiques et corpo-ratismes, Paris, PUF, 1987.9. Veena Das et Deborah Poole (dir.), Anthropology in the Margins of the State, Santa Fe, School of american Research Press, 2004.
L’enquête s’est déroulée dans une grande agglomération de la région parisienne dont, malgré une certaine diversité sociale, la population se caractérise en moyenne par un niveau de pauvreté, une proportion de chômeurs, un pourcentage d’étrangers, un taux d’échec scolaire, des chiffres concernant la délin-quance et la criminalité qui se situent tous au-dessus de la moyenne régionale. On y trouve plusieurs grandes « cités », c’est-à-dire ensembles de logements sociaux occupés pour l’essentiel par des habitants de milieu populaire et d’origine immigrée, dont certaines bénéficient du statut administratif de « zones urbaines sensibles », qui ouvrent droits à certaines aides de l’État dans le cadre de la politique de la ville. La circonscription correspondante de sécurité publique, l’une des plus grandes d’Île-de-France par le nombre d’habitants, comporte des unités de policiers en uniforme qui circulent en voiture sérigraphiée et une brigade anti-criminalité, ou BAC, composée d’agents en civil qui se déplacent en véhicule banalisé, un appui par des groupes d’intervention départementaux pouvant avoir lieu en cas de nécessité. En patrouille, les missions des uns et des autres ne diffèrent guère, et du reste, ils inter-viennent souvent ensemble sur le terrain, à ceci près que les seconds, connus pour leur dureté, usent en effet plus libéralement de la force physique que les premiers. Ils le peuvent d’autant mieux qu’ils jouissent d’une autono-mie plus grande que leurs collègues : le chef a un rôle prépondérant ; le recrutement se fait par cooptation ; la relation hiérarchique est directe avec le commissaire. Cette organisation conduit fréquemment à des excès, dont la presse se fait régulièrement l’écho, à l’occasion d’un accident ou d’une émeute. C’est donc avec les équipages des unités en uniforme et surtout de la brigade anti-criminalité que j’ai sillonné les rues et les quartiers de cette circonscription de sécurité publique.
Ainsi, tandis que l’ethnographie de l’État, telle qu’elle s’est développée au cours des dernières décennies, initialement en sociologie, plus récemment en anthro-pologie, étudie principalement sa bureaucratie, que l’on considère depuis Weber comme le cœur du fonction-nement étatique6, des recherches récentes ont exploré, en France, divers aspects de l’activité policière à partir
d’une observation participante prolongée7. Dans cette perspective, mon enquête a opéré une sorte de décentre-ment en se focalisant sur le quotidien des patrouilles et en étudiant, en somme, « l’État en action8 ». Dans l’esprit de ce que Veena Das et Deborah Poole appellent une « anthropologie dans les marges de l’État9 », je me suis attaché à la périphérie de l’action publique, là où les policiers entrent en contact avec la population, ou plus précisément avec certaines populations margi-nalisées tant spatialement que socialement, c’est-à-dire là où leur pouvoir discrétionnaire est le plus manifeste et les politiques sécuritaires le plus revendiquées.
Scènes de la vie de banlieue
Considérons, afin de mieux appréhender la différen-ciation de l’activité policière en fonction du public, les faits suivants. Ils se déroulent en début de nuit. Deux véhicules de la brigade anti-criminalité stationnent sur le parking de la dalle d’un grand centre commercial, tous feux éteints. À quelques dizaines de mètres de là, une cinquantaine d’étu-diants d’une école de commerce située dans une ville voisine fêtent la fin de l’année scolaire sur la terrasse d’un pub et dans l’allée adjacente. La plupart semblent avoir consommé d’importantes quantités d’alcool et fument ostensiblement des cigarettes de haschich. Les policiers les observent de leur voiture. Ils commentent affablement, imaginant leur fortune (« Qui peut se payer des études à dix mille euros ? ») et s’amusant de leur naïveté (« Ils se promènent avec leurs tout nouveaux portables et en plus ils téléphonent en public ! »). Il n’y a toutefois ni envie à l’égard de la première, à laquelle ils ne conçoivent même pas pouvoir prétendre, ni colère à l’endroit de la seconde, qui risque pourtant de leur donner du travail. Bien au contraire : leurs remarques traduisent plutôt une forme d’émerveillement dans un cas, de bienveillance dans l’autre. Spectateurs de l’ombre des plaisirs d’une jeunesse privilégiée, nous restons ainsi un long moment, dans un silence rompu seulement par les éclats des voix et des rires et, de temps à autre, un début de chahut.
76
10. Ivana obradovic, « La pénalisation de l’usage de stupéfiants en France au miroir des statistiques administratives. Enjeux et controverses », Déviance et société, 36(4), 2012, p. 441-469.
Rien ne se passe. Nous finissons par quitter les lieux. Après avoir patrouil lé pendant quelque temps en centre-ville, dans l’attente d’un appel radio qui aurait pu donner un peu de relief à cette soirée trop tranquille, nous nous dirigeons, comme de coutume, vers l’un des quartiers réputés difficiles de l’agglomé-ration. Sillonnant les ruelles de la cité HLM, nous scrutons les véhicules en stationnement. Dans l’un d’eux, un homme d’une trentaine d’années d’origine maghrébine est assis à la place du chauffeur, écoutant de la musique. Nous nous arrêtons. L’homme est inter-rogé sèchement (« Qu’est-ce que tu fous dehors à cette heure ? »). Son identité est contrôlée de même que celle de sa voiture, les informations étant transmises au central téléphonique du commissariat pour s’assurer qu’il ne s’agit pas pour l’un d’un individu recherché, pour l’autre d’un véhicule volé. Après s’être enquis de l’éventuelle existence de stupéfiants (« T’es sûr que t’as pas de produits illicites avec toi ? »), les policiers se livrent à une fouille systématique, de l’homme d’abord, poches vidées de leur contenu qui est déposé sur le capot, mains sur la portière, jambes écartées, puis de la voiture, qu’ils explorent minutieusement, en soulevant les tapis et en ouvrant la boîte à gants. Tout est normal. Nous repartons. Un peu plus loin, trois jeunes discutent paisiblement sur un banc. Les policiers reconnaissent deux d’entre eux (« C’est pas les frères Boutaleb ? Allez, on les contrôle »). Nouvel arrêt, nouveaux contrôles d’identité, nouvelles fouilles à corps. Visiblement habitués (« Vous savez bien qui on est, vous nous avez contrôlés la semaine dernière »), les trois se laissent faire avec un mélange de fatalisme et d’irritation, tandis que les fonctionnaires leur adressent quelques observations ironiques. Cette fois encore, rien n’est trouvé. Tout comme l’homme dans son véhicule un peu plus tôt, les trois jeunes paraissent dépités, mais se taisent, le visage fermé. Nous reprenons notre maraude sans avoir mis la main sur une petite quantité de résine de cannabis qui aurait pu justifier une éventuelle inter-pellation. Comme c’est généralement le cas, malgré la tension perceptible, l’interaction entre les policiers et leur public s’est déroulée sans heurt. Parfois, au contraire, un commentaire insultant ou un geste brutal de la part des agents suscite protestation ou résistance, donnant lieu à une arrestation violente avec contention, au passage de menottes et à la qualification d’outrage et rébellion contre personne dépositaire de l’autorité publique.
Le contraste entre l’insolite stationnement aux abords de la fête étudiante et la routine de ces incursions dans les quartiers populaires est remarquable. Si l’on s’en tient au délit de possession et d’usage
de stupéfiants, on a, d’un côté, une ignorance volontaire de pratiques flagrantes et, de l’autre, une recherche active avec des méthodes invasives. Dans la scène évoquée, les policiers n’ont pas cherché de substances illicites parmi les élèves de l’école de commerce et n’en ont pas trouvé parmi les jeunes des cités HLM. Il arrive toutefois qu’ils en cherchent et en trouvent chez les uns comme chez les autres, mais dans ces cas, les premiers bénéficient d’une bienveillante indulgence qui se traduit par une simple admonestation, tandis que la loi s’applique avec bien plus de rigueur vis-à-vis des seconds qui nourrissent les effectifs des interpel-lations pour infraction à la législation sur stupéfiants, dont le nombre a été multiplié par soixante en quatre décennies10. Cette disparité dans l’application de la loi est d’ailleurs sous-tendue par des différences d’attitude et même, pourrait-on dire, d’émotion morale à l’égard de ces deux populations : sympathie à l’encontre des uns, ressentiment à l’égard des autres. Dans la mesure où les policiers sont en grande majorité issus de milieux modestes, on pourrait d’ailleurs déceler un paradoxe dans le fait qu’ils manifestent de l’ani-mosité envers ceux qui leur sont socialement plus proches et de la générosité en faveur de ceux qui leur sont le plus éloignés par les différentes formes de capital dont ils sont dotés. Mais ce serait, dans le premier cas, méconnaître tout ce qui les sépare de leur public, à commencer par leur milieu de socialisation, zone rurale ou ville provinciale contrastant avec le monde de la banlieue où ils occupent leur premier poste et qu’ils disent être une jungle (en très grande majorité blancs, ils ont affaire à un public principa-lement d’origine nord-africaine et sub-saharienne), et, dans le second cas, surestimer la réalité d’une conscience de classe, qui se révèle bien plus faible que leur sens de l’ordre, y compris de l’ordre social (ils manifestent volontiers de l’estime pour les catégories aisées et du mépris pour les milieux populaires).
L’interprétation de la scène pourrait en rester là. On aurait montré l’existence d’inégalité dans la mise en œuvre d’une justice rétributive : attitude tolérante à l’égard de l’usage de drogues des uns, quête opiniâtre de la possession de haschich chez les autres. On aurait du même coup réfuté l’habituel argument de la discri-mination statistique, selon laquelle les policiers s’en prennent plus souvent aux jeunes de milieu populaire et d’origine étrangère parce que la probabilité de trouver des délinquants est la plus élevée parmi eux : en l’occur-rence, si le délit auquel les policiers s’intéressaient était la possession et la consommation de stupéfiants, ils se seraient assurés un rendement plus élevé en termes
Didier Fassin
77
11. Edmund Phelps, “the statistical theory of racism and sexism”, The American Economic Review, 62(4), 1972, p. 659-661. Selon l’explication statistique de la discrimination, utilisée en économie, mais aussi en socio-logie et anthropologie du racisme, il n’est pas nécessaire d’avoir des préjugés racistes pour traiter défavorablement les personnes
de couleur. Un tel traitement peut être la conséquence d’un calcul rationnel conduisant à sélectionner des individus sur le critère racial simplement parce que la race sert de proxy pour l’objectif que l’on veut atteindre : par exemple, on pourrait ainsi expliquer qu’on contrôle et fouille plus les Noirs et les arabes parce qu’ils sont surreprésentés
dans la commission de délits. Voir également Michael Banton, “Categorical and statistical discrimination”, Ethnic and Racial Studies, 6(3), 1983, p. 269-283.12. John Van Maanen, “the asshole”, in Peter K. Manning et John Van Maanen (dir.), Policing: A View from the Street, Santa Monica, Goodyear, 1978, p. 221-
238. Les individus qui suscitaient l’hostilité a priori des policiers dans mon enquête ne correspondaient toutefois pas à la descrip-tion qui en est faite dans ce texte célèbre sur un point essentiel : il s’agissait presque exclusivement de personnes de milieux populaires appartenant à des minorités, et non de simples importuns.
d’interpellations en contrôlant et fouillant les étudiants manifestement sous l’emprise du cannabis que des jeunes de cité pris au hasard11. Pourtant, on n’aurait pas expliqué la raison de la présence prolongée de la brigade anti-criminalité près du lieu où les élèves de l’école de commerce célébraient bruyamment la fin des cours. Puisqu’ils ne voulaient pas s’en prendre à cette proie facile, pourquoi restaient-ils ? J’avais d’abord cru que les gardiens de la paix voulaient éviter que, sous l’effet de l’alcool et du haschich, des débordements ne se produisent, une bagarre n’éclate, un tapage ne suscite des plaintes du voisinage. Je me trompais. Ce n’est qu’un peu plus tard que je compris que la mission de ces unités était en l’occurrence non pas de surveiller les élèves de l’école de commerce, mais de les protéger. En station devant le pub, les agents étaient chargés de prévenir des vols que des délinquants venus des quartiers périphé-riques auraient pu commettre, profitant de la baisse de vigilance liée aux produits consommés par les étudiants. Ils devaient s’assurer que la fête se passe bien. Veiller sur la jeunesse dorée en la préservant contre de possibles agressions des jeunes des cités : telle était leur mission. Les policiers ne fermaient pas seulement les yeux sur des délits qu’ils réprimeraient un peu plus tard dans d’autres lieux, ils défendaient ceux qui les commettaient devant eux. Au fond, ils les protégeaient deux fois : de la loi et de la société.
Mais l’analyse doit aussi aller plus loin, en se situant de l’autre côté de l’invisible barrière sociale, autre-ment dit non plus du côté des étudiants que les forces de l’ordre épargnent mais du côté des jeunes qu’elles ciblent. À la lumière de l’observation évoquée, en effet, on a jusqu’à présent vu qu’en matière de stupéfiants, la répression des délits discrimine les jeunes en fonction de leur milieu social, de leur origine immigrée et de leur lieu de résidence, avec un fort recoupement de ces trois dimensions. Se contenter de ce constat serait toutefois préjuger que, dans les quartiers en diffi-culté, les policiers ne font qu’appliquer la législation, certes de façon injuste, mais non de manière infondée, puisqu’au bout du compte ils arrêtent des délinquants. Observons d’abord que, dans une cité, la découverte d’une petite quantité de cannabis dans une poche ou un recoin d’une voiture n’entraîne pas systématiquement une interpellation : une telle décision dépend de multiples facteurs, tels que le nombre d’affaires déjà réalisées, la proximité de la fin du service, l’humeur
des agents, l’attitude du contrevenant, et surtout l’histoire antérieure des relations entre les premiers et le second, la possession de substances illicites étant l’occasion d’arrêter un individu avec lequel les policiers ont un compte à régler (« Ce bâtard, on va lui faire tomber son sursis », disaient-ils parfois, menaçants, à propos d’un homme récemment condamné à une peine de prison non ferme qu’ils jugeaient trop généreuse, mais leur hostilité pouvait trouver son origine dans le simple fait qu’il s’agissait d’un « type qui fait son malin » ou d’un « gars qui veut jouer au con avec nous »)12.
Interrogeons-nous ensuite sur les raisons qui conduisent les policiers à se livrer ainsi à ces pratiques de contrôles d’identité et de fouilles à corps de façon réitérée parmi les jeunes de milieu populaire et d’ori-gine immigrée (ceux qu’ils appellent des « bâtards ») : s’il s’agissait seulement d’arrêter des usagers de drogues, d’une part, tous ceux qu’on trouve en possession de haschich devraient faire l’objet d’une interpellation, ce qui n’est pas le cas, et, d’autre part, la procédure n’appellerait pas la multiplication de brimades, voire de brutalités qui caractérisent ces interactions ; c’est donc autre chose dont il s’agit.
Parlant de l’attitude des jeunes de quartiers populaires confrontés à ce harcèlement quotidien, le commissaire en charge de la sûreté me l’exprimait sans ambages : « Ils ont l’habitude de se faire contrôler. Pour eux, c’est pas du racisme. C’est comme ça. On les contrôle, même quand ils ne font rien de mal. C’est illégal, on le sait, mais on le fait quand même. Et eux, ils ont l’habitude. Ils donnent leurs papiers : ils les ont toujours sur eux. Ils vident leurs poches. Ils mettent les mains sur le toit de la voiture. Ils écartent les jambes. Ils se laissent fouiller. On n’a pas le droit non plus de les fouiller, s’ils n’ont rien fait. Mais ça n’empêche : on le fait. » Son propos, particulièrement explicite, appelle trois remarques.
Premièrement, la dénégation de racisme est une manière de souligner précisément la dimension raciale de ces pratiques, c’est-à-dire le fait qu’elles concernent avec une particulière fréquence des individus d’origine maghrébine ou africaine. Cet élément, longtemps contesté, y compris dans les milieux de la recherche, a été récemment objectivé par une étude quantita-tive conduite par Open Society qui révèle que, dans les gares parisiennes, les « Noirs » et les « Arabes » ont respectivement six et huit fois plus de chances d’être
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires
78
13. Justice Initiative, Police et minorités visibles : les contrôles d’identité a Paris, New York, open Society, 2009. on notera que cette étude pionnière a été réalisée par une fondation étasunienne.14. Jerome H. Skolnick, Justice Without Trial. Law Enforcement in Democratic Society, New York, Macmillan, 1994 [1re éd. 1966]. L’auteur convient qu’il peut exister des points de vue différents sur ce caractère raisonnable, selon qu’on est un policier ou un citoyen.15. John alan Lee, “Some structural
aspects of police deviance in relation to minority groups”, in Clifford Shearing (dir.), Organizational Police Deviance. Its Structure and Control, Scarborough, But-terworth, 1981, p. 49-82. Le sociologue canadien parle de « police property » pour désigner des catégories de population dont la société délègue la prise en charge principalement aux forces de l’ordre. La formule est traduite par « clientèle policière » ou « gibier de police », ce qui lui donne un sens un peu différent, manquant notamment l’idée de ce pouvoir
délégué qui constitue la priorité, in Fabien Jobard, « Le gibier de police immuable ou changeant ? », Archives de politique crimi-nelle, 32(1), 2010, p. 93-105 (le texte qui sert de base à cet article y est attribué par l’auteur à John Lea présenté comme « sociologue anglais » par confusion avec cet autre criminologue qui, lui, appartient en effet à l’école réaliste britannique).16. Richard V. Ericson, Reproducing Order: A Study of Police Patrol Work, toronto, University of toronto Press, 1982.17. C. J. Fischer et Rob I. Mawby, “Juvenile
delinquency and police discretion in an inner-city area”, British Journal of Criminology, 22(1), 1982, p. 63-75.18. Douglas Smith et Christy Visher, “Street-level justice: situational determi-nants of police arrest decisions”, Social Problems, 29(2), 1981, p. 167-177 ; Clive Norris, Nigel Fielding, Charles Kemp et Jane Fielding, “Black and blue: an analysis of the influence of race on being stopped by the police”, British Journal of Sociology, 43(2), 1992, p. 207-224.
contrôlés que les « Blancs »13. L’ethnographie permet du reste d’affiner le constat en établissant l’existence de différences qualitatives dans la façon de traiter ces populations, de leur parler, d’user de la force, de recourir à la provocation. Deuxièmement, l’affirma-tion du caractère illégal des pratiques, tant en matière de contrôle d’identité que de fouilles à corps, révèle la banalisation de la violation de la loi par l’institution supposée la faire respecter, et ce malgré les multiples condamnations par les tribunaux, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le Conseil constitutionnel. Il est certes depuis longtemps établi que les policiers ne respectent pas la loi et Jerome Skolnick va même jusqu’à dire qu’il serait « irréaliste » de le croire possible, car pour procéder à un contrôle d’identité ou à une fouille à corps, ils doivent se fier avant tout à leur sens du caractère « raisonnable » de ces pratiques au regard de la probabilité d’obtenir un résultat14. C’est pourtant supposer que l’efficacité de ces pratiques réside dans l’arrestation de délinquants et de criminels, ce qui est loin d’être la principale raison d’être des contrôles et des fouilles puisqu’elles sont, de l’aveu même de la hiérarchie, le plus souvent inutiles. Troisièmement, en effet, l’assujettissement des populations défavorisées apparaît comme le résul-tat ultime de ces pratiques qui les constituent comme « propriété de la police15 ». Les jeunes se soumettent docilement au traitement humiliant qui leur est imposé, sachant que c’est leur lot, compte tenu de leur position dans la société, et que la moindre réaction de leur part ne pourrait qu’aggraver leur situation, chose que leurs parents leur enseignent dès l’adolescence : « ne pas répondre aux provocations de la police » est un leitmotiv de la pédagogie familiale des cités.
Ce qui apparaît ainsi au terme de l’analyse de ces scènes ordinaires de la vie de banlieue est une réalité assurément plus complexe que celle dépeinte dans le discours des autorités. La police, peu s’en étonne-ront, se comporte, en matière de contrôles, de fouilles et de sanctions, de manière différenciée en fonction des publics auxquels elle a affaire, ciblant les classes populaires et les minorités ethniques, en particulier dans l’habitat social. Mais cette discrimination
implique plus qu’une simple distribution inéquitable des pratiques répressives : elle en engage la signification même. En protégeant les jeunes de milieu aisé, c’est-à-dire en leur épargnant les duretés de la loi et en les prémunissant contre d’éventuelles agressions, tout en assujettissant les jeunes de milieu populaire, par des actions visant moins à arrêter des délinquants ou prévenir des délits qu’à marquer leur pouvoir sur des corps, les policiers font tout autre chose que ce que l’on dit ou croit qu’ils font. Comme le montre également Richard Ericson16 dans son étude sur les patrouilles de police canadienne, loin de se contenter de défendre l’ordre public, ils contribuent à la repro-duction d’un ordre social dans lequel chacun reste à sa place – ou mieux : apprend à la tenir. Lors des nombreux contrôles d’identité et fouilles à corps auxquels j’ai assisté, je constatais qu’à la différence des jeunes des classes supérieures, rarement soumis à cet exercice il est vrai, mais qui pouvaient faire preuve d’insolence lorsqu’ils l’étaient, les jeunes des quartiers difficiles se pliaient en silence, amers mais résignés, à ces pratiques coercitives. Une fonction sociale essentielle du travail policier réside ainsi dans ce processus d’inculcation, par la contrainte physique, et finalement d’incorporation, par la force de l’habitude, de l’ordre social.
Arrivé à ce point de l’interprétation, on serait tenté de ne voir dans les faits rapportés que l’expression, abondamment documentée dans la littérature savante, du pouvoir discrétionnaire de la police17. Il est bien établi que les agents décident de contrôler ou non, de fouiller ou non, d’interpeller ou non selon la couleur de la peau, le quartier de résidence, l’évaluation morale de l’individu, l’attitude vis-à-vis des forces de l’ordre, la connaissance des antécédents judiciaires, la présence de témoins18. Au fond, tout se jouerait ici et maintenant dans l’interaction entre la police et son public, déterminée par une série de variables renvoyant à des représentations ou des pratiques individuelles. L’approche quantitative, rendue nécessaire par le souci d’établir l’existence de discriminations et d’en expli-quer les raisons, a ainsi conduit la plupart des études criminologiques à s’en tenir à une approche isolant
Didier Fassin
79
PRoPoSItIoN de récépissé de contrôle d’identité.
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires
80
19. Donald Black, “the social organization of arrest”, Stanford Law Review, 23(6), 1971, p. 1087-111. Depuis cette étude classique, les travaux se sont multipliés pour récuser, confirmer ou affiner les analyses établissant l’existence de dis-criminations raciales dans les « rencon-
tres » entre la police et son public, en particulier les jeunes, avec notamment, dans une abondante littérature : John Hepburn, “Race and the decision to arrest: an analysis of warrants issued”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 15, 1978, p. 54-73 ; Douglas Smith, Christy
Visher et Laura Davidson, “Equity and discretionay justice: the influence of race on police arrest decisions”, The Journal of Criminal Law and Criminology, 75(1), 1984, p. 234-249 ; Stephen D. Mastrofski, Michael D. Reisig et John D. McCluskey, “Police disrespect toward the public: an
encounter-based analysis”, Criminology, 40(3), 2002, p. 519-552.20. Gaétan alibert, Séminaire « Police et poli t ique du chif fre », Fondation Copernic, 13 mai 2010, http://vimeo.com/11709244.
la situation de son contexte19. Ce modèle étroitement interactionniste a servi à critiquer l’action de la police, en montrant les différences de traitement en fonction des caractéristiques sociales ou raciales des publics et les préjugés s’y rattachant, ou, à l’inverse, à la justifier, en découvrant derrière ces différences de traitement des rationalités cohérentes et justifiables. Dans tous les cas, c’est en somme laisser les policiers seuls face à leurs actes, comme le font du reste les institutions lorsqu’elles en jugent les déviances dans des commis-sions de discipline ou, beaucoup plus rarement, des tribunaux correctionnels, et c’est du même coup exonérer les autorités et plus largement la société de leur responsabilité dans la manière dont la police définit et accomplit ses missions.
Variations sur le thème du chiffre
Un soir, alors que l’absence habituelle d’activité rend l’ambiance particulièrement morose et favorise les plaintes à l’égard de l’ingratitude du public, de l’indulgence des magistrats et de l’incompréhension de la hiérarchie, les membres de l’équipage du véhicule dans lequel je me trouve engagent une discussion sur la publication dans la presse de documents révélant l’existence d’objectifs quantitatifs assignés, notamment en matière de contraventions au code de la route, dans plusieurs villes de France. Apprenant que le ministère de l’Intérieur dément cette information, l’un des policiers de la brigade anti-criminalité commente à mon inten-tion : « Ils me font marrer à dire qu’on ne doit pas faire du chiffre : quelle hypocrisie ! Le chef nous a dit qu’il fallait faire trente interpell’ par mois. Si on n’y arrive pas, il suffit de faire des ILS et des ILE. C’est le commissaire lui-même qui l’a expliqué. » Acronymes d’usage courant au sein des forces de l’ordre, les ILS correspondent à des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour l’essentiel possession de petites quantités de cannabis destiné à l’usage person-nel, et les ILE à des infractions à la législation sur les étrangers, autrement dit défaut de titre de séjour en règle. Le policier ajoute : « Dans la circonscription où j’étais avant, c’était moins. Le chef nous avait dit que si on faisait six à sept gardes à vue par mois, on nous foutrait la paix. Alors, on les faisait – avec des shiteux. » Cette réorientation de leur pratique – du flagrant délit sur des affaires sérieuses à l’interpellation d’usagers
de drogues et d’étrangers en situation irrégulière – n’enthousiasme guère les agents. L’un d’eux me confie, un jour que nous attendons le retour de son collègue convoqué par la commission de discipline pour partir en patrouille : « Si c’est pour ramasser des shiteux, c’est pas pour ça que j’ai fait ce travail. Moi, je suis entré dans la police pour attraper des voleurs. Je me rends compte que ce qu’on fait ne sert à rien. Tout ce qui compte c’est de faire du chiffre. Un gars avec une boulette de shit, c’est une mise à disposition, les chefs sont contents. » Il est vrai que ces derniers font alors l’objet, à tous les niveaux de la hiérarchie, d’un contrôle qui va, au début des années 2000, jusqu’à la convocation par le ministre de l’Intérieur des préfets et directeurs départementaux de la sécurité publique obtenant les moins bons résultats sur le plan national.
Au sein de l’hôtel de police, comme au niveau de la Direction centrale de la police nationale, l’existence de ces objectifs quantitatifs fait cependant l’objet d’une dénégation farouche. Le commissaire, à qui j’avais posé la question, s’en était même offusqué, contestant avoir établi de tels indicateurs. Plusieurs gardiens de la paix m’avaient toutefois fourni des infor-mations convergentes sur ce qu’on attendait d’eux désormais en termes d’interpellations : les objectifs étaient nettement supérieurs à ce qu’ils étaient en mesure de réaliser au regard de la criminalité acces-sible à l’action policière et, de fait, au vu des perfor-mances constatées avant la mise en place de la nouvelle politique. Le mot d’ordre officiel était néanmoins que ces objectifs chiffrés n’existaient pas. Les fuites qui s’étaient produites dans la presse relevaient donc de maladresses, car comme l’indiquait un syndi-caliste de Sud Intérieur20, « dans cette politique, le pouvoir n’utilise que très peu l’écrit qui peut juste-ment permettre au policier de se défendre : “moi, mon commissaire m’a sorti une note de service, je suis obligé d’obéir, c’est un ordre” », une défense toutefois doublée de frustration, car « quand même, est-ce que c’est normal qu’on m’écrive qu’il faille que j’interpelle chaque jour tant de personnes pour tel délit ? ». S’il est en effet un élément de l’action conduite par le ministère de l’Intérieur de 2002 à 2012 qui fait quasiment l’unanimité contre lui au sein des forces de l’ordre, c’est bien ce qu’on a appelé la « politique du chiffre », à savoir l’évaluation de l’activité au regard d’objectifs quantitatifs fixés
Didier Fassin
81
21. albert ogien, « La valeur sociale du chiffre. La quantification de l’action publique entre performance et démocra-tie », Revue française de science écono-mique, 1(5), 2010, p. 19-40.22. Dominique Montjardet, « Comment apprécier une politique policière ? Le premier ministère Sarkozy (7 mai 2002-30 mars 2004) », Sociologie du travail, 48(2), 2006, p. 188-208.23. Philippe Robert et Marie-Lys Pottier,
« Les préoccupations sécuritaires : une mutation ? », Revue française de sociolo-gie, 45(2), 2004, p. 211-242. 24. Didier Fassin, alain Morice et Catherine Quiminal (dir.), Les Lois de l’inhospitalité. Les politiques de l’immigration a l’épreuve des sans-papiers, Paris, La Découverte/Essais, coll. « Cahiers libres », 1997 ; et Laurent Mucchielli, Violences et insécu-rité. Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, La Découverte, 2001. Si la
droite traditionnelle commence à s’aligner sur le Front national, la gauche socialiste n’est cependant pas en reste, Laurent Fabius déclarant en septembre 1984 : « L’extrême droite, ce sont de fausses réponses à de vraies questions » et met-tant en place peu après les premières restrictions au regroupement familial.25. Loi du 9 septembre 1986, assimilant de séjour irrégulier à un trouble à l’ordre public et donnant au préfet le droit de pro-
noncer une mesure de reconduite à la fron-tière. Loi du 22 juillet 1993, restreignant les conditions d’obtention de la nationalité française. Loi du 10 août 1993, étendant le contrôle d’identité à titre préventif, indépendamment du comportement de la personne. Loi du 24 août 1993, allongeant la durée possible de rétention, limitant les possibilités d’intervention du juge et permettant d’assortir la reconduite à la frontière d’une interdiction du territoire.
a priori en fonction de la situation locale. La suppression de cette politique du chiffre reste symboliquement la première réforme pratique annoncée par le nouveau ministre de l’Intérieur du gouvernement de gauche après les élections nationales de 2012.
La politique du chiffre pourrait être considérée, au premier abord, comme la simple application au domaine de la sécurité d’une transformation de grande ampleur de l’action publique visant à instituer un mode de « gouverner au résultat » dont la LOLF, loi organique relative aux lois de finances, votée en 2001 et générali-sée à toute l’administration en 2006, représente la forme la plus universelle21. Elle est toutefois bien plus que cela, car la « culture du résultat » instituée dans la police par Nicolas Sarkozy, d’abord comme ministre de l’Intérieur à partir de 2002, puis comme prési-dent de la République à partir de 2007, s’inscrit plus dans une stratégie de communication politique que dans une logique de rationalisation budgétaire22. Ayant identifié les « préoccupations sécuritaires » de la population comme un enjeu électoral majeur, que la campagne présidentielle de 2002 a spectaculaire-ment révélé23, le nouveau locataire de la Place Beauvau en fait son cheval de bataille pour la conquête de l’Élysée. Les statistiques de la délinquance et l’action de la police deviennent les moyens privilégiés de la communication politique, ce qui est d’autant plus facile que la France, à la différence d’autres pays occidentaux comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, se caractérise par une organisation nationale et centralisée de ses forces de l’ordre. L’instrumentalisation récente de la question de l’insécurité à des fins électorales et le développement d’actions censées y apporter une réponse doivent toutefois être resituées dans la perspective longue des transformations politiques et structurelles intervenues depuis près d’un demi-siècle.
Sur le plan politique, en effet, les années 1980 sont marquées par deux événements majeurs : d’une part, la gauche conquiert le pouvoir en 1981 après 23 ans de suprématie de la droite ; d’autre part, l’extrême droite connaît une croissance rapide à tous les scrutins à partir des élections municipales de 1983. Fait nouveau sous la Ve République, les partis conservateurs se trouvent donc pris entre deux feux. Face à la montée
du Front national, le choix est fait de reprendre à ce dernier ses deux principaux thèmes de campagne, à savoir l’insécurité et l’immigration, du reste souvent associés24. Le bref retour au pouvoir du parti gaulliste en 1986, puis pour une période plus longue à partir de 1993, est l’occasion de mettre en œuvre une double politique de lutte contre l’insécurité et de contrôle de l’immi-gration, accompagnée d’un discours de plus en plus explicitement racialisé, raciste et xénophobe25. Ministre de l’Intérieur sous les deux gouvernements conser-vateurs de cohabitation, Charles Pasqua est l’artisan d’importantes réformes modifiant dans le sens d’un durcissement le code pénal et le code de procédure pénale, d’une part, la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers et le code de la nationalité, d’autre part. Au cours des trois dernières décennies, la radicalisation des discours et des réglementations autour de ces deux thèmes s’est toutefois étendue à l’ensemble du spectre électoral, incluant la gauche lorsqu’elle est au pouvoir pendant cette période. Elle se traduit à la fois par une incessante réécriture de la loi et par une application de plus en plus stricte de cette dernière.
Ainsi, les conditions de réalisation légale des contrôles d’identité font l’objet d’un élargissement à un but préventif, et non plus seulement répressif, permettant de les justifier presque dans n’importe quelle circonstance ; de nouveaux délits sont créés, tels l’occupation des halls d’immeuble ou l’outrage à l’hymne national, tandis que d’autres donnent lieu à une répression plus systématique, comme l’usage de stupéfiants ; les gardiens de la paix sont encouragés à déposer plainte pour outrage et rébellion à personne dépositaire de l’autorité publique ; les procédures de jugement en temps réel et notamment de compa-rution immédiate pour les majeurs et de présentation immédiate pour les mineurs se multiplient ; l’instau-ration de peines plancher réduit les possibilités d’indi-vidualisation des peines par les magistrats. Conforté par une rhétorique de la peur, cet arsenal de lois et de mesures, qui constitue le « problème de l’insé-curité » et la « question immigrée » en même temps qu’il semble lui apporter des solutions, apparaît comme d’autant plus remarquable qu’il se déploie dans une période où les statistiques officielles de la criminalité
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires
82
26. Laurent Mucchielli et Philippe Robert, Crime et sécurité. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, coll. « L’état des savoirs », 2002.27. oCDE, Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par la France de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, octobre 2012, http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/FrancePhase3FR.pdf.28. Jean-Marie Delarue, Banlieues en diffi-cultés. La relégation, Rapport au ministre
d’État, ministre de la Ville et de l’aménage-ment du territoire, Paris, Syros alternatives, 1991 ; Éric Maurin, Le Ghetto français. Enquête sur le séparatisme social, Paris, Seuil/La République des idées, 2004.29. Douglas Massey et Nancy Denton, American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass, Cambridge (Ma), Harvard University Press, 1993.30. Patrick Peretti-Watel, François Beck et Stéphane Legleye, « Usagers interpellés,
usagers déclarés : les deux visages du fumeur de cannabis », Déviance et société, 28(3), 2004, p. 335-352.31. Becky Pettit et Bruce Western, “Mass imprisonment and the life course: race and class inequality in US incarceration”, American Sociological Review, 69(2), avril 2004, p. 151-169.32. Ezekiel Edwards, Will Bunting et Lynda Garcia, The War on Marijuana in Black and White, New York, american Civil Liberties
Union, 2013, 185 p. En 2010, la propor-tion d’usagers de marijuana au cours des douze derniers mois était de 14,0 % parmi la population noire et de 11,6 % au sein de la population blanche ; ces chiffres étaient de 27,6 % et 33,4 % respectivement pour ces deux catégories dans le groupe des 18 à 25 ans. Les Noirs avaient cependant 3,73 fois plus de risque d’être arrêtés pour simple usage, cet écart atteignant 5 lorsqu’il s’agissait des districts les plus pauvres.
montrent un déclin régulier des actes les plus graves, à savoir les homicides mais également les cambriolages26. Les augmentations de la délinquance qui alimentent le débat public et les inquiétudes de la population concernent principalement des déplacements de la définition des délits et traduisent donc surtout une moindre tolérance à des formes diverses d’incivilité et un accroissement des tensions entre classes sociales. Le tournant répressif ne vise cependant pas de manière uniforme toute la population. Il est à cet égard signi-ficatif que la sévérité affichée à l’encontre de la petite délinquance voire de la simple incivilité s’accompagne d’une tolérance croissante à l’égard de la criminalité financière et des pratiques de corruption, à propos de laquelle un rapport de l’OCDE fustige la France27. En fait, la politique pénale de l’État cible de façon parti-culière certains délits, certains territoires, certaines catégories qui ont été progressivement circonscrits par les discours publics et les textes juridiques.
Car, sur le plan structurel, la société française a connu des transformations importantes depuis le début des années 1980. La résorption des bidon-villes où s’entassaient les familles immigrées et des cités d’urgence où se concentrait un certain prolétariat français s’est effectuée dans le cadre de programmes d’habitat social aboutissant à la création de grands ensembles au sein desquels la mobilité sociale et la diver-sité ethnique ont rapidement décliné, aboutissant à une ségrégation des classes populaires d’origine immigrée africaine dans ces logements sociaux délaissés par les pouvoirs publics28. Les violences urbaines qui se sont multipliées à partir du début de la décennie 1980 ont brutalement révélé cette réalité, où la conjonction des dimensions spatiales, sociales et raciales reproduit, sur un mode particulier à l’histoire tant urbaine que coloniale de la France, des schèmes bien étudiés dans d’autres contextes29, soulignant le rôle des discrimina-tions, qui y sont demeurées longtemps méconnues voire niées. Pendant les trente dernières années, alors que les disparités s’approfondissaient entre ces territoires et le reste du territoire national, la réponse gouverne-mentale a été principalement de deux ordres. D’un côté, la mise en place d’une politique de la ville a consisté en une série de mesures ponctuelles, modestes et discontinues
ciblées sur ce que le langage administratif a désigné comme des « zones urbaines sensibles ». De l’autre, le déploiement de dispositifs de répression s’est opéré à travers la multiplication de réponses spécifiques, en particulier la technique de saturation de l’espace par l’importance des effectifs policiers, comme lors d’une série d’interpellations dans une cité de Villiers-le-Bel qui a mobilisé un millier d’agents en 2008, et le recours à des unités spéciales, notamment les brigades anti-crimina-lité, dont la première a été créée à Paris en 1993. L’État a ainsi largement privilégié la dimension punitive de son intervention par rapport à la dimension réparatrice.
Mais il ne suffit pas de dire que l’État pénal a pris le pas sur l’État social. Il faut aussi comprendre que l’application même de la politique répressive est sélective. Ainsi qu’on l’a vu dans le cas discuté au début, la crimi-nalisation de l’usage du cannabis vaut pour les jeunes des quartiers populaires, mais non pour les étudiants d’école de commerce. Il importe donc, dans la discus-sion de l’action publique, de distinguer ce qui relève de la justesse (par exemple, doit-on criminaliser l’usage de cannabis ?) et ce qui relève de la justice (en l’occur-rence, criminalise-t-on tous les usagers de la même façon ?). Or, le débat sur la législation en matière de stupéfiants porte presque toujours sur le premier aspect, qui sert alors à occulter le second30. On sait qu’aux États-Unis la « guerre contre la drogue » n’a pas seulement conduit à une multiplication par cinq de sa population pénale en un quart de siècle, plaçant ce pays au premier rang mondial pour la proportion de ses habitants incarcé-rés. Elle a aussi été ciblée sur les quartiers d’habitat social et les populations noires pauvres, aboutissant à ce que la probabilité d’avoir connu la prison pour un trentenaire est de 3 % pour un Blanc et 20 % pour un Noir, s’élevant à 60 % parmi ces derniers lorsqu’ils n’ont pas achevé leur scolarité31. Or les études statistiques établissent que ce n’est pas la fréquence de l’usage de drogues qui diffère entre ces groupes mais le profilage socio-racial effectué par la police. Ainsi, une enquête conduite au niveau national établit que, tandis que la proportion de consommateurs de marijuana est quasiment équivalente parmi les Blancs et parmi les Noirs, le risque d’être arrêté pour cette raison est 3,73 fois plus élevé pour les seconds que pour les premiers32. On ne dispose pas de statistiques
Didier Fassin
83
33. Marie-Danièle Barré, thierry Godefroy et Christophe Chapot, Le Consommateur de produits illicites et l’enquête de police judiciaire, Étude exploratoire à partir des procédures de police judiciaire, Paris, observatoire français des drogues et
des toxicomanies, 19, mars 2000, 55 p. L’enquête, très détaillée, ne donne comme caractéristique des individus interpellés pour usage de drogues que le groupe d’âge (mineur ou majeur), l’existence d’une activité (est scolarisé ou a une profession) et la pré-
sence d’antécédents judiciaires. Il n’est pas donné d’indication sur la catégorie socio-professionnelle, la nationalité ou l’origine.34. observatoire français des drogues et des toxicomanies, Drogues, chiffres clés, Saint-Denis-La-Plaine, oFDt, juin 2013, 8 p.
35. Cécile Barberger, Caroline Moreau et Brigitte Munoz Perez, Le Contentieux judiciaire des étrangers, Paris, ministère de la Justice, Direction des affaires civiles et du sceau, janvier 2008, 73 p.
permettant de telles comparaisons pour ce qui concerne la France, car ni la nationalité des individus interpellés ni a fortiori leur phénotype ne semblent avoir fait l’objet d’étude33. Cependant, pour des raisons qui tiennent aux différences de lieux d’usage (espace public ou privé) et aux disparités des pratiques policières (quartiers visités, individus fouillés) plus qu’aux différences de fréquence de consommation, le risque d’être interpellé pour usage de stupéfiants est considérablement plus élevé parmi les jeunes de milieu modeste et d’origine immigrée que parmi les jeunes des classes moyennes et supérieures et d’apparence européenne.
Au demeurant, la politique du chiffre s’est révélée un outil particulièrement efficace pour accentuer cette évolution. Compte tenu de la délinquance accessible, c’est-à-dire à la fois de la quantité et des caractéristiques des actes délictueux commis (très fréquents, les vols de téléphone portable donnent très rarement lieu à un flagrant délit car la police ne peut arriver sur place à temps), les objectifs fixés dans les années 2000, variables en fonction des circonscriptions et des unités, étaient généralement inatteignables. Ils reposaient sur deux critères : le nombre d’actes et le taux d’élucidation. Le premier pouvait correspondre à des contraventions, des arrestations, des gardes à vue, etc., tandis que le second mesurait la proportion de cas où le coupable était identifié. De façon à réali-ser les objectifs déterminés par leur hiérarchie en termes d’interpellations, les policiers de la brigade anti-criminalité complétaient leurs statistiques avec deux types de délit, qu’ils qualifiaient de « variables d’ajustement » : les infractions à la législation sur les stupéfiants et les infractions à la législation sur les étrangers. Dans les deux cas, les prises étaient faciles. Dans les deux cas, le coupable était arrêté. Le nombre d’actes augmentait avec le taux d’élucidation.
Dans la mesure où un dixième des jeunes de 17 ans disent être consommateurs de cannabis34, on comprend qu’il n’est pas difficile de trouver des usagers en posses-sion d’une petite quantité de résine. Les policiers ne les cherchaient cependant jamais aux alentours des lycées ou des universités, pas plus qu’ils ne se livraient à de telles investigations dans les zones résidentielles de l’agglomération. Les quartiers d’habitat social, ainsi que certains sites de centre-ville fréquentés par les jeunes des cités, bénéficiaient en revanche de toute leur attention et le ciblage des contrôles d’identité et des fouilles des individus et, le cas
échéant, de leur véhicule conduisaient à ne trouver des produits illicites que parmi ces jeunes. Durant les quinze mois de mon enquête, toutes les inter-pellations pour usages de stupéfiants auxquelles j’ai assisté concernaient ces derniers. Quant aux étrangers en situation irrégulière, la publicité faite par le gouvernement autour du nombre de reconduites à la frontière redoublait les effets plus généraux de la politique du chiffre, en faisant de ces interpella-tions une priorité, souvent rappelée par les supérieurs. Il était là encore aisé de les réaliser, soit au hasard de rencontres lors des patrouilles, soit à l’occasion de coups de filet organisés notamment à la sortie des gares. Presque toujours, les contrôles d’identité réalisés dans ces conditions étaient illégaux, puisqu’ils étaient orientés en fonction de l’apparence de la personne et relevait donc de pratiques typiquement discrimi-natoires, condamnés par la justice dans les rares cas où ils donnaient lieu à plainte35. Mais les agents savaient bien que ce n’étaient pas les Maliens, les Algériens ou les Turcs sans titre de séjour qui se plaindraient de ces irrégularités et, quand bien même le juge des libertés et de la détention les relèverait au tribunal lors de la décision de maintien en local de rétention, cela n’aurait plus guère d’importance, car l’acte serait déjà comptabilisé, son élucidation avérée et même, devrait-on ajouter, l’effet d’intimidation des étrangers obtenu.
Effectuer ces prises sans gloire n’était assurément pas du goût d’une partie des policiers qui ne concevaient pas ainsi leur fonction sociale : interpeller des « shiteux » et des « sans-papiers » quand ils s’étaient imaginés, du moins le disaient-ils, dans le rôle plus noble de celui qui arrête « des voleurs et des voyous » était une forme de déclassement et une source de désillusion, dont ils me faisaient parfois part dans les longues heures passées à patrouiller en voiture dans l’attente, souvent déçue, d’un appel pour une intervention. Ils s’y résignaient cependant. Certains affirmaient choisir d’orienter leurs actions préférentiellement vers l’une ou l’autre de ces cibles faciles en fonction de critères moraux ou idéologiques. Quelques-uns déclaraient « faire des ILS », considérant ces infractions plus sérieuses que la simple absence de titre de séjour et la reconduite à la frontière plus pénalisante que la sanction pour usage de cannabis. D’autres s’enorgueillissaient au contraire de « faire des ILE » en expliquant que, puisqu’ils trouvaient qu’il y avait trop d’immigrés dans le pays, ils accomplissaient une œuvre d’intérêt national.
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires
84
ÉCUSSoNS DE BRIGaDES aNtICRIMINaLItÉ de la région parisienne. « on en était arrivé à une situation avec un chef de meute et une meute qui allaient produire plus de dégâts en allant sur le terrain et en fonctionnant comme ça que régler des problèmes. Il fallait qu’on remette de l’ordre dans la BaC, parce que c’est elle qui nous fait le plus de dommages à l’extérieur. Et ce qui était vrai dans ce département pouvait l’être aussi ailleurs. » (ancien responsable du Service d’ordre public d’un département de la région parisienne, janvier 2008).
Didier Fassin
85
Lors de la campagne présidentielle de 2007, l’expression de cette hostilité à l’encontre des étrangers devint d’ailleurs plus manifeste tandis que les thèmes traditionnellement de l’extrême droite se faisaient plus présents dans les discours de la droite, conformément à la stratégie reven-diquée de reconquête de l’électorat du Front national. Dans les semaines qui précédèrent et suivirent l’élec-tion annoncée et finalement remportée par Nicolas Sarkozy, le local de la brigade anti-criminalité se couvrit de posters et d’autocollants à caractère ouvertement raciste et xénophobe. Lors des sorties en patrouille dans la ville, le chef de l’unité et les membres de plusieurs équipages arboraient fièrement un tee-shirt noir sur lequel on pouvait lire, entre un drapeau français et un casque franc, l’inscription « Patriot 732 ». Les chiffres se référaient à la bataille de Poitiers dont le récit national a fait un événement historique marquant l’arrêt de la progression des Arabes vers le nord et symbo-lisant la victoire de l’Europe chrétienne sur l’envahisseur musulman. Ces policiers étaient ceux qui, sur le terrain, se montraient le plus provocateurs à l’égard des jeunes d’origine immigrée, cherchaient le plus ouvertement à les humilier et recouraient le plus facilement à l’insulte et à la brutalité lors des contrôles et des fouilles, dans l’attente d’une réplique ou d’un geste qui permettrait une interpellation pour outrage et rébellion contre personne dépositaire de l’autorité publique. Un commissaire, qui faisait toujours preuve d’un grand sens du devoir et dont le discours n’avait jamais trahi la moindre sympathie envers l’extrême droite, m’expliqua qu’il lui était difficile d’intervenir pour interdire le port de ce tee-shirt, car il y perdrait la confiance de ses hommes dont il avait besoin pour rester informé de ce qui se passait sur le terrain. Il est vrai que les dérives de l’État sur le terrain faisaient écho à celles qui s’exprimaient dans le discours de ses plus hauts responsables, multipliant les commentaires stigmatisants sur les étrangers en général, les Africains et les musulmans en particulier.
Assurément, il existait au sein de l’unité – et a fortiori au sein du commissariat – des policiers qui ne partageaient pas les idées racistes et xénophobes de leurs collègues. Ils se montraient généralement plus respectueux tant des règles de leur métier que des habitants de la circons-cription. Certains se révélaient du reste plus efficaces dans la réalisation de leurs objectifs sans avoir à en passer par les interpellations d’usagers de cannabis ou d’étrangers en situation irrégulière. Le fait remar-quable était cependant l’aisance avec laquelle les membres les plus radicaux et violents de la brigade anti-criminalité exhibaient les marqueurs de leur idéologie et la licence dont ils bénéficiaient de la part de leurs supérieurs et même des autres membres. Comme je me deman-dais si le lieu où j’avais conduit mon enquête était une exception, j’eus un élément de réponse à l’occasion
d’un entretien avec un ancien responsable départemental du Service d’ordre public. Lorsqu’il avait pris ses fonctions plusieurs années auparavant dans la région parisienne, il s’était efforcé, m’expliqua-t-il, de réformer la brigade anti-criminalité qui opérait sur son territoire en se rendant compte que « son fonctionnement relevait du copinage avec des gens qui n’étaient pas formés et qui avaient été recrutés par le biais d’amitiés pas toujours très saines ». Il ajouta : « On en était arrivé à une situation avec un chef de meute et une meute qui allaient produire plus de dégâts en allant sur le terrain et en fonctionnant comme ça que régler des problèmes. Il fallait qu’on remette de l’ordre dans la BAC, parce que c’est elle qui nous fait le plus de dommages à l’extérieur. Et ce qui était vrai chez nous pouvait l’être aussi ailleurs. » Basée sur une expérience initiale dans un autre département que celui où j’avais conduit mon enquête et sur des responsabilités nationales ultérieures qui lui donnaient une vision bien plus ample que la mienne, sa remarque confortait mes observations ethnographiques.
Plusieurs autres témoignages de policiers, de magistrats, de fonctionnaires territoriaux et d’élus locaux, notam-ment après la sortie de mon livre, me montrèrent que mes observations n’étaient pas isolées et que mon étude de cas ne concernait pas un cas limite, mais reflétait une réalité qui n’étonnait guère certains « acteurs de terrain ». Pour autant, cette enquête ne pouvait évidem-ment prétendre à une quelconque représentativité, puisque je n’avais été en mesure de la conduire que dans une circonscription de sécurité publique, mes demandes ultérieures d’autorisation de recherche ayant été rejetées. En revanche, ce que l’ethnographie rendait possible, c’est l’analyse fine des faits eux-mêmes (par exemple, la reconnaissance de formes de discrimination que les approches légales rendent invisibles) et des mécanismes qui les sous-tendent (notamment la manière dont les discours et les injonctions des autorités favorisent et légitiment les pratiques discrétionnaires, la convergence des uns et des autres aboutissant à une distribution à la fois inégale et inappropriée des sanctions). Tous éléments qu’il est plus difficile de cerner avec les études quantitatives déléguées à des enquêteurs.
Il importe en effet de distinguer deux manières distinctes de « monter en généralité » à partir d’une recherche. La première, qu’on peut qualifier d’horizontale, vise à généraliser à l’ensemble d’un territoire ou d’un groupe : la question est celle de la représentativité statistique qui suppose un échantillon géographique ou démographique tiré au sort. La seconde, qu’on peut dire verticale, vise à généraliser la compréhension en profondeur des logiques et des processus : la question est celle de l’intelligibilité sociologique ou anthropolo-gique qui implique de rendre compte de la complexité des phénomènes étudiés. L’ethnographie ne peut
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires
86
36. Claude Lévi-Strauss, « Le sorcier et sa magie », in Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 183-203 ; et Clifford Geertz, “Deep play: notes on the Balinese cockfight”, in Clifford Geertz (dir.), The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973, p. 412-453. 37. Didier Fassin, “Why ethnography matters: on anthropology and its publics”, Cultural Anthropology, 28(4), novembre 2013, p. 621-646. 38. Pierre Bourdieu, Sur l’état. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, coll. « Cours et travaux », 2012.
évidemment se réclamer que de cette dernière forme de montée en généralité. Tout comme l’histoire singulière de Quesalid permet de comprendre la cure chamanique, ou bien l’observation unique d’un combat de coqs donne accès au fonctionnement des relations sociales à Bali36, l’étude d’une brigade anti-criminalité et la description de quelques scènes significatives de leur travail de patrouille révèlent les mécanismes par lesquels le pouvoir discré-tionnaire des policiers est non seulement compatible avec l’application d’une politique gouvernementale, mais peut en être, sinon la condition, du moins la modalité la plus efficace de mise en œuvre. Le pouvoir de l’ethnographie, c’est qu’elle montre – littéralement – ces mécanismes, à travers le banal et le quotidien, comme dans les deux scènes présentées ici, plutôt que dans le spectaculaire et l’exceptionnel, que représentent les faits divers37. Et c’est probablement là ce qui trouble le plus le lecteur : l’ethnographie redonne à un ordinaire auquel s’étaient habitués les acteurs tout comme ceux qui les étudient la force de ce qui, soudain, ne va plus de soi.
« La BAC, c’est un mal nécessaire », me disait un commis-saire, chef d’une grande circonscription de la première couronne parisienne éloignée du lieu de mon enquête. Tout en récusant la formule avec véhémence devant moi, un inspecteur général proche du ministre de l’Intérieur devenu président de la République en développait le sens et en confortait le bien-fondé. Il expliquait, à propos des directeurs départemen-taux de la sécurité publique, dont il connaissait bien la fonction pour l’avoir lui-même occupée : « Le problème, c’est qu’ils sont souvent redevables à ces BAC, parce que c’est la structure sur laquelle en dernier recours ils peuvent toujours se reposer. On est dans un système pervers dans lequel ils n’osent pas trop les toucher parce qu’elles les servent quelque part. Les BAC sont les bien-aimées de leurs supérieurs parce que c’est elles qui font du chiffre. » Qu’elles le fassent en inter-pellant d’inoffensifs consommateurs de cannabis ou étrangers en situation irrégulière au lieu de ce que les policiers considèrent comme de véritables délinquants ou criminels, et en suscitant des outrages et rébellions contre personnes dépositaires de l’autorité publique au risque de provoquer des troubles plus graves, est au fond de peu d’importance du point de vue de l’institution.
Moyennant quelques excès que leur hiérarchie excuse par avance, voire favorise, les agents de ces unités spéciales font à la fois ce qu’ils veulent et ce qu’on attend d’eux. Ils exercent, jusque dans la déviance, le pouvoir discrétionnaire qui caractérise l’activité
policière, et ils mettent en œuvre, y compris dans leurs débordements, les politiques sécuritaires que les gouvernements successifs pensent dans leur intérêt de conduire. C’est pourquoi les scandales qui marquent l’histoire des brigades anti-criminalité, les émeutes que leurs actions ont déclenchées et les dénonciations dont elles font régulièrement l’objet n’affectent pas leur légitimité. D’ailleurs, elles perdurent au gré des changements de majorité présidentielle, quand la seule instance indépendante susceptible d’en critiquer les pratiques, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a, elle, été dissoute. Il serait toutefois simpliste et erroné de focaliser exclusi-vement l’analyse sur ces unités qui constituent seulement la partie visible d’un dispositif répressif plus large incluant les autres services de sécurité publique qui opèrent dans des conditions similaires. L’État peut ainsi faire croire à la population qu’à travers ce dispositif qui se concentre sur les territoires les plus relégués et les populations les plus précaires, il œuvre pour la sécurité collective et pour le bien commun lorsqu’au mieux il se contente de reproduire l’ordre social, au pire en vient à menacer l’ordre public. Cependant, même dans ce cas, il y trouve une justification supplémentaire de son activité de répression et du ciblage qu’elle opère.
Si l’État peut être défini, selon la fameuse formule webérienne, par le monopole de l’usage légitime de la force physique à laquelle Pierre Bourdieu ajoute la violence symbolique38, alors l’étude empirique de ce que fait la police dans les lieux où s’exercent avec le plus d’évidence cette force physique et cette violence symbolique mérite une attention particulière. Le risque de toute ethnographie, et celle de l’État singulièrement, est cependant de s’en tenir au local, à l’interaction, à ce qui se joue ici et maintenant, en l’occurrence entre une institution et son public. Une ethnographie critique doit donc articuler cette observation rapprochée et une lecture distanciée, celle qui permet d’établir des ponts entre les niveaux micro- et macrosociologique, de relier les actions individuelles et les processus structurels. Le travail quotidien des gardiens de la paix, et notam-ment dans les brigades anti-criminalité, ne prend en effet toute sa signification que lorsqu’il est appré-hendé par rapport aux transformations économiques, politiques et morales qui s’opèrent dans l’espace social. C’est alors que la distribution inégale des pratiques policières peut être comprise comme la manière qu’a l’État de prolonger et de conforter la distribution inégale des ressources sociales en légitimant ces disparités croissantes et contenant la possibilité de les contester.
Didier Fassin
89ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 89-97
Bien à l’image du personnage que nous avons connu, les trois années de cours reproduites dans Sur l’État nous font entendre un enseignement très réflexif, qui ne cesse de s’inter-roger sur lui-même, aussi peu magis-tral que possible. On ne compte pas les endroits où Bourdieu s’interrompt pour se poser des questions sur ce qu’il est en train de dire et sur sa manière de le dire, pour expliciter sa démarche, rassurer son public – ou telle fraction de ce public qu’il définit avec une grande justesse comme un public « à plusieurs vitesses » (p. 438) –, réagir à des questions, voire pour s’excuser de ses difficultés et de ses doutes, de ses « rabâchages et piéti-nements » (p. 96), et ainsi de suite. Et puis, outre ces inquiétudes, il y a toutes ces digressions (parfois très prolongées), ces développements qui n’étaient pas prévus, provoqués par une question ou une lecture, ces répéti-tions, ces annonces qui n’en finissent pas d’être repoussées, etc. Ce sont des façons de faire où, en dehors peut-être de quelques collègues super-organisés, nous devons être nombreux au Collège de France à nous retrouver, même si le degré d’organisation/désorganisation est certainement très variable. Mais je ne doute pas que chez Bourdieu la liberté dans la progression, le besoin de faire retour sur soi-même, voire la propension à improviser de semaine en semaine en réponse à des sollicita-tions imprévues ont été poussés plus loin que chez la plupart de ses pairs.
Déposé brut sur le papier, cela pose évidemment quelques problèmes, et qui m’intéressent directement.
Le rythme, et surtout la trajectoire du cours ne sont par définition pas ceux d’un livre. La devise du Collège de France, comme chacun sait, est d’« enseigner la recherche en train de se faire ». On suit donc, en temps réel en quelque sorte, la progression d’une pensée, d’un questionnement, d’une exploration, avec tous les allers et retours et tous les méandres, toutes les incertitudes aussi que cela implique, sans parler des contradictions et des erreurs impossibles à éviter. Rien de tout cela ne facilite la lecture en continu. En fait, on en arrive parfois à ce que la lecture soit elle-même une recherche. Je ne sais si l’on rencontre-rait partout les mêmes difficultés dans l’hypothèse improbable où un éditeur audacieux déciderait de publier tous les cours du Collège sous cette forme : d’autres sont peut-être plus proches d’une recherche déjà maîtrisée et prête à être communiquée – certains collègues m’ont dit avoir déjà en tête le livre dont leur cours était une sorte de galop d’essai, ou de test préliminaire, chapitre par chapitre. Mais ce qui est important, c’est que dans le cas présent on retrouve une voix et une personne avec une immédiateté tout à fait saisis-santes – une voix et une personne qui nous manquent depuis qu’elles ont disparu –, et ne serait-ce que pour cela il faut être infiniment reconnaissant à tous ceux qui ont réalisé cette édition, et qui l’ont réalisée si bien.
Si je devais me définir profession-nellement, et bien que je ne possède peut-être pas tous les diplômes requis, ce serait comme historien – sinologue
historien en l’occurrence. Bourdieu a beaucoup lu et fréquenté les histo-riens, il les respecte, et comme bien d’autres je puis témoigner qu’il attend beaucoup d’eux ; mais ils lui posent clairement un problème. La mise en opposition de ce qu’il désigne comme deux « champs », marqués chacun par ses habitus – d’un côté, les historiens (« les historiens, maîtres de leur petit monopole », avec leur propre système d’autocensure, etc.), et de l’autre, les sociologues – revient sans cesse, je dirais même que c’est un peu une obsession. Ce n’est pas une opposi-tion oiseuse, bien sûr, et il va sans dire qu’il n’y a pas que les sociolo-gues qu’on puisse mettre en regard des historiens, de leurs pratiques, de leurs normes professionnelles, de leurs us et coutumes et de leur façon d’aborder les choses. Pour être plus précis, face à ces gens qui « se contentent de cumuler des histoires », comme il le dit dans un de ses moments d’impatience, Bourdieu met ceux qui « essaient de construire des modèles systématiques, de rassem-bler un ensemble de traits liés par des relations contrôlées et susceptibles d’être validés ou falsifiés par la confron-tation avec le réel » (p. 121). Il analyse un certain nombre d’auteurs qui ont tenté de faire cela, avec plus ou moins de succès d’après lui ; et bien sûr cette description correspond à son propre projet sur la genèse de l’État.
Cela étant, une telle opposition est-elle inévitable, fondamentalement – je veux dire, au-delà des techniques et des « habitus » ? Je n’en suis pas si sûr. Il y a le métier de l’historien, certes, dont Bourdieu admet l’importance
Bourdieu, l’État et l’expérience chinoise
Pierre-Étienne Will
90
Pierre-étienne Will
1. Je pense à une école récente qu’on a qualifiée un peu sommairement de « cali-fornienne », avec des auteurs comme Roy Bin Wong (China Transformed: Historical Change and the Limits of European Expe-rience, Ithaca, Cornell University Press, 1997), Kenneth Pomeranz (The Great Diver-gence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton, Princeton University Press, 2000, trad. française : Une grande divergence, la Chine l’Europe et la construction d’une économie mondiale, Paris, albin Michel, 2010), et quelques autres. L’une des préoccupations
majeures dans ces travaux qui auraient sans nul doute intéressé Bourdieu est d’identifier les causes contingentes ou structurelles du « décrochage » économique et politique de l’Europe occidentale par rapport à la Chine à partir du xVIIIe siècle en se départant de l’approche eurocentrique (l’expérience chinoise évaluée à l’aune du modèle euro-péen) qui domine l’historiographie. La pertinence de cette mise en regard est manifeste, ne serait-ce que parce qu’elle invite les spécialistes des aires culturelles concernées à remettre leurs certitudes en question et à considérer d’un œil neuf
leurs objets habituels d’investigation. (À ma connaissance les débats parfois fort vifs suscités par ces ouvrages ont sur-tout impliqué les spécialistes du monde chinois.) on pourrait aussi citer Charles tilly – qui se considérait comme historien et sociologue, et dont Coercion, Capital and European States, AD 990-1990 (Cam-bridge, Blackwell, 1990, trad. française : Contrainte et capital dans la formation de l’Europe 990-1990, Paris, aubier, 1992), analysé par Bourdieu dans son cours du 17 janvier 1991, inclut un fort chapitre sur la Chine – ou encore William McNeill.
2. Étienne Balazs, La Bureaucratie celeste, Paris, Gallimard, 1968, p. 221-289 ; traduit de Political Theory and Administrative Reality in Traditional China, Londres, School of oriental and african Studies, 1965.3. Pierre-Étienne Will, « Bureaucratie offi-cielle et bureaucratie réelle : sur quelques dilemmes de l’administration impériale à l’époque des Qing », études chinoises, 8(1), 1989, p. 69-142. Cf. Pierre Bourdieu, Sur l’état, cours au Collège de France du 7 novembre 1991.
et la spécificité, et qui ne s’improvise pas. Il y a une certaine exigence positiviste (ne craignons pas de le dire), un attachement pointilleux aux sources et aux faits. Il y a aussi le feeling pour une époque, un terrain, une société, ou quoi que ce soit d’autre qu’on essaye d’acquérir à force de s’immer-ger dans les sources, qui vous protège des généralisations hasardeuses et des affirmations trop rapides, qui finit par vous donner une sorte d’instinct, mais qui comporte aussi un risque évident d’enfermement dans des terrains et des problématiques limités. Mais après tout les sociologues sérieux ont à peu près les mêmes exigences, je suppose, et je suppose aussi qu’ils sont exposés au même risque. Et j’ajouterais en passant qu’il y a eu récemment plusieurs histo-riens très « historiens » qui ont tenté, eux aussi, de construire des modèles systématiques fondés sur la mise en regard des expériences historiques d’un bout à l’autre de l’Eurasie1.
Allons plus loin dans le rappro-chement. « Je dis souvent […] », dit Bourdieu, « qu’une des motiva-tions inconscientes qui portent à devenir sociologue, c’est ce plaisir de découvrir les arrière-boutiques, les arrière-scènes », ou les « coulisses » (à propos des commissions publiques). « Cette vision pourrait être la socio-logie spontanée du sociologue demi-savant », pour qui « le monde est un théâtre, et ça s’applique très bien à l’État » (p. 48). Certes, il met en garde contre les limites d’une telle posture, dont il admet la légitimité mais qui « risque de laisser échapper quelque chose d’important ». Mais telle que je la perçois, sa propre démarche se situe dans une perspective tout à fait analogue. Ainsi dit-il ailleurs que ce qu’il essaie de transmettre dans son enseignement du métier de socio-logue, et qui fonde son programme de recherche, « c’est une manière
de construire la réalité qui permet de voir les faits que, normalement, on ne voit pas » (qu’on ne voit pas parce que « cela va de soi »), et c’est un point qui revient très souvent (p. 96, 117). Pour ne donner qu’un exemple, il s’attache longuement à démonter ce qu’il appelle l’« officiel », à le mettre en pièces afin de mettre en évidence ce que ça recouvre, comment sont mises en œuvre les fameuses « ressources symboliques » pour camouf ler ou faire oublier un certain nombre de choses, et ainsi de suite. Comme il le dit encore quelque part (p. 286), il fait une « sociologie négative, de rupture avec les prénotions ».
Or, toutes choses égales par ailleurs – si l’on me permet de me limiter à mon propre exemple –, j’ai toujours essayé de faire un peu la même chose dans mon travail. Peut-être d’ailleurs est-ce pour cela que le courant est si facilement passé dès ma première rencontre avec Pierre Bourdieu, alors que, je l’avoue, je n’avais pas à l’époque lu une ligne de lui et n’avais jamais assisté à ses cours. Les sources de l’histoire chinoise invitent tout parti-culièrement, il me semble, ou devraient tout particulièrement inviter, à prati-quer une sorte d’« histoire négative », pour le coup, ou à tout le moins hypercritique. La raison est assez simple. L’historiographie chinoise conventionnelle, celle qui nous est le plus immédiatement accessible, et celle avec laquelle nous apprenons notre métier, est totalement structu-rée, écrasée même, par le discours dominant, qui est de près ou de loin celui de l’État. Structurée aussi par les formes de la communication et de l’archivage étatiques – les rapports et les directives, les chroniques des faits et gestes, les dossiers des agents, les registres et les listes, etc. –, d’où sont issus des monuments historio-
graphiques comme les 24 histoires dynastiques et tant d’autres, admirable-ment organisés, véritables montagnes de faits, d’institutions et de noms, à partir desquels se reconstruit un passé univoque où même les contrastes et les contradictions viennent se couler dans une vision top-down qui est celle, disons pour faire simple, de l’État bureaucratique de droit divin.
Or, quand on cherche un peu il est tout à fait possible de dépasser cette vision et ce discours, car il n’y a pas pénurie de matériaux – surtout aux époques plus récentes, dont je m’occupe – avec lesquels on arrive à les démonter, à les fouiller aux interstices, à les contourner, voire à les prendre carrément en défaut. C’est ce que j’ai essayé de faire, dès le début, dans mes recherches sur la bureaucratie impériale chinoise – d’instinct en quelque sorte, car c’était cela qui m’intéressait, ne serait-ce qu’en raison de l’invraisemblance si fréquente des représentations habituelles de la bureaucratie et de la société. Peut-être y étais-je aussi encou-ragé par la série fameuse de conférences d’Étienne Balazs publiées en français en 1968 sous le titre « Théorie politique et réalité administrative dans la Chine traditionnelle »2 – Balazs était un grand pourfendeur de la doxa sinolo-gique. (L’influence est manifeste dans le titre d’un article que Bourdieu m’a fait l’honneur de commenter dans un de ses cours : « Bureaucratie officielle et bureaucratie réelle »3). Une bonne partie de mon travail depuis quarante ans a été consacrée – et continue de l’être – à ce contournement du discours officiel par tous les moyens, ce qui veut dire en épluchant de façon critique le plus grand nombre possible de sources, et surtout les plus variées possibles, de l’histoire off iciel le à l’anecdote journalistique, voire à l’écrit intime dans les rares cas où il a surnagé.
91
Bourdieu, l’état et l’expérience chinoise
4. on pourra se reporter là-dessus à mes résumés d’enseignement dans les Cours et travaux du Collège de France, années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. 5. Je reprends ici mes considérations ibid., année 2012-2013 (compte rendu du séminaire).
Faire parler les gens autrement qu’à travers les conventions et les tropes imposés par l’orthodoxie et le confor-misme d’État – autrement qu’en langue de bois, pourrait-on dire –, ou en se démarquant du discours « élégant » (ya) qui était l’une des principales marques de distinction des lettrés, bureaucrates ou non, n’est pas impossible.
Ce qui est intéressant, c’est qu’il en ressort une image beaucoup moins simple que l’opposition théorie/réalité ne le donnerait à penser. Je me suis grandement intéressé à des matériaux autobiographiques où l’hypocrisie générale que semble refléter le discours conventionnel, et que n’avait de cesse de relever un Balazs impatienté par une certaine sinologie tendant préci-sément à s’y identifier, laisse place à beaucoup de mauvaise conscience, à des compromis plus ou moins bien vécus, à des doutes sur ce qu’on est et sur ce qu’on fait, à la dénonciation, justement, de l’hypocrisie parmi ses pairs et des habitudes détestables de l’élite dirigeante, et finalement à un réalisme parfois assez saisissant dans la description sociale. (En cela on est très loin d’un certain style de dénon-ciation « élégante » et de critique socio-politique qui fait partie intégrante, lui, de la tradition et qui est lui-même une convention.) Ces matériaux ne sont pas bien nombreux, disons-le d’emblée, et ils se concentrent au XVIIe siècle, quand la crise de la fin des Ming et le chaos provoqué par le changement de dynastie ont mis à mal les confor-mismes, et dans une moindre mesure au XIXe, qui est lui aussi un siècle d’incertitudes et de difficultés. (Je ne parle pas ici de la crise terminale du système impérial, au tournant du XXe siècle, ni de la période républicaine, où les contrôles sautent pour de bon.) Mais même en petit nombre comparé au déluge de textes émanant de l’État et de ses serviteurs, ces témoignages et ces « ego-documents » contri-buent puissamment à une histoire, et occasionnellement une sociologie, autres – « négatives », si l’on veut4.
Mais il n’y a pas que la bureaucratie et l’État. J’ai également consacré beaucoup de temps à analyser le jeu entre les représentations et les réalités dans la vie des gens ordinaires, des absents du discours historique, telles que les
révèlent les sources judiciaires. Voilà un magnifique matériau pour la socio-logie, à condition qu’on le scrute avec la compétence requise (et ce n’est pas toujours facile). La documentation judiciaire – les « cas », qui reflètent de façon plus ou moins détaillée les archives judiciaires et dont une quantité considérable ont été publiés dans des recueils spécialisés – est sans aucun doute la source qui permet le mieux d’observer le fonctionnement réel de la société, dans certains cas avec une acuité presque anthropologique. Pour me limiter à un exemple, l’image harmo-nieuse de la famille confucéenne, fondée sur l’affection mutuelle et le respect des hiérarchies, qui informe le discours « correct » émanant de l’État et de l’élite lettrée est singulièrement mise à mal par le monde de rivalités, de conflits, de calculs très cyniques et de transgressions plus ou moins graves que laissent entrevoir d’innombrables affaires portées devant la justice. Là encore il serait trop facile de parler d’un divorce systématique entre idéaux et réalités : c’est un univers de tensions et de contradictions que l’on a plutôt ; ou pour le formuler autrement, une négociation perpétuelle entre des normes intériorisées par tous, y compris les gens les plus modestes à la fin de la période impériale, et les nécessités et les accidents de la vie quotidienne.
Les documents judiciaires nous donnent à voir l’ensemble de la société en y incluant tous ceux qui n’appa-raissent pas normalement dans les sources historiques ou littéraires, sinon comme des groupes abstraits ou comme des entités-type – autrement dit la majorité écrasante de la popula-tion. Les « gens ordinaires » qu’on rencontre à travers les enquêtes et les interrogatoires sont des individus autonomes et agissants, complexes parfois, mus par des intérêts et des passions échappant aux représenta-tions du discours normatif, et qu’il devient possible d’observer direc-tement dans leurs activités et leurs attitudes sociales, familiales, sexuelles, professionnelles, économiques, etc. Il y a à cela une raison bien simple : le processus judiciaire implique une recherche des faits ne négligeant aucun détail pour établir une « vérité » ob jective, et donc formuler une opinion
judiciaire fondée. D’où une grande précision, quand ce n’est une certaine crudité, dans la description des comportements et des circonstances, des personnes et du cadre socio-écono-mique dans lequel elles se meuvent. Considérés individuellement, les cas judiciaires ne livrent que des bribes de réalité, des « narrations » dont on peut toujours se demander dans quelle mesure elles sont représentatives. Mais leur accumulation, qui est une entreprise sans fin, finit par déployer un véritable paysage social5.
Pour revenir à l’État, je crois que, dans le cas chinois, il est essentiel de distinguer entre l’État et le régime dynastique, malgré l’ambiguïté de la terminologie : le même mot guojia, qui, en chinois moderne, désigne l’« État » (au sens où nous l’entendons), ou alors la « nation », signifie, dans la langue impériale officielle, le régime dynastique, la maison impériale, et seulement de façon accessoire l’organisation bureaucratique sur laquelle ils s’appuient. De la même façon, guo, c’est aujourd’hui le « pays » (l’État-nation), alors qu’à l’époque impériale c’était plutôt « les sujets de l’empereur » : la notion se définissait par rapport à la maison dynastique qui, en quelque sorte, portait légitime-ment la civilisation chinoise, plus que par rapport à un peuple, un territoire et une structure politique, même si ces nuances ne sont pas absentes.
Bourdieu parle quelque part au début de son cours de l’État comme « quasi-Dieu » (p. 16), parce que (comprend-on) « l’État est une entité théologique, c’est-à-dire une entité qui existe par la croyance ». Dans le contexte de la Chine traditionnelle cette notion n’aurait guère de sens, s’agissant en tout cas de l’État dans la définition que je vais donner de suite. Et c’est la même chose avec l’État comme entité non plus théologique mais juridique, ce qui lui conférerait semblablement une « personne », au sens de personne morale ou de personne juridique cette fois, et non pas divine. Là encore il n’y a rien de tel en Chine. Mes réflexions là-dessus, qui sont loin d’êt re abouties, ont été déclenchées par la question d’une auditrice lors d’un des séminaires sur le thème « Chine,
LES BÂtIMENtS aDMINIStRatIFS de la sous-préfecture de Nanpi (actuel Hebei), d’après Nanpi xianzhi (1887). Incarnation la plus visible du pouvoir de l’État à travers le territoire de l’empire, les sièges des sous-préfectures (ou yamen) étaient toujours situés dans des villes murées. Pour les sujets de l’empire qui résidaient hors des capitales administratives ce pouvoir restait une réalité lointaine en dépit des efforts d’une minorité de « héros administratifs » pour intervenir dans la vie des masses au-delà des strictes
2 MM DE CHaQUE
Pierre-étienne Will
nécessités fiscales et judiciaires. L’espace du yamen était soigneusement compartimenté et les contacts avec l’extérieur très contrôlés. on distingue, du sud au nord, les bâtiments de la police (séparés du reste), la prison où étaient détenus les justiciables en attente d’être jugés (à l’angle sud-ouest), et les cours et pavillons successifs, depuis le grand hall d’audience jusqu’à la résidence privée du fonctionnaire en titre, située tout au fond.
2 MM DE CHaQUE
Bourdieu, l’état et l’expérience chinoise
94
6. Pierre-Étienne Will, « Le contrôle de l’excès de pouvoir sous la dynastie des Ming », in Mireille Delmas-Marty et Pierre-Étienne Will (dir.), La Chine et la démocratie : tradition, droit, institutions,
Paris, Fayard, 2007, p. 111-156. 7. J’ai essayé d’en donner une idée dans « La distinction chez les mandarins », in Jacques Bouveresse et Daniel Roche (dir.), La Liberté par la connaissance.
Pierre Bourdieu (1930-2002), Paris, odile Jacob, 2004, p. 215-232. 8. outre la mienne, voir aussi les contri-butions de Jérôme Bourgon et Christian Lamouroux, in « Science de l’État », Actes
de la recherche en sciences sociales, 133, juin 2000.
démocratie et droit » conduits au Col lège de France avec Mirei l le Delmas-Marty en 2003 : un justiciable (un « citoyen ») peut-il s’attaquer à l’État impérial, lui demander répara-tion ? La réponse était non, d’emblée ; mais une fois cela dit toute une réflexion éta it nécessaire pour expl iquer en quoi et pourquoi.
J’ai essayé de le faire dans un chapitre portant sur « le contrôle de l’excès de pouvoir sous la dynas-tie des Ming », qui tourne en partie autour de ce qui pourrait être (qui peut être) considéré comme une « constitution » de l’État impérial, sous cette dynastie particulière (qui a régné de 1368 à 1644), mais dont une partie des considérations peuvent être étendues à d’autres régimes pendant les 2 000 ans de l’histoire impériale chinoise6. Plutôt qu’un long discours, et quitte à me citer, voici ce que j’écris quelque part dans ce chapitre (je simplifie un peu au passage) :
Il ne faut pas perdre de vue que, dans le cas de la Chine impériale “l’État” est d’une certaine manière une facilité de langage : il n’existe pas en tant qu’entité juridique susceptible d’être mise en cause devant une instance indépendante et dont on pourrait exiger une réparation. Sur ce plan l’État et les institutions qui le composent se confondent avec les personnes : on ne dénonce pas un ministère, mais le ministre untel, ni un bureau mais les fonctionnaires qui le composent, ni une administration locale mais le fonction-naire en titre qui tolère ou couvre les agissements de ses subordonnés.
À quoi j’ajoutais que dans tous les cas on ne dénonce pas l’empereur. L’État impérial chinois n’est donc pas une personne – ni divine, ni juridique – à qui l’on s’adresserait et qui vous répondrait. J’admets que la tenta-tion d’en parler comme d’une entité autonome et agissante est irrésistible – parce que c’est tellement plus pratique, en Chine comme ailleurs. Bourdieu dit à un moment (toujours vers le début du cours) : « Je pourrais vous citer des kilomètres de textes avec le mot “État” comme sujet d’actions, de propositions. C’est une fiction tout à fait dangereuse,
qui nous empêche de penser l’État. » Et (ajoute-t-il) c’est aussi ce que fait la tradition marxiste : « l’État fait ceci », « l’État fait cela » (p. 25). Mais en dépit de toutes ses précautions oratoires et théoriques pour se garder d’utiliser le mot État comme sujet grammatical, Bourdieu n’arrête pas de le faire : je sais que ce n’est pas exactement ce qu’il veut dire, mais au fil de la lecture on a bien souvent l’impression d’avoir affaire à un être tentaculaire, déterminé à mettre la main sur tout, à tout récupé-rer et tout régenter. Comme si l’affect l’emportait parfois sur la théorie et que l’urgence de mettre au clair toutes les formes de domination et de violence, symbolique ou autre, vous poussait à désigner un responsable, ou l’équiva-lent d’un responsable.
Dans le cas chinois, l’entité théologique qui existe par la croyance (pour revenir à cette notion), à qui l’on peut s’adresser et qui peut vous répondre, ce n’est pas l’État, c’est l’empereur et la lignée dynastique qu’il incarne, légitimés par le patronage du Ciel et par la soumission du peuple. Les deux entités doivent être absolument distin-guées, et cela, jusqu’au bout – et d’une certaine façon jusqu’à aujourd’hui, où c’est le Parti qui tient la place du régime dynastique. Dans le cas dont nous parlons, ce qu’on appelle par convention « État » se limite à la somme d’un certain nombre d’institu-tions et d’organismes, des personnes qui les font fonctionner, et des textes qui les régissent – c’est d’ailleurs une des définitions envisagées par Bourdieu, et c’est celle à laquelle je me tiens. Le mot chinois qui correspond le mieux à tout cela, en fait, plutôt que guojia, c’est guan, qui signifie d’abord « fonctionnaire », et qui en même temps qualifie tout ce qui relève de l’appareil d’État, lui appartient, est contrôlé par lui : le domaine public (par opposition à la propriété privée), l’argent public, les forces armées, l’autorité exercée par la bureaucratie, les lois et les règlements édictés par l’État, et bien d’autres choses encore.
Cet appareil d’État est en fait partagé entre deux missions. La première, c’est la gestion de l’intérêt collectif, prise
très sérieusement par la théorie, et n’excluant aucun des sujets de l’empire – ce qu’on pourrait appeler le service public. L’autre, c’est le service de l’entité dynastique (qui possède par ailleurs sa propre administration palatiale) : l’État et ses agents sont là pour l’entretenir, la faire durer, augmenter sa gloire, sa puissance et son rayonnement dans la totalité du tianxia – du « monde sous le ciel ». Le service public participe en fait de cette tâche, tant il est vrai que la prospérité et le contentement du peuple sont les signes de légitimité par excellence, qu’ils garantissent très concrètement la stabilité sociale, et donc la survie du régime.
Il y a beaucoup d’autres propositions dans Sur l’État que je pourrais dévelop-per en me référant à mes propres préoc-cupations. Par exemple, l’idée que « l’État n’est pas un bloc, c’est un champ. Le champ administratif, comme secteur particulier du champ du pouvoir, est un champ, c’est-à-dire un espace structuré selon des oppositions liées à des formes de capital spécifiques, des intérêts diffé-rents » (p. 40). Voilà bien une vérité que l’historiographie chinoise tradi-tionnelle tend à camoufler derrière un discours unanimiste et moralisant, ou alors purement autoritaire, alors qu’une analyse un peu critique, un peu socio-logique même, confirme absolument l’existence de ces oppositions symbo-liques ou de ces jeux de pouvoirs qui structurent le champ administratif7. Ou encore cette notion d’une « socio-logie spontanée de l’État qui s’exprime dans ce qu’on appelle parfois la science administrative, c’est-à-dire le discours que les agents de l’État produisent à propos de l’État, véritable idéologie du service public et du bien public » (ibid.), encore que, dans le cas chinois, il soit inutile de recourir à la dimension théologique pour la fonder, comme le fait Bourdieu. La « science administra-tive », et décrite en ces termes, je l’ai là encore beaucoup étudiée dans le cadre chinois8. Concrètement elle se décline à travers une multitude de guides, de manuels, d’outils de référence, d’anthologies de textes publiées pour servir de modèle et d’inspiration,
Pierre-étienne Will
95
9. Sur ces derniers, voir en particulier les travaux de Jérôme Bourgon, par exemple « Le savoir juridique chinois à la veille de l’introduction du droit occidental », in Christine Nguyen tri et Catherine Des-
peux (dir.), éducation et instruction en Chine. II. Les formations spécialisées, Paris-Louvain, Peeters, 2003, p. 147-173, ou « Principe de légalité et règle de droit dans la tradition juridique chinoise », in
M. Delmas-Marty et P.-E. Will, La Chine et la démocratie…, op. cit., p. 157-174. J’achève à grand peine la compilation, entreprise il y a une bonne vingtaine d’années, d’un inventaire de toute cette
lit térature pédagogique et pratique, Official Handbooks and Anthologies of Imperial China: A Descriptive and Critical Bibliography, Leiden, Brill, à paraître.
de traités et de commentaires dont les moins intéressants ne sont pas ceux qui relèvent de la science juridique (ou « science du code »)9. Et elle est d’une importance pour le coup tout à fait centrale dans l’État chinois tel que je l’ai défini, car elle reflète et fonde à la fois l’identité du corps bureaucra-tique, avec ses valeurs et ses savoir-faire, son éthique et ses rituels sociaux, son magistère idéologique aussi, à l’ombre de l’empereur mais située ailleurs dans la grande tradition du gouvernement à la chinoise. Il arrive en fait – et ce ne sont pas les épisodes les moins intéres-sants – que l’idéologie du service et du bien publics soit délibérément opposée par ceux qui en sont les porteurs au pouvoir dynastique, à ses actes et à ses initiatives.
Les plus militants parmi les spécia-listes de la science de l’État, et ceux qui avaient le plus de raisons de s’offus-quer des caprices de certains dynastes, répondent on ne peut mieux, me semble-t-il, à la description de ces gens que Bourdieu appelle les « héros de l’officiel » (p. 55) :
Le héros bureaucratique est quelqu’un dont la fonction majeure est de permettre au groupe de continuer à croire dans l’officiel, c’est-à-dire dans l’idée qu’il y a un consensus du groupe sur un certain nombre de valeurs indépassables dans les situations dramatiques où l’ordre social se trouve profondément mis en question.
Même en l’absence de situation drama-tique et de remise en question de l’ordre social, en fait, mais simplement face aux missions incroyablement difficiles qui étaient le lot quotidien des bureau-crates de l’empire. L’étude des ouvrages spécialisés auxquels j’ai fait allusion m’a conduit à m’intéresser de près à une certaine élite administrative – une élite professionnelle autant qu’idéolo-gique –, minoritaire mais très influente, notamment à travers les ouvrages en question, grâce à laquelle on pouvait en effet continuer de croire à un certain nombre de valeurs non seulement indépassables, mais quasi utopiques dès lors qu’on entendait les appliquer rigoureusement dans la réalité. C’est à mon
avis en grande partie grâce à ces « héros » et aux modèles qu’ils diffu-saient que la bureaucratie impériale chinoise a été capable de déployer bon an mal an une efficacité beaucoup plus réelle et beaucoup plus grande qu’on ne le dit volontiers.
Mais qu’en est-il de la genèse de l’État, qui est après tout le fil conducteur de ces trois années de cours ? L’État, explique Bourdieu, est un « mystère » que l’on comprend mieux en en étudiant la genèse : on voit les choses se former en partant du Moyen Âge, dit-il, et au prix d’un travail d’histoire comparée (p. 29). Bourdieu parle surtout de l’Angleterre et de la France, également du Japon, encore que ce qu’il a à dire du Japon soit assez décevant, car s’il daube volontiers sur l’orienta-lisme il ne s’en protège pas toujours, et surtout il ignore des pans fondamen-taux dans la genèse de l’État japonais, à commencer par le rôle historique massif joué par le modèle chinois. En revanche il parle assez peu, et assez vaguement, de la Chine, en dehors de quelques pages sur la question de la corruption qui partent de mon article sur « Bureaucratie officielle et bureau-cratie réelle », et de quelques autres sur le mandarinat inspirées par le travail de Jean François Billeter. Il convient donc de se demander quelle contribution la Chine peut apporter au programme comparatif de « généalogie historique de cette chose qu’on appelle l’État » – de cette « entreprise monstrueuse, démesurée, décourageante » (p. 69) que Bourdieu s’est assignée.
L’une des idées fortes exprimées dans le cours est que « l’intérêt principal de cette recherche sur la genèse de l’État, c’est la clarté des commen-cements », et cela, parce que « dans les commencements, on est obligé de dire encore des choses qui vont sans dire parce que la question ne se pose plus, parce que justement l’État a pour effet de résoudre le problème de l’État » (p. 97). Que faut-il en penser dans notre cas ? Même si sa genèse a été un processus de longue durée, l’État chinois (à nouveau, dans la définition restrictive que j’en ai donnée)
existe depuis très longtemps, disons depuis les régimes inspirés par l’école « légiste » ( fajia) qui ont émergé à partir du IVe siècle avant notre ère et qui ont abouti à l’unification impériale dès la fin du siècle suivant. Or, ces philosophes légistes et leurs disciples n’ont pas construit une « f iction juridique » ; ils ont conçu une organi-sation intégrée de la société et du gouvernement très réelle, révolution-naire à bien des égards, entièrement placée au service du souverain et servie par des gens extérieurs à sa maison, révocables et non héréditaires.
Les choses étaient en effet tout à fait claires au moment de cette émergence ; mais il me semble qu’elles le sont restées par la suite. Je veux dire que pour une partie de l’opinion lettrée – du milieu, donc, où se recru-taient les serviteurs de l’État – elles ne sont jamais « allées de soi », au sens où elles auraient été intériori-sées au point d’être perdues de vue. Ce qui est intéressant, en effet, c’est que le débat politique et idéologique n’a jamais cessé entre, d’une part, les porteurs de ce principe d’organisa-tion intégrée et concentrée, fondée sur la loi, sur l’autorité et sur la force, et d’autre part les tenants d’un retour aux sources, à un modèle antique fondé sur le charisme, sur l’observation des rites et sur l’exercice de la vertu, un modèle qui pour le coup était une fiction, mais une fiction tirant sa force de ce qu’elle était enracinée dans le corpus des textes classiques. Et ce qui s’est élaboré en fin de compte, c’est un compromis entre les deux, mais un compromis sans cesse revisité.
Si nul ne contestait en effet l’utilité des lois, et plus spécialement des châtiments comme moyen de préve-nir l’indiscipline et la subversion des normes sociales, la question était plutôt de savoir dans quelle mesure l’aura de l’empereur et de ses représentants, leur exemple et leur capacité de persuasion – et, par-delà, ceux des leaders de l’élite sociale – pouvaient primer l’application aveugle et menaçante du code pénal et de la réglementation ; et dans une autre dimension, c’était de savoir s’il ne fallait pas préférer une structure décentralisée,
Bourdieu, l’état et l’expérience chinoise
96
10. Les « légistes » dont je parlais à l’instant sont quelque chose de différent. Plutôt que des juristes, je les décrirais comme des organisateurs cyniques soucieux de servir la volonté de puissance du souverain et d’accroître l’efficacité de la machine administrative et militaire placée à son service.
procédant par délégation à l’instar de la féodalité antique, à la bureaucra-tie centralisée et étroitement contrôlée conçue par les légistes de l’Antiquité. Celle-ci est presque toujours restée la norme, dans les faits sinon dans le discours. Mais discours il y avait, et débat, que celui-ci fût déterminé par des convictions profondément intériorisées ou par des alignements politiques de pure opportunité. Et si les questions n’ont jamais cessé d’être posées, c’est en particulier parce que l’invocation de l’histoire et de ses précédents – dont les plus vénérables remontaient aux Classiques – était consubstantielle à la culture politique.
L’une des thèses formulées par Bourdieu (p. 60) est que ce n’est pas l’État-nation (« comme population organisée ») qui est premier par rapport à l’État comme « ensemble de services d’une nation », mais que l’État a été construit progres-sivement par « un certain nombre d’agents sociaux », en particulier des juristes, qui ont édifié un « ensemble de ressources spécifiques autorisant leurs détenteurs à dire ce qui est le bien pour le monde social dans son ensemble ». On trouve un peu de cela dans la genèse de l’État dynastique chinois, sauf que les agents sociaux en question ne sont pas des juristes qui se seraient basés sur les ressources d’un équivalent du droit romain pour créer une « fiction de droit » – l’État10. Ce sont des lettrés, des gens dont le capital était d’abord académique et culturel, et qui ont édifié sur la base des notions cosmologiques, rituelles, éthiques ou autres qu’on pouvait trouver dans les Classiques une représentation puissante de l’organisa-tion de la société, de ses fondements culturels, de la distribution des rôles, des droits et des devoirs du souverain et de ses agents, etc. Et en un sens ce sont eux qui ont en fin de parcours produit l’État-nation, même si ce n’était pas cela qui était au programme.
Ont-ils « transformé du particulier en universel », pour reprendre une autre formulation de Bourdieu (p. 61) ? Peut-être, au sens où une vision portée à l’origine par un groupe minoritaire d’intellectuels – appelons-les pour simplifier les Confucianistes –, qui n’avaient nullement le monopole de la pensée et du discours, et encore moins
du pouvoir, s’est dans le long temps imposée à la totalité du corps social, même si la compétition avec d’autres sensibilités, et d’abord la sensibilité légiste, n’a jamais disparu. Cette vision, c’est donc ce qu’on appelle par conven-tion le « confucianisme », par quoi j’entends ici un ensemble particulier de valeurs, d’impératifs de comporte-ment – de comportement individuel, de comportement dans le cadre du système de la parenté, et de compor-tement politique –, de hiérarchies sociales et fonctionnelles, d’intérêts sectoriels, mais aussi un folklore, des héros culturels, des références histo-riques ou imaginées. Et, de manière importante, cette vision a été très tôt cooptée par les régimes dynastiques, qui se la sont en fin de parcours appropriée pour leur propre compte, privant par là-même l’élite lettrée de son magistère idéologique.
Comme je le suggérais à l’instant, cette vision s’est combinée plus ou moins aisément avec une vision en grande partie différente, celle donc qu’on appelle (toujours par conven-tion) le « légisme ». Plus ou moins aisément, et non sans acrimonie, car la « lutte symbolique [entre une pluralité de visions privées] pour construire la vision du monde social légitime et pour l’imposer comme universelle » dont parle Bourdieu à un moment (p. 59) n’a jamais vraiment cessé. Mais il reste que la « concentration des instru-ments de légitimation » et le « dévelop-pement d’un appareil symbolique entourant le pouvoir royal », toujours d’après Bourdieu, qui fait partie de sa « genèse mythique de l’État » (p. 112), s’est incontestablement faite au profit du confucianisme, de son discours et de sa vision du monde. Pas d’un seul coup, mais très tôt, par la concentra-tion et l’appropriation du « pouvoir de nommer » et par la marginalisa-tion au moins symbolique des alter-natives – des alternatives religieuses par exemple, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire ; mais aussi, et à mon avis surtout, de la vision alternative d’un État purement technocratique, totalement régulé, où ne comptent que l’accroissement de la puissance matérielle de la maison impériale et de son monopole de la violence – la vision, encore une fois, du légisme.
Celle qui s’est imposée joue plutôt de la violence symbolique, si c’est dans ces termes qu’il faut le dire. Plutôt que la coercition, l’éducation ; et à ce sujet je trouve que la notion d’obsequium introduite par Bourdieu d’après Spinoza (p. 63) se transpose assez bien : « le conditionnement par lequel l’État nous façonne à son usage et qui lui permet de se conserver », dit-il, ou encore le « respect qui s’adresse à l’État ou à l’ordre social ». Parlant d’éducation et de transmission des savoirs agréés par l’État il faudrait, pour être exhaustif, retracer la longue genèse d’un équilibre entre public et privé qui s’est cristallisé surtout à partir de la dynastie des Song, au XIe siècle. (Les Song marquent en Chine le véritable début de l’État bureaucra-tique moderne, c’est-à-dire débarrassé des éléments militaristes et féodaux qui avaient repris le dessus pendant ce qu’on est convenu d’appeler le Moyen Âge.) Il faudrait aussi parler du rôle central des rites et de tout ce qui est subsumé par le terme li, que l’État entend étroitement régen-ter et qui concerne non seulement les rituels dans le sens formel (religieux) du terme, mais aussi le fonction-nement de la fami l le, les règles de la civilité, et d’une manière générale la désignation des hiérarchies quelles qu’elles soient.
Dans tous les cas, la fonction pédagogique de l’État, qu’elle soit conf iée à ses propres agents ou déléguée à d’autres, a toujours été considérée comme absolument centrale : il s’agit bien pour l’État de civiliser les masses, de « transformer le peuple » (huamin) pour le façon-ner à son image. L’un des principaux vecteurs de cette pédagogie, ce sont les écoles, publiques pour les appren-tis lettrés, privées ou charitables pour le reste ; et la visée est bien celle d’un accès universel aux valeurs promul-guées par l’État par le canal des textes réputés les véhiculer, même les plus élémentaires comme le Classique de la piété filiale. Ce qui, incidemment, implique d’encourager l’alphabéti-sation, à propos de quoi je pourrais mentionner les témoignages d’obser-vateurs européens de la Chine au XIXe siècle que j’ai eu l’occasion d’étudier et qui sont unanimes à admirer
Pierre-étienne Will
97
11. Cf. l’échantillon que j’en ai donné dans M. Delmas-Marty et P.-E. Will, La Chine et la démocratie…, op. cit., chap. 1.
un niveau d’instruction, même dans les campagnes, que, d’après eux, l’Europe pourrait bien envier à la Chine.
Les opinions formulées par ces visiteurs qui ont connu la Chine des dernières décennies du système impérial, certains pendant de longues périodes, sont on ne peut plus diverses11. Mais de façon intéressante, la plupart d’entre eux récusent la notion d’une Chine despo-tique, et aucun n’irait jusqu’à parler d’un État tentaculaire et prédateur : l’État qu’ils observent n’avait de toute façon plus les moyens de se comporter ainsi, s’il les avait jamais eus. En revanche ils sont quasiment unanimes à souligner le degré élevé d’indépendance dont bénéficient, d’après eux, les popula-tions, le fait qu’elles sont faiblement imposées, qu’elles jouissent de toutes sortes de libertés dans leurs activités et leurs modes de vie (certains parlent de « libertés pratiques »), et qu’en fin
de compte l’État n’est pour elles qu’une réalité assez lointaine, certainement pas une présence quotidienne, si l’on excepte les habitants des villes où les administrations avaient leur siège.
Si limités que soient ces témoi-gnages, et parfois influencés par les partis-pris politiques et idéologiques de leurs auteurs, ils méritent d’être pris en compte, invitent même à revenir sur certaines idées. La vie quotidienne des sujets les plus modestes de l’empire, autrement dit la masse de la population, le sentiment populaire, les mentalités, la prégnance de l’idéologie officielle, tout cela est excessivement difficile à saisir pour l’historien de la Chine, tant les sources dont il se sert habituellement sont biaisées par le regard de l’État et par le discours de l’élite lettrée qui se confond avec lui. C’est pourtant cela qu’il faut essayer d’explorer si l’on entend évaluer, même approximativement, l’impact réel de cet État qui ambitionne,
comme je l’ai noté, de « transformer le peuple » et le former à son image. J’ai suggéré plus haut une piste, les documents judiciaires, et il en existe d’autres, plus ou moins explicites et plus ou moins fiables, et qui n’offrent en aucun cas le confort d’une historiogra-phie officielle ou semi-officielle bien balisée. Avec ces matériaux, doit-on ajouter, l’historien est facilement tenté de se faire sociologue…
L’État impérial chinois – ses origines, son discours, ses agents, ses procédures – a déjà été beaucoup étudié, mais on n’a jamais fini d’en faire le tour et de se poser de nouvelles questions. Les interrogations formulées par Bourdieu dans Sur l’État et les propo-sitions qu’il avance, souvent profondes, parfois provocatrices, sont une invita-tion à aller de l’avant. Les quelques remarques que j’ai risquées ci-dessus devraient au moins montrer à quel point elles appellent le dialogue.
Bourdieu, l’état et l’expérience chinoise
98
LE PRoGRaMME ICoNoGRaPHIQUE des fresques de la chapelle du couvent des Quatre Saints Couronnés illustre la façon dont la papauté réformatrice s’est emparé du principe impérial pour faire du pape le nouveau maître du monde. Dans ce couvent-forteresse, édifié à Rome à quelques centaines de mètres du Latran, au plus fort de la lutte, au sein même de la ville, entre les partisans du pape (Guelfes) et de l’empereur romain germanique (Gibelins), le cycle de fresques représente le miracle grâce auquel le pape Sylvestre a sauvé de la peste l’Empereur Constantin. L’empereur Constantin confère alors la tiare au pape : la tiare, apparue dans les fresques au début du xIIIe siècle, est encore ici le phrygium blanc, qui va désormais distinguer le pape des évêques qui portent une simple mitre. Elle est blanche pour évoquer la résurrection du Christ et sert de pendant au diadème d’imperatrix que porte dans d’autres fresques et mosaïques romaines, l’Église, ainsi représentée comme l’épouse du pape. La tiare incorporera ensuite le diadème, symbole de la souveraineté sacerdotale et royale, puis, avec Boniface VIII, une seconde couronne symbole de la souveraineté impériale.
Jean-Philippe Genet
À propos de Pierre Bourdieu et de la genèse de l’État moderne
99ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 98-105
Face à un livre aussi sincère et dénué d’artifice que ces cours de Pierre Bourdieu sur l’État, les notes qui suivent sont celles d’un historien qui ne se prétend nullement un expert ou un connaisseur de sa pensée, mais qui a toujours été inspiré et aidé par son œuvre dans son travail, et entend faire preuve de la même sincérité dans ses réactions. Il se trouve que Pierre Bourdieu a bien voulu s’intéresser aux programmes sur la genèse de l’État moderne et a fait un large usage (dans ce cours mais aussi dans Raisons pratiques1) des travaux publiés dans leur cadre2. Faute de temps, je n’ai pourtant pu suivre son cours et c’est le plus souvent l’amitié de Remi Lenoir qui a nourri nos contacts et permis de le tenir au courant des publications au fur et à mesure de leur sortie. Pour toutes ces raisons, la lecture du Cours a donc été pour moi une véritable décou-verte. N’oublions cependant pas qu’il s’agit ici d’un cours, qui donne à voir une pensée en train de se construire, et non d’un ouvrage achevé donnant « la » vision définitive de son auteur.
Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre la visée du cours et m’installer dans sa lecture : je ne m’attendais pas à ce qu’après être parti de la tempo-ralité et avoir annoncé « que cette période où se constitue l’État révèle
des choses intéressantes »3, Pierre Bourdieu fasse ce qui m’est d’abord apparu comme un détour par le marché de la maison individuelle et la commission Barre. J’ai vite réalisé qu’il n’y avait là aucun détour et qu’il s’agissait pour lui de démontrer un point essentiel, à savoir que l’État est un champ : cela rappelle à l’histo-rien que la prise en compte du temps par un sociologue qui donne le primat au concept sur le temps est différente de celle de l’historien, quand bien même le sociologue est prêt à assumer le rôle de l’historien4 tout en prônant, une fois de plus, le dialogue avec lui. L’historien et le sociologue peuvent avoir un même objet, le reconnaître comme un objet historique, ils ne l’aborde-ront pas de la même façon. De fait, le cours, presque par nature, est plutôt un soliloque. C’est là ce qui le rend passionnant : la parole de Bourdieu provoque l’historien et le conduit, plutôt qu’au dialogue proprement dit, à une lecture dialoguiste, pendant laquelle il est sans cesse interpelé et poussé à mettre en question ce qui d’ordinaire lui paraît aller de soi. Chaque page pourrait prêter à commentaire, mais je m’arrêterai sur trois points : le problème de la défini-tion et de l’approche de l’État où les attitudes de Pierre Bourdieu et des histo-riens en général paraissent antinomiques,
puis ce qui me semble cependant être l’apport fondamental de Pierre Bourdieu, et enfin sa lecture critique des travaux des « sociologues généralistes » et de ceux des historiens.
Lecteur des travaux sociologiques de Pierre Bourdieu, j’y avais trouvé une vision affirmée et pourtant peu problématisée de l’État, (notamment dans La Noblesse d’État et dans la quatrième partie de Raisons pratiques, « Esprits d’états. Genèse et structure du champ bureaucratique ») que le cours refuse d’emblée. Mais le cours démontre qu’au moment où il publie ces ouvrages (en 1989 pour l’un et en 1994 pour l’autre) où l’État s’affirme dans toute son évidence, il part à la recherche de cet « objet social histo-rique » pour reprendre une expres-sion qu’il affectionne comme si tout était à reconstruire. La postface sur la situation du cours dans l’œuvre de Bourdieu souligne d’ailleurs que dans ses ouvrages antérieurs, il ne se posait pas le problème de la définition de l’État qui, dans le cours, devient centrale5. Cette évidence de l’État qu’il paraissait accepter est d’ailleurs celle de la théorie critique du marxisme qui « ne pose pas le problème de l’exis-tence de l’État et le résout d’emblée à travers la définition des fonctions qu’il remplit »6 : l’État est là, et l’on
À propos de Pierre Bourdieu et de la genèse de l’État moderne
1. Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1996 [1994], p. 107-123. 2. Présentation dans Jean-Philippe Genet, « La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de recherche », Actes de la recherche en sciences sociales, 118, juin 1997, p. 3-18. 3. Pierre Bourdieu, Sur l’état. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, coll. « Cours et travaux », 2012, p. 23. 4. Ibid., p. 38-39. 5. Ibid., p. 598-598. 6. Ibid., p. 17.
Jean-Philippe Genet
100
7. Ibid., p. 26.8. Ernst Kantorowicz, Les Deux Corps du roi, trad. Jean-Philippe et Nicole Genet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1989 [1957].9. alain Boureau, Histoire d’un historien, Kantorowicz, Paris, Gallimard, 2e éd. 1990.10. alain Boureau, La Religion de l’état. La construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval (1250-1350), Paris, Les Belles Lettres, coll. « Histoire », 2006 ; L’Empire du livre. Pour une histoire du savoir scolas-tique (1200-1380) ; De vagues individus. La condition humaine dans la pensée scolastique, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Histoire », 2008.11. Jean-Philippe Genet, “Kantorowicz and The King’s Two Bodies: a non-contextual history”, in Robert L. Benson et Johannes Fried, Ernst Kantorowicz heute. Ernst Kan-torowicz to-day, Stuttgart, Franz Steiner
Verlag, 1997, p. 265-273.12. Voir, entre autres, Pierre Bourdieu, « Sur les rapports entre la sociologie et l’histoire en allemagne et en France. Entretien avec Lutz Raphael », Actes de la recherche en sciences sociales, 106-107, mars 1995, p. 108-122.13. « Un très bon historien peut dire : “Ce qui fait l’État moderne, c’est fondamen-talement l’établissement d’une fiscalité d’État” et, cinq pages plus loin, dire : “Pour que l’impôt puisse être instauré, il fallait que fut reconnue la légitimité de l’instance instaurant l’impôt”, autrement dit, il fallait tout ce que j’ai dit, à savoir des instances capables de faire recon-naître leur monopole légitime du monde social » (P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 117) ; les éditeurs du cours réfèrent cette remarque à Barrington Moore, mais c’est là une position de beaucoup d’histo-riens depuis Joseph Strayer et elle vaut
aussi pour les programmes sur la genèse de l’État moderne.14. Peter Blickle (dir.), Resistance, Repre-sentation and Community, oxford, oxford University Press, 1997 [trad. française : Résistance, représentation et commu-nauté, Paris, PUF, coll. « Librairie euro-péenne des idées », 1998].15. La meilleure présentation d’ensemble in Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les états, Paris, PUF, 6e éd., 1998.16. Cf. alain Boureau, « Les cérémonies royales françaises entre performance juri-dique et compétence liturgique », Annales ESC, 46(6), 1991, p. 1253-1264 et « Ritua-lité politique et modernité monarchique. Les usages de l’héritage médiéval », in Neithard Bulst, Robert Descimon et alain Guerreau (dir.), L’état ou le roi. Les fon-dations de la modernité monarchique en France (XIVe-XVIIe siècles), Paris, Éd. de la MSH, 1996, p. 9-25 ; alain Guéry, « Le roi
est Dieu. Le roi et Dieu », ibid., p. 26-37. Pierre Bourdieu apprécie particulièrement et à juste titre l’un de ces ouvrages, celui de Sarah Hanley, Le Lit de justice des rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, Paris, aubier, 1991 [1983].17. Maurice Godelier, L’Idéel et le maté-riel. Pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard, 1984 et Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l’anthropologie, Paris, albin Michel, coll. « Bibliothèques Idées », 2007.18. Jean-Philippe Genet, La Genèse de l’état moderne. Culture et société politique en Angleterre, Paris, PUF, coll. « Le nœud gordien », 2003.19. Programme et travaux présentés sur le site du LaMoP : https://lamop.univ-paris1.fr.
se contente de l’analyser à travers ses fonctions, ce qu’il fait, et les gens par lesquels il fait ce qu’il fait. Évidence bien sûr trompeuse, dont Bourdieu s’amuse en citant la boutade – profonde – de Philip Corrigan et Derek Sayer (sur l’ouvrage desquels je reviendrai plus longuement) : « States state, les États font des statements »7. S’ils le font, c’est que leurs énoncés sont chargés du poids de leur autorité. En fait, Pierre Bourdieu va dans sa recherche constamment éviter ce qu’il appelle la « physica-lité » de l’État pour s’intéresser à ce qui fait que son autorité est acceptée et donc efficace.
I l faut bien voir que si cette approche l’écarte de sa démarche habituelle et sans doute de celles de beaucoup de sociologues, elle l’écarte plus encore de celles des historiens. Peu d’historiens se sont attaqués à l’histoire de l’État sans passer par la matérialité des institutions, du prélèvement, de la justice, de l’armée ou de la police et de tout ce qui permet le fonctionnement de l’État et de ses « appareils ». Une exception qui prouve la règle est évidemment Ernst Kantorowicz8 (que Bourdieu cite abondamment) mais on pourrait évoquer aussi le travai l d’A lain Bourreau – par ailleurs biographe de Kantorowicz9, ce qui n’est pas un hasard. Il est vrai que les livres d’Alain Boureau sont postérieurs au cours et, s’ils contournent la « physicalité » de l’État, ils s’appuient sur un ensemble de sources localisées et datées, essen-tiellement la production universitaire parisienne10 et rentrent par-là dans la norme historienne.
En effet, la démarche d’un Kantorowicz – que j’ai pu qualifier de non-contex-tuelle11 – n’est pas naturelle à l’his-torien dont le « métier » consiste à définir comme historique un objet qui peut être quelconque mais doit être matérialisé pour être daté et localisé, afin que lui corresponde un ensemble de sources qu’il exploitera et interprètera grâce aux trésors de son érudition. S’il est en général fort aimable, presque trop même, avec les historiens qu’il cite individuellement, Bourdieu est très critique à l’égard du métier d’historien, et à mon sens, avec raison. Il dénonce les logiques pratiques des historiens : leur affec-tation de rigueur est presque ridicule si on la rapporte au flou des objets sur lesquels ils travaillent. D’où leur haine de la théorisation : le renoncement à la généralisation est le prix à payer pour faire partie de la corporation ; la théorisation est dévalorisée et d’autant plus méprisée qu’elle est abandon-née aux sociologues. Et les historiens se dédouanent en s’abritant par une révérence exagérée qui les place en situation de dominés volontaires face aux philosophes. Ils compensent en survalorisant l’érudition, alors qu’ils n’ont guère de compétence épistémolo-gique, une compétence qui devrait être requise chez les historiens comme chez tous les autres spécialistes des sciences sociales (y compris les sociologues). Enfin, ils sont trop soucieux des mérites littéraires de leur production, et fort peu de sa scientificité12. S’il ne remet pas véritablement en cause leur démarche, qu’il valide de fait par la confiance avec laquelle il valide les matériaux qu’ils
lui fournissent, il reste convaincu qu’ils sont incapables de s’attaquer au véritable problème que pose l’État, problème qu’ils perçoivent mal.
De ce point de vue, les programmes de la genèse de l’État moderne lui paraissent également déficients13. L’hypothèse qui sert de point de départ à ces travaux est bien une hypothèse matérielle : l’État moderne apparaît, quand les pouvoirs sont en mesure, en général sous la pression des guerres, d’exiger et d’obtenir un prélèvement fiscal, prélèvement qui doit cependant être consenti et ne l’est généralement que s’il est considéré comme nécessaire et légitime par la société politique, une société dont l’existence apparaît comme une condition nécessaire sinon suffi-sante à l’existence de l’État moderne. Même si le dernier segment de la proposition n’a pas été réduit, dans le cadre des programmes sur la genèse de l’État moderne (et notamment du second14), comme cela a été trop souvent le cas dans les travaux de la période précédente15, au seul problème de la représentation et des institu-tions représentatives, les questions du consentement et de la légitimité sont restées au second plan, en dépit des travaux des « cérémonialistes » améri-cains16. Ce n’est que plus récemment que je me suis pour ma part attaqué à ce problème. Le déclencheur n’a pas été le cours de Pierre Bourdieu, mais plutôt la conjonction de l’influence de ses œuvres antérieures et de celles de Maurice Godelier17 avec mes recherches sur l’histoire culturelle de la société politique18. Ainsi est né le programme Signs and States (SAS)19, dans lequel
Jean-Philippe Genet
101
À propos de Pierre Bourdieu et de la genèse de l’état moderne
20. Les conférences de 2010 et 2011, « La légitimité implicite » et celle de 2013, « La vérité », sont en cours d’édition dans la col-lection « Le pouvoir symbolique en occident (v.1300-v.1640). Pour une sémantique de l’État », à paraître en 2014 aux Publications de la Sorbonne et à l’École française de Rome.21. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 15-19, pour la citation et la suite du paragraphe.
22. Ibid., p. 28.23. Cours, p. 257-261 (cit. p. 257). Le texte original de David Hume est commo-dément accessible sur www.constitution.org/dh/pringvt.htm.24. Ibid., p. 67.25. Les italiques sont de Pierre Bour-dieu qui parle de « monopole de la vio-lence symbolique légitime », la violence symbolique étant la condition même de
l’exercice de la violence physique (ibid., p. 14). Il cite à nouveau cette phrase p. 545 quand il évoque la redistribution par l’État du méta-capital symbolique, aussi important si ce n’est plus que l’économique.26. Ibid., p. 328.27. Pierre Bourdieu, « Sur le pouvoir sym-bolique », Annales ESC, 3, mai-juin 1977, p. 405-411.
28. Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1980, en par t icul ier p. 191-207 et Esquisse d’une théorie de la pratique précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2000 [1972], p. 348-376.29. Ibid., p. 111-134.
un cycle de colloques, intitulé « Les vecteurs de l’idéel » est consacré à l’étude de l’imaginaire et de l’ensemble des pratiques du symbolique, à commen-cer par le système de communication lui-même, de la réforme grégorienne au concile de Trente20.
Pierre Bourdieu est donc fasciné par la question du consentement qu’il relie magistralement à tout ce que l’État induit au-delà de ses institutions et de sa « physicalité ». Il commence par mettre en garde à la fois contre la définition classique de l’État, celle de Locke et de Hobbes (l’État institu-tion destinée à servir le bien commun) et contre la définition marxiste (l’État appareil de contrainte, « de maintien de l’ordre public mais au profit des dirigeants »)21, car elles réduisent l’État à ses fonctions. Il leur oppose une définition provisoire, inspirée par Émile Durkheim : « l’État est ce qui fonde l’intégration logique et l’intégration morale du monde social et, par-là, le consensus fondamen-tal sur le sens du monde social », une définition qui a le double mérite de lui permettre de continuer sa quête en tant que sociologue et de laisser de côté les aspects institutionnels et juridiques (qui, presque toujours, guident les historiens). C’est en tant qu’il est un principe d’orthodoxie, de consentement et de consensus sur le sens du monde que l’État remplit ses fonctions. Pierre Bourdieu reprend aussi l’expression de « communauté illusoire », empruntée à Karl Marx à propos du sentiment d’apparte-nance à une communauté, État ou nation22. On peut donc dire de l’État ce que Durkheim disait de la religion : c’est une illusion bien fondée.
Mais c’est surtout une illusion puissante. Pierre Bourdieu cite longue-ment un beau texte de David Hume, The First Principles of the Government, dans lequel Hume, devançant les anthropologues du X X e siècle, remarque que la force est toujours du côté des gouvernés et s’étonne
de la facilité avec laquelle « the many are governed by the few »23. Ailleurs, il s’arrête sur une très belle formule empruntée à Paul Valéry : « les insti-tutions sont du fiduciaire organisé et doué d’automatisme »24. S’il reprend la définition célèbre de Max Weber, il insiste surtout sur le caractère déter-minant du pouvoir symbolique : l’État a le monopole de la « violence physique et symbolique légitime »25. C’est ici la violence symbolique qui prime, et qui permet à l’État de s’imposer d’abord comme un principe de production et de représentation légitime du monde social : il fonctionne de façon particu-lièrement efficace dans le secteur du champ de pouvoir que l’on peut appeler « champ administratif » ou « champ de la fonction publique ». Cette analyse n’est pas celle du seul État contempo-rain : Pierre Bourdieu entend donner une profondeur chronologique à ses analyses. Par exemple, il s’appuie sur un article d’Yves-Marie Bercé qui démontre l’importance de l’uniforme et de la livrée permettant de reconnaître les agents de l’État, « cette entité mysté-rieuse [qui] s’incarne dans une série d’individus hiérarchisés qui sont mandataires les uns des autres, en sorte que l’État est toujours le terme d’une régression ad infinitum »26.
Cette excursion au XVIIIe siècle – il y en a quelques autres – ne donne pas pour autant à l’approche de Pierre Bourdieu une profondeur chronologique. Ce qui l’intéresse, c’est d’analyser cet « objet impensable », un objet social historique – pour reprendre une expression qu’il affectionne – qu’il serait i l lusoire de tenir pour tout constitué dont il s’agit de déchiffrer l’action, d’analyser le fonctionnement et d’évaluer l’impact. Dans ce qui est au fond une magnifique et précieuse leçon d’histoire, il distingue classique-ment les deux sens dans lesquels on emploie le mot État : au sens d’appareil bureaucratique de gestion des intérêts collectifs et au sens du ressort dans lequel s’exerce l’autorité de cet appareil.
L’État au premier sens est une construc-tion qui s’abrite derrière un écran (que ce soit l’État-nation ou l’État comme population organisée), et cette construction est destinée à développer et à entretenir l’État dans le second sens (l’État territoire). Elle est opérée par des agents sociaux qui ont évidemment un intérêt particulier à son dévelop-pement, par exemple les juristes. En réalité, il concentre son analyse sur le pouvoir symbolique, analyse vers laquelle, après avoir souvent annoncé en début de cours d’autres dévelop-pements, il est ramené sans cesse par ses raisonnements. Bien sûr, c’est aussi ce qui est au cœur de sa démarche de sociologue, et il avait déjà écrit en 1977, en tant que philosophe et afin de pouvoir collaborer avec les historiens, un texte très court, « Sur le pouvoir symbolique »27 – un article qu’il ne renie pas, mais dans lequel il trouve mainte-nant qu’il a laissé inconsciemment l’État imposer sa marque. Qui plus est, dans son œuvre sociologique, il s’est constamment intéressé aux instruments du pouvoir symbolique, notamment dans Le Sens pratique, où il met en place ou reprend des concepts – qui sont depuis largement utilisés dans les sciences sociales, y compris l’histoire – comme celui de capital symbolique28 ou celui de croyance (en liaison avec celui d’habitus)29.
Il n’est pas dans mes intentions de résumer, ce qui serait d’ailleurs impos-sible, l’analyse de l’État à laquelle se livre Pierre Bourdieu, mais simplement de reprendre certaines des directions qu’il explore et qui pourraient être utilisées ou reprises par les historiens. Certes, le cours au Collège de France se présente comme une ouverture vers les historiens mais, à part l’écho de conversations avec Georges Duby, c’est plutôt un soliloque dont on peut espérer qu’il provoquera la réponse des historiens, à la fois sous forme de réf lexions théoriques – si tant est qu’ils en soient capables, leur habitus professionnel les en écartant –
102
30. Non sans réserve parfois : on peut toutefois sourire de sa critique implicite de l’attitude des historiens par rapport aux sociologues, quand, par exemple, il cré-dite Elias de la théorie de l’impôt comme racket légitime (Sur l’état…, op. cit., p. 206). En fait, l’idée générale est déjà chez Saint augustin, qui demande « que sont les royaumes, sinon des bandes de brigands ? ». La seule différence est que le roi (où l’État) est assuré de l’impunité. C’est ce que dit à alexandre le pirate qu’il a fait arrêter : « parce que [j’infeste les mers] avec un petit navire, on m’appelle brigand ; parce que tu le fais avec une
grande flotte, on t’appelle empereur. » (La Cité de Dieu, IV, 4, éd. L. Jerphagnon, Paris, Gallimard, 2000, p. 138).31. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 110-114.32. Ibid., p. 342.33. Ibid., p. 341.34. Ibid., p. 262.35. Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 2e éd., 1992 [1967] et La Perspective comme forme symbolique, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1976.36. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 61-62.
37. Ibid., p. 84-91.38. Ibid., p. 63-65.39. Ibid., p. 144.40. Ibid., p. 152.41. Pour avoir fait travailler pendant une dizaine d’années des étudiants européens dans le cadre du master « European History and Civilization » (Leyde, Paris 1, oxford), je ne peux que témoigner de leur stupeur quand ils apprenaient que Pierre Bour-dieu, Michel Foucault, Maurice Godelier, Étienne Balibar et Jacques Derrida qui leur paraissaient si différents étaient tous les cinq agrégés de philosophie et normaliens (l’un est de l’ENS Saint-Cloud, il est vrai...).
42. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 118-119.43. Marc Bloch, Seigneurie française et manoir anglais, Paris, armand Colin, 2e éd., 1967 [1960].44. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 161.45. Ibid., p. 157.46. Ibid., p. 580.47. Ibid., p. 578 : « Le propre d’une socia-lisation réussie, c’est de faire oublier la socialisation… Contre l’amnésie de la genèse, il n’y a que la pensée génétique ».
et par des enquêtes empiriques, pour que s’établisse le dialogue qu’il semble appeler de ses vœux30. Parmi ces directions, quelques-unes peuvent s’avérer particulièrement fructueuses et, en premier lieu, sa réflexion sur la propriété qu’a l’État de concentrer les ressources symboliques, accroissant ainsi sans cesse son capital symbo-lique31, au point de devenir « la banque centrale de capital symbolique »32. Le capital culturel (notamment dans des États qui se veulent aussi des nations) et le capital informationnel sont ici particulièrement importants : le capital culturel permet ainsi à l’État de produire « un habitus cultu-rel unifié dont il maîtrise la genèse et du même coup la structure »33. Un des instruments privilégiés de cette concentration du pouvoir symbolique est la production « de principes de classement, c’est-à-dire de structures structurantes susceptibles d’être appli-quées à toutes les choses du monde, et en particulier aux choses sociales »34 : les « formes primitives de classifica-tion » de Durkheim, équivalentes aux formes symboliques d’Ernst Cassirer auxquel les Pierre Bourdieu s’est intéressé quand il a publié les œuvres d’Erwin Panofsky35, sont centrales dans ces processus. Un autre instru-ment efficace est le principe d’uni-versalisme qui permet de transformer du particulier en universel et qui fait qu’il est d’autant plus difficile de résis-ter aux agents de l’État qu’ils sont en quelque sorte des porteurs d’univer-sel36. L’une des catégories les plus efficaces que produise l’État est celle d’officiel – en rapport avec le public et la coupure fluctuante entre privé et public – à la définition et à l’explo-ration de laquelle de nombreuses pages sont consacrées37, et qu’i l prolonge par la notion d’obsequium, empruntée à Spinoza38.
Cependant, Pierre Bourdieu sent bien qu’il lui faut sortir de cette oscillation perpétuelle entre la définition que, pour aller vite, je dirais « symbolique » – au sens où l’État c’est du symbo-lique – et la définition webérienne dans sa version classique, qu’il ne renie jamais, si incomplète qu’il la juge. Il reconnaît qu’il aurait bien voulu proposer son propre modèle, comme les sociologues généralistes qu’i l critique vertement, nous le verrons : mais il n’en a pas et propose en fait de changer de « philosophie de l’histoire », introduisant le concept de génétique structurale ou de struc-turalisme génétique39 : cela lui suggère un développement passionnant (de mon point de vue du moins) sur l’idée qu’il y a une « logique spécifique de la genèse de ces objets bizarres que sont les objets sociaux historiques »40. Il renvoie ici à Ernst Cassirer en faisant référence à son effort pour constituer scientifiquement la notion de struc-ture, ce qui nous rappelle la formation philosophique bien française (c’est-à-dire où Kant et Hegel occupent une place centrale !) de Pierre Bourdieu41. Il s’agira donc pour lui de faire une histoire structurelle de la genèse de l’État qui mette en évidence l’accu-mulation initiale du capital symbo-lique42, non pas en juxtaposant une multitude de modèles différents mais en concentrant l’analyse sur deux cas exemplaires scrutés à fond, en l’occur-rence celui de la France et de l’Angle-terre, un choix pour lequel il se réfère à Marc Bloch43. Cette histoire est celle du jeu social qui va voir se produire la genèse de champs sociaux, comme celui de l’État, à l’intérieur duquel se joue « le jeu politique légitime »44. Mais le champ lui-même n’est pas un jeu : il n’y a pas de « nomothète » qui fixerait les règles, il y a des processus qui s’entrecroisent, mais qui ne doivent
rien au hasard non plus. C’est une construction incohérente qui engendre des choses semi-cohérentes45. Tous ces éléments de réflexion sont, que ce soit pour l’historien ou pour le sociologue, un legs extraordinairement précieux. Dans sa conclusion du cours, Pierre Bourdieu a raison de souligner qu’il a bien fait apparaître les acquis de la méthode génétique pour comprendre ce qu’est l’État, et l’importance du concept de violence symbolique46, et cette leçon ne sera pas perdue. Si ces dernières remarques portent sur la situation contemporaine de l’État et le retour du religieux, l’essentiel n’est pas là mais dans l’effort tenace et parfois – il le reconnaît volontiers lui-même – infructueux pour tenter de se libérer de ce sentiment d’évidence dont l’État est le plus puissant produc-teur. Alors que l’histoire aurait dû lui en fournir les matériaux et les instru-ments, des instruments de dé-banali-sation, de dénaturalisation qui seuls permettent d’éviter l’« amnésie de la genèse »47, il est clair à la lecture du cours que s’il ne les a pas véritablement trouvés, il les a cherchés.
En effet, si pour démontrer ses idées et tester ses hypothèses, en dépit de la perspective génétique qu’il revendiquait, Pierre Bourdieu a utilisé des exemples et des éléments de démonstration souvent contemporains, il s’est aussi tourné vers les travaux des historiens et des sociologues « généralistes » pour chercher à donner une profon-deur chronologique à son approche génétique. Pour les historiens, on peut penser qu’il a discuté de son cours avec Georges Duby dont il était proche, et ce sont d’ailleurs des noms de médiévistes qui reviennent le plus souvent, comme Marc Bloch ou Frederic W. Maitland pour les grands ancêtres, et Jacques Le Goff ou Andrew Lewis pour ses contemporains : on y ajoutera
Jean-Philippe Genet
103
DaNS LE MêME CYCLE, cette fresque représente l’empereur Constantin remplissant l’office de strator, c’est-à-dire d’écuyer du pape Sylvestre, auquel il a en outre abandonné son dais. Ce rite était au cœur de la lutte entre le pape et l’empereur : lorsque l’empereur Frédéric Ier Barberousse descendit en Italie pour se faire couronner à Rome, le pape adrien IV lui demanda d’accomplir l’office d’écuyer du pape : il refusa d’abord, cela pouvant être compris comme un signe de vassalité. Le pape précisa alors que la conduite rituelle de la monture pontificale devait se comprendre comme une marque de respect. Mais ses partisans l’exploitèrent bien comme un signe de soumission, et la scène fut peinte dans une fresque des appartements secrets du Latran : les empereurs exigèrent qu’elle soit détruite, mais la peinture existait encore au xVIe siècle. La scène, transposée ici au IVe siècle, est donc lourde de sens. Qui plus est, dans toutes les scènes du cycle, le pape bénit l’empereur, mettant ainsi en évidence sa supériorité en matière spirituelle. C’est dans la Rome des xIIe et xIIIe siècles que l’Église forge ces outils qui permettent de fonder « l’intégration logique et l’intégration morale du monde social », outils dont l’État va progressivement s’assurer la maîtrise.
À propos de Pierre Bourdieu et de la genèse de l’état moderne
104
48. arlette Jouanna, Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’état moderne (1559-1661), Paris, Fayard, 1989.49. Richard Bonney, The European Dynas-tic States (1494-1660), oxford, oxford University Press, 1991.50. Jean-Phil ippe Genet, annexe I I, « Documents et bibliographie de l’atP », in J.-P. Genet (éd.), L’état moderne : Genèse. Bilans et perspectives, Paris, CNRS, 1990, p. 305-352.51. La production bibliographique des deux programmes est présentée in J.-P. Genet, « La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de recherche », art. cit.
52. John a. Hall, Powers and Liberties. The Causes and Consequences of the Rise of the West, oxford, Basil Blackwell, 1985 ; States in History, oxford, Basil Blackwell, 1986 ; Liberalism, Politics, Ideology and the Market, Londres, Paladin Grafton, 1987 ; Walter G. Runciman, A Treatise on Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2 vol., 1983 et 1987.53. Shmuel N. Eisenstadt, The Political System of Empires, New York, Free Press of Glencoe, 1963.54. Barrington Moore, Origines sociales de la dictature et de la démocratie, Paris, Maspero, 1983 [1966].55. Norbert Elias, La Civilisation des
mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973 [1939] ; La Dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy, 1976 [1939] ; La Société de cour, Paris, Calmann-Lévy, 1974 [1969].56. Perry anderson, Les Passages de l’antiquité au féodalisme, Paris, Maspéro, coll. « textes à l’appui », 1977 [1974] et L’état absolutiste. Ses origines et ses voies, Paris, Maspéro, coll. « textes à l’appui », 2 vol., 1978 [1975].57. Charles tilly (dir.), The Formation of National States in Western Europe, Prin-ceton, Princeton University Press, 1975 ; Contrainte et capital dans la formation de l’Europe, 990-1990, Paris, aubier-Flam-marion, coll. « Histoires », 1992 [1990].
58. Philip Corrigan et Derek Sayer, The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution, oxford, Basil Blackwell, 1985.59. Ce qui est d’autant plus surprenant quand l’on connaît son intérêt pour la scolas-tique (cf. note 35 supra) à laquelle il emprunte le nom de plusieurs de ses concepts phares, habitus, hexis, illusio, ethos : cf. Paul Costey, « L’illusio chez Pierre Bourdieu. Les (més)usages d’une notion et son application au cas des universitaires », Tracés. Revue de sciences humaines [en ligne], 8, 2005, mis en ligne le 20 janvier 2009, consulté le 17 décembre 2013, à la note 19 (http://traces.revues.org/2133 ; DoI : 10.4000/traces 2133).
les noms des modernistes Denis Richet, Robert Descimon et Roger Chartier et surtout ceux d’Arlette Jouanna, dont la thèse a visiblement fait une très forte impression sur Pierre Bourdieu48 et de Richard Bonney, dont l’analyse du développement du principe dynastique en Europe l’a séduit49. Mais il a aussi fait appel aux travaux accomplis dans le programme français du CNRS sur la genèse de l’État moderne, et notamment aux conférences thématiques organi-sées dans son cadre, travaux sur lesquels il émet en général un jugement positif. Dans ce premier programme, il n’y a pas eu de publication systématique des résultats, chaque équipe se chargeant de cela pour son propre compte50 et il est dommage que Bourdieu ait moins bénéficié des sept volumes généraux et des volumes de conférences thématiques publiés dans le cadre du programme Origins of the Modern State de la European State Foundation. Il y aurait trouvé une carrière documentaire qui lui aurait facilité la tâche. Malheureusement ces volumes ont été publiés entre 1995 et 2001, trop tard pour qu’il puisse les utiliser51.
Quant à ses références aux travaux des sociologues, Pierre Bourdieu sait clairement ce dont il ne veut pas : ce qu’il refuse, c’est fournir une réponse comparable à celle qu’ont donné les general sociologists. Pourtant, on peut regretter qu’il ne les ait pas plus utili-sés, fut-ce avec des pincettes. Il n’utilise qu’incidemment Michael Mann mais ne cite ni John Hall, ni Walter Runciman52 pour mentionner deux noms célèbres Outre-Manche, le second est même absent d’une bibliographie pourtant bien fournie. Il s’attache surtout à se démarquer de certaines « grandes théories » et d’auteurs auxquels il peut cependant emprunter sur tel ou tel point. Le premier auteur sur lequel
il s’arrête est Shmuel Noah Eisenstadt53, auquel il reproche de ne faire que de la typologie, bien qu’il ait su recon-naître une autonomie (relative) au politique et analyser avec perspicacité la volonté contradictoire d’une partie de l’élite dirigeante de jouer contre ses propres valeurs, ce double bind par lequel on attaque les privilèges de l’aristocratie pour en réalité la défendre. Quant à Barrington Moore54, il lui reproche d’être exagérément mécaniste. Il rejette aussi Norbert Elias55 parce que, contrairement à Max Weber, il néglige l’exigence de légitimité, mais à mon sens – c’est un point sur lequel je suis en désaccord avec Roger Chartier – il a bien eu raison de le faire.
En revanche, il me semble qu’il aurait pu tirer beaucoup plus des livres d’autres auteurs, à commencer par Perry Anderson56, notamment pour l’histoire anglaise, qu’il prétend étudier en comparaison de l’histoire française, mais sur laquelle il s’étend très peu en réalité. Or, s’il est assez féroce avec lui, lui reprochant son fonctionnalisme, il a l’honnêteté de lui reconnaître une maîtrise exceptionnelle de la culture historique de seconde main. On ne peut que souscrire à cette opinion, et j’avoue avoir été fort déçu pour ma part quand, ayant contacté Perry Anderson pour participer aux conférences de l’ATP Genèse, il m’a dit être passé à tout à fait autre chose. Il est également dommage qu’il ne se soit pas plus appuyé sur Charles Tilly qui, par l’intermédiaire de Wim Blockmans, a eu une influence certaine sur le programme Origins of the Modern State de l’ESF : comme Anderson, Tilly avait une formidable maîtrise de la matière historique, et s’il est vrai que la dimension symbolique ne l’intéressait pas et lui échappait sans doute, il compensait cela par cette intelli-gence des phénomènes économiques qui
rend ses derniers ouvrages si précieux57. Enfin, la synthèse de Philip Corrigan et Derek Sayer, The Great Arch58 l’a beaucoup impressionné mais parce qu’il est consacré surtout à l’État anglais, i l ne s’est guère servi de leurs réf lexions, se demandant (un peu paradoxalement puisqu’il s’était lancé dans une démarche compa-rative) si l’Angleterre n’était pas un cas particulier. Or, si ce livre a été très mal accueilli par certains histo-riens, il est précieux par ses analyses sur la théorie de la légitimité, même si elles paraissent difficiles au lecteur français, et la grande force du modèle que proposent Corrigan et Sayer – Bourdieu le reconnaît – est qu’il s’oppose radicalement au modèle de l’État comme organe de coercition tel qu’il est développé par Elias et Tilly. La construction de l’État est pour eux liée à « la construction et à l’imposi-tion massive d’un ensemble de repré-sentations communes » et notamment par l’imposition de la nationalité par un processus de construction culturelle. Comme chez Durkheim, l’État apparaît comme instituant et imposant un conformisme moral. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les lectures historiennes de Pierre Bourdieu, que ce soit sur l’Orient (Robert Mantran, Paul Garelli, Keith Hopkins, etc.) ou sur la Chine (Pierre-Étienne Will). Mais certaines lacunes sont frappantes, surtout si l’on pense à son admiration pour Max Weber : l’absence de l’Antiquité romaine, mais, surtout, étant donné l’importance qu’il attache au pouvoir symbolique, celle de l’Église, et plus particulièrement de l’Église médiévale59.
En effet, si Pierre Bourdieu a très clairement perçu que le problème central était celui de la légitimité de l’État, il est gêné, comme le sont tous les sociologues
Jean-Philippe Genet
105
60. Voir notamment Jean-Philippe Genet (éd.), La Légitimité implicite, vol. 1 de la collection « Le pouvoir symbolique en occident », à paraître en 2014.
« généralistes » qu’il a évoqués mais aussi la plupart des historiens des époques moderne et contemporaine, par une opposition anachronique entre Église et État qui provient de ce que, sans doute inconsciemment, leur concept d’État est trop connoté historiquement. Dans la perspective de génétique structurale qui est celle de Pierre Bourdieu, cela masque un point crucial pour l’étude de la légiti-mité et du consentement, le fait que l’État s’oppose moins à l’Église qu’il ne naît d’elle. En devenant chrétien, l’Empire romain a institué un proces-sus de collaboration entre empereur et pape/patriarche qui, s’il s’est perpétué dans l’empire byzantin, est entré en crise dans l’Occident latin, où l’empe-reur est remplacé par de vulgaires rois barbares, et où les tentatives de restauration impériale (carolingienne et othonienne) échouent : or, dans la seconde moitié du XIe siècle, la papauté grégorienne se lance dans une formi-dable transformation des structures religieuses et culturelles de la société chrétienne (l’ecclesia) afin, inter alia, d’imposer la supériorité non seulement
spirituelle mais aussi temporelle du Pape, promu héritier des prétentions universalistes de l’empereur romain. Empereur et Christ à la fois, il se heurte à ces rois d’Occident dont il a contri-bué à légitimer le pouvoir pour affaiblir l’empire romain-germanique : si les premiers États modernes réussissent à imposer leur prélèvement et leur justice aux clercs, c’est qu’ils utilisent à leur profit les mutations culturelles déclenchées par l’Église pour assurer son triomphe ; leur système de commu-nication est le même, leurs administra-teurs sont des clercs, leurs souverains sont sacrés avec la connivence du pape. Le pape romain s’est emparé des attributs de l’empereur chrétien pour s’imposer comme souverain universel, les monarques s’empare-ront des mécanismes et des structures de légitimation créées par l’Église grégorienne pour obtenir le consente-ment nécessaire au prélèvement fiscal et à l’exercice de leur domination. C’est dans cette appropriation que s’est forgé ce lien entre État et légiti-mation non religieuse qui est le propre de l’État moderne européen60.
Critique à l’égard des historiens même si en fin de compte il prenait appui sur eux, plus critique encore avec les sociologues généralistes, Pierre Bourdieu a sans doute eu beaucoup de mal à se mouvoir dans les biblio-graphies colossales qu’impliquait son sujet, bibliographies qui auraient pu lui servir de mines pour nourrir systé-matiquement son projet de preuves et d’exemples. Il a eu le courage de les affronter mais ne les a pas vraiment dominées. Mais en ce qui me concerne, cette critique mesquine n’a en fait aucune importance. L’importance du Cours réside ailleurs, dans cette formidable capacité théor ique qui permet à Pierre Bourdieu de construire son « objet social histo-rique » et de livrer aux chercheurs, y compris historiens, des pistes et des orientations qui vont leur permettre de se renouveler et de travai l ler pendant des années. Pierre Bourdieu n’a sans doute pas réussi à unifier le travail de l’historien et celui du sociologue, mais grâce à lui, historiens et sociologues pourront apprendre à pratiquer l’interdisciplinarité !
À propos de Pierre Bourdieu et de la genèse de l’état moderne
106
Christophe Charle
MoNUMENt aUx 2 989 VICtIMES de la guerre de 1914-1918 érigé par la firme Siemens à Berlin à la mémoire de ses employés tués pendant la Première Guerre mondiale (œuvre de Hans C. Hertlein inaugurée par Carl Friedrich von Siemens le 5 août 1934). Inscription : « Aux camarades non oubliés qui trouvèrent une mort de héros dans la guerre mondiale, la maison Siemens » ; l’épée médiévale symbolise le combat de l’allemagne éternelle contre ses ennemis. La particularité de ce monument situé sur une place publique à proximité du siège social de l’entreprise à Berlin est d’avoir été entièrement financé par une firme privée qui s’empare ainsi d’une fonction symbolique de l’État au moment où celui-ci, du fait de la défaite, traverse une crise profonde.
Du bon usage des divergences entre histoire et sociologie
107ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 106-111
Histoire et sociologie
L’historien qui lit Sur l’État est frappé par deux attitudes de l’auteur apparemment contradictoires. D’une part, un discours plutôt critique est adressé aux historiens et en particulier aux historiens de l’État, accusés d’être victimes d’une certaine myopie et d’amplif ier les défauts ordinaires des historiens : régression à l’infini vers l’origine, découpage arbitraire et empirique des objets (histoire institutionnelle, histoire des crises comme la Révolution française), querelles autour de faux problèmes, absence de cumulativité et hyperspé-cialisation empêchant de dégager des grandes lois ou de grands invariants anthropologiques et transnationaux, érudition aveugle et position dominée face à la philosophie et en particulier à la philosophie politique.
D’autre part, la méthode d’analyse fondamentale pratiquée par Bourdieu, notamment celle des deux dernières années du cours, est fondée sur l’his-toricisation de l’objet État et de toutes les catégories qui le composent pour en établir la genèse sur la longue durée mais aussi les principes de fonctionnement à travers des comparaisons transversales entre périodes et entre États proches ou lointains. L’index final des noms, même s’il ne repose pas sur la totalité
des références bibliographiques mobilisées par Bourdieu, confirme cette impres-sion. Les historiens sont parmi les plus cités après quelques sociologues (Émile Durkheim, 38 mentions), Norbert Elias (32), Max Weber (60) ou théoriciens marxistes (Marx, 35 occurrences), Marc Bloch (13), Jean-Philippe Genet (12), Edward P. Thompson (10), Pierre-Étienne Will (10) Sarah Hanley (16), Keith M. Baker (8), Richard J. Bonney (8), etc. Dans plusieurs analyses, Bourdieu suit même pas à pas certains histo-riens mais en tire des conclusions que les auteurs eux-mêmes, prison-niers de leur habitus historien et malgré la rigueur de leur travail, n’ont pu tirer, faute, selon lui, de recul théorique et d’un usage raisonné de la comparaison.
Cette querelle faite à l’histoire par la sociologie rappelle aux historiens, qui ont la mémoire longue, de mauvais souvenirs, en particulier le fameux débat Simiand-Seignobos de 1903 sur lequel on glosait beaucoup il y a une trentaine d’années1. Les reproches adressés par Bourdieu aux historiens ne sont cependant pas tout à fait les mêmes que ceux de Simiand. Les historiens ont quand même beaucoup modifié leurs pratiques en un siècle.
Le rapport de forces entre les deux disciplines n’est plus non plus tout à fait identique et on peut même se deman-der si un raisonnement en termes de « discipline » comme celui auquel recourt sténographiquement l’auteur des Méditations pascaliennes a encore un sens aujourd’hui. Bien qu’histo-rien, je me sens souvent plus proche de certains sociologues que de mes confrères historiens2. À lire certains passages critiques de Sur l’État consa-crés à d’autres sociologues, on peut d’ailleurs affirmer que la confrater-nité est tout aussi relative au sein de la sociologie et plus largement des sciences sociales. El les sont devenues des champs tel lement éclatés et conflictuels qu’on serait bien en peine de dégager un « habitus » disciplinaire unifié, surtout si l’on raisonne dans un cadre international. Surtout, cette querelle ne concerne pas tant « l’histoire », terme qui ne signifie plus grand chose dans l’état actuel de la parcellisation des objets, des méthodes et des domaines, qu’une certaine histoire sur laquelle Bourdieu a réfléchi en priorité pour se procurer la documentation de son cours, soit, en gros, une certaine histoire de l’État dans ses différentes variantes plus institutionnelles ou plus sociales.
Du bon usage des divergences entre histoire et sociologie
1. Voir Madeleine Rebérioux, « Le débat de 1903 : historiens et sociologues », in Charles-olivier Carbonell et Georges Livet (dir.), Au berceau des annales. Le milieu
strasbourgeois. L’histoire en France au début du XXe siècle, toulouse, Presses de l’IEP, 1983, p. 219-230 et ma mise au point sur Charles Seignobos et ses relations
avec les sociologues dans Paris fin de siècle. Culture et politique, Paris, Seuil, coll. « L’univers historique », 1998, chap. 4.2. Christophe Charle, Homo historicus.
Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, Paris, armand Colin, coll. « Le temps des idées », 2013, notamment la conclusion.
Christophe Charle
108
3. Cf. Pierre Bourdieu, Sur l’état. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, coll. « Cours et travaux », 2012, p. 120 sq. (à propos de Perry anderson) et p. 244 (sur les marxistes japonais) ; on peut même aller
plus loin et montrer que, dès l’origine, la vision marxienne de l’histoire s’est construite à partir de la voie française pour dénoncer la « misère » révolution-naire allemande si bien que les marxistes ultérieurs ne font que rejouer sur d’autres
cas ce mode de comparatisme du manque inauguré par le père de la théorie (voir Christophe Charle, Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, armand Colin, coll. « Le temps des idées », 2011, chap. 4).
4. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 295.5. Joseph R. Strayer, Les Origines médié-vales de l’état moderne, Paris, Payot, 1979 et P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 296-299.
Cette focalisation sur cette bibliogra-phie historique particulière amène Bourdieu, me semble-t-il, à passer sur certains aspects de l’histoire de l’État ou des rapports de l’État avec d’autres problèmes sur lesquels les historiens ont pourtant beaucoup travai l lé. Mais il ne les mentionne guère alors qu’ils auraient, à mon avis, complété et renforcé ou nuancé certaines de ces analyses globales.
Violence et violence symbolique
Le premier point crucial est celui de la violence. Pour surenchérir sur Max Weber et le compléter et, en même temps, « tordre dans l’autre sens » le bâton des simplifications marxistes, Bourdieu insiste et met l’accent sur la violence symbolique légitime à côté de la seule violence lég i t ime monopol i sée dans l a classique définition webérienne, voire dans certaines analyses marxistes. L’historiographie contemporaine, avec son obsession des guerres et des génocides du XXe siècle, s’est au contraire focalisée sur le déchaîne-ment incontrôlé, voire incontrôlable de la violence d’État et ses formes extrêmes, légitimes ou non. Peut-on les interpréter seulement comme des pathologies, des déviations, alors que, dans les vingt dernières années, elles n’ont fait que s’amplifier sur de larges parties du globe, y compris à l’insti-gation « d’États de droit » supposés « normaux », États-Unis en tête ? De la même manière, les querelles déclenchées autour du bicentenaire de la Révolution française, très présentes implicitement ou explicitement dans le cours, ont été largement fondées sur des révisions de l’interprétation de la violence révolutionnaire, qu’elle soit spontanée ou organisée par l’État. Ces relectures sont souvent conduites à travers des analogies plus ou moins contrôlées faites avec les violences révolutionnaires ou de masse du XXe siècle. Remontant très en amont dans son histoire de la genèse de l’État, Bourdieu laisse de côté ce problème, même s’il introduit des incidentes
sur les moments où la violence symbolique n’est plus légitime et où l’État perd son monopole au profit de luttes de factions décidées par le rapport de force physique. Or toute la question fondamentale réside sans doute là : comment se fait le partage entre violence fondatrice, violence légitime, violence délégitimante, acceptation de la violence même illégitime jusqu’à y participer sans contrainte par condi-tionnement, entraînement, « moindre mal », même sans être authentique-ment partie prenante de l’État, comme on l’a vu dans certains génocides ou guerres civi les contemporaines ? Les réponses des historiens varient du tout au tout selon les modèles sociologiques, anthropologiques ou même philosophiques auxquels ils se rallient plus ou moins explicitement. Mais cela reste une question encore ouverte aussi pour la sociologie de l’État fondée sur une construction symbolique défendue par Bourdieu.
Quelle comparaison modélisante ?
On retrouve à ce propos une autre question qu’évoque aussi Bourdieu incidemment surtout sous forme de mise en garde : ne pas extrapoler les tendances dégagées à partir des comparaisons des cas vers une sorte de loi historique à sens unique, selon un modèle dont les étapes seraient parcourues peu ou prou à mesure que les États s’organisent et s’attribuent le monopole de la violence légitime et symbolique. Bourdieu aborde par exemple la question à propos de la critique des théoriciens marxistes des années 1960 qui prétendaient juger l’évolution des pays d’Europe par rapport à un idéal-type français extra-polé, fondé sur la rupture révolution-naire, et qui déploraient l’incapacité de la plupart des autres pays à suivre cette voie3. Les historiens marxistes ou non sont beaucoup revenus de ce type de raisonnement et la critique des « grands récits » fait partie des topoi constants jusqu’au rituel des historiens actuels. À certains moments de son cours, Bourdieu
est conscient qu’il risque de tomber dans ce travers d’une autre façon par ses comparaisons à petite ou large échelle : ainsi par exemple dans ce passage : « toutes ces visions me paraissent dangereuses et européo-centriques. Malgré tout la question que je formule pourrait paraître elle aussi européocentrique à beaucoup de spécialistes4. »
En suivant l’analyse du médiéviste Joseph R. Strayer5, il souligne en effet l’origine spécifique des États d’Europe occidentale comparés aux Empires du reste du monde ou de l’Anti-quité. Ces derniers n’étaient qu’une superstructure lointaine laissant une large autonomie d’organisation aux communautés rurales de base, pourvu que l’ordre soit respecté, et les obliga-tions militaires ou fiscales assurées. Les h istor iens des monarch ies anglaise et française ou espagnole pourraient probablement écrire la même chose, mutatis mutandis, pour la plus grande partie de ce qu’on désigne comme une longue histoire « moderne » allant souvent jusqu’au mi l ieu du X I Xe siècle, moment de consolidation des États-nations dans toute l’Europe. Les tensions entre les communautés locales et l’État monarchique se manifestaient toujours quand celui-ci entendait aller au-delà de ce contrôle lointain, exacte-ment comme les révoltes des régions périphériques contre les gouverne-ments des empires. La variable spéci-fique réside sans doute dans le ratio de contrôleurs par rapport aux contrôlés, l’ampleur du territoire à surveiller et surtout le poids croissant des guerres extérieures entre ces États finalement trop petits pour assurer leur finan-cement. C’est pourquoi ils doivent en permanence accroître la pression sur la populat ion principale ou modifier l’équilibre de la répartition des charges à mesure qu’augmentent les prélèvements des groupes consom-mateurs de ressources « publiques » et jouissant de privilèges exorbitants par rapport au commun des sujets. En tout cas, c’est le schéma que je propose au début de La Crise des sociétés
Christophe Charle
109
Du bon usage des divergences entre histoire et sociologie
VUE D’ENSEMBLE du site du monument avec l’aigle impérial allemand et le siège social de Siemens à l’arrière-plan.
110
6. Christophe Charle, La Crise des sociétés impériales. Allemagne, France, Grande-Bre-tagne 1900-1940. Essai d’histoire sociale comparée, Paris, Seuil, coll. « L’univers histo-rique », 2001. J’ai affiné le schéma sur le xIxe siècle pour la France et le Royaume-Uni dans « Le monde britannique, une société impé-riale (1815-1919) ? », Cultures & conflits, 77, 2010, p. 7-38 et « Les historiens et la conceptualisation des sociétés impériales en France et en angleterre », chap. 8 de Christophe Charle et Julien Vincent (dir.), La Société civile. Savoirs, enjeux et acteurs en
France et en Grande-Bretagne 1780-1914, Rennes, PUR, 2011, p. 205-233. Sur la question cruciale du prélèvement fiscal et son acceptation, voir Nicolas Delalande, Les Batailles de l’impôt. Consentement et résistances de 1789 a nos jours, Paris, Seuil, coll. « L’univers historique », 2011 ; Nicolas Delalande et Romain Huret (dir.), “tax resistance: a global history?”, Journal of Policy History, 5(3), 2013. Sur le cas américain, Romain Huret, Taxed. American Resisters to Taxation from the Early Republic to the Present, Cambridge (Ma), Harvard
University Press, 2014 (sous presse).7. Voir Christophe Charle, « Légitimités en péril. Éléments pour une histoire com-parée des élites et de l’État en France et en Europe occidentale (xIxe-xxe siècles), Actes de la recherche en sciences sociales, 116-117, mars 1997, p. 39-52.8. Pierre Bourdieu, La Noblesse d’état. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1989.9. Christophe Charle, les Hauts Fonction-naires en France au XIXe siècle, Paris, Gallimard, coll. « archives », 1980 ; « Nais-
sance d’un grand corps. L’inspection des finances à la fin du xIxe siècle », Actes de la recherche en sciences sociales, 42, avril 1982, p. 3-17 ; « Les grands corps », in Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, III, Les France, t.2, Paris, Gallimard, 1992, p. 195-235 ; « Les élites étatiques en France, xIxe-xxe siècles », in Bruno théret (éd.), L’état : le souverain, la finance et le social, Paris, La Découverte, 1995, p. 106-154 ; « La bourgeoisie de robe en France au xIxe siècle », Le Mouvement social, 181, octobre-décembre 1997, p. 52-72.
impériales6 pour distinguer, mais cette fois à l’intérieur de la seule Europe du XIXe siècle, les sociétés impériales (issues de cette lutte inces-sante entre États proches et rivaux) et les Empires multinationaux tradi-tionnels (Autriche-Hongrie, Russie, Empire ottoman) qui se décomposent sous l’effet de la crise déclenchée par la Première Guerre mondiale. La divergence avec l’analyse de Bourdieu ne porte pas sur le schéma de la concentration des ressources étatiques produite par la rivalité intra-européenne et la pression sur les surplus d’économies en croissance via la fiscalité et son affirmation crois-sante, mais plutôt sur la chronologie de la mutation en profondeur. À mon sens, Bourdieu la fait remonter trop haut sous l’influence de ses lectures médiévistes et modernistes.
Le Sonderweg français
Surtout ce qui frappe dans la dernière année du cours, c’est que, malgré le recours à des références anglo-saxonnes (mais surtout sur la France), la voie particulière française de l’État domine très largement la construction de ses généralisations. Cela semble, là encore, contraire aux principes métho-dologiques énoncés la première année. Or il existe d’autres modèles en Europe de fonctionnement de l’État, bien diffé-rents du cas particulier français avec sa centralisation, sa volonté uniformisa-trice ancienne, son conflit central avec une forme alternative de monopolisa-tion de la violence symbolique légitime, en l’occurrence celle de l’Église catho-lique dans sa double polarité nationale et transnationale, avec aussi sa fonction « d’instituteur national » et sa milita-risation profonde de la société depuis la Révolution française. Comment penser, à travers cette analyse, des États polycentriques où la violence légitime
ou non est partagée entre des niveaux territoriaux disjoints, où une large fraction des fonctions publiques ordinaires de l’État, du moins dans la tradition française ou continen-tale, est abandonnée à des instances privées, religieuses ou non, pour le profit ou non, et cela bien avant les politiques néolibérales contempo-raines, dans les cas britannique ou étasunien, voire allemand, italien ou espagnol, si bien que la séquence de l’État-providence ne fut qu’une brève parenthèse d’autant plus facile à remettre en cause à partir de la fin des années 1970.
La même tension se retrouve à propos de la modalité d’inculcation de la violence symbolique légitime au travers par exemple de l’école ; là aussi une tension fondatrice privée/publique, proche/lointain, famille/institution d’État traverse ses modalités de mise en place, non seulement selon les espaces nationaux, mais même au sein de chaque espace national. Elle concerne également le cas français où l’État n’a jamais eu de monopole de l’éducation même dans ses phases les plus militantes, républicaines ou révolutionnaires et pas seulement quand on remonte dans le temps ni dans les ordres d’enseignement.
Quelle noblesse d’État ?
Dans le cas français, un autre problème se pose quant à la question de la construction de la légitimité de l’État, notamment du fait de l’instabilité des régimes politiques qui caractérise le XIXe siècle et une partie du XXe siècle7. Comment celle-ci est-elle incarnée et produite par des groupes spécifiques qui agissent par délégation, dans un premier temps, du souverain, en tant que double corps, (au sens du « double corps du roi ») puis, après la rupture avec l’État monarchique, d’entités
abstraites : nation, République, État ? Là aussi, le cours Sur l’État semble souvent établ i r des cont inuités transhistoriques discutables pour la France en fonction de son schéma d’ensemble. La notion de noblesse d’État que Bourdieu a définie aupara-vant dans le livre qui porte ce titre8 à propos de la haute fonction publique française contemporaine (1989) et qu’il tend à projeter rétrospective-ment sur tous les groupes de juristes, de magistrats, de grands commis de la monarchie et, plus globalement, de la noblesse de robe d’Ancien Régime, pose un problème historique délicat. De tous les travaux consacrés aux élites et, en particulier, aux élites administratives et aux professions juridiques d’un long XIXe siècle9, il résulte qu’il y a plus de discontinuité que de continuité entre ces groupes qui formellement utilisent chacun à leur manière la légitimation de leur position par l’intérêt général et public. Chaque rupture de régime a permis de faire monter socialement et dans le champ du pouvoir certains groupes et d’en faire régresser d’autres, via les épurations, les révolutions, les guerres, les changements des réseaux de protection politique ou la mise en place de nouvelles formes d’évaluation du capital social et culturel néces-saire pour l’occupation des postes au sommet de l’État (passage de la recommandation, du népotisme, voire de l’achat de charges, aux examens et concours). Sans doute retrouve-t-on, à chaque fin de régime, l’émergence de nouvelles formes de transmis-sion dynastique ou de connivences politiques et clientélistes contraires à l’idéal public dont ces groupes se réclament en principe. Vincent Wright par exemple l’a montré pour la fin du Second Empire à propos des préfets et du Conseil d’État, d’autres travaux pour la fin de la Troisième Républ ique10. Ce que Bourdieu
Christophe Charle
111
10. Bernard Le Clère et Vincent Wright, Les Préfets du Second Empire, Paris, armand Colin, 1973 ; Vincent Wright, Les Préfets de Gambetta, texte complété, mis à jour et présenté par Éric anceau et Sudhir Hazareesingh, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007 ; Vincent Wright, Le Conseil d’état sous le Second Empire, Paris, armand Colin, 1972. 11. Christophe Charle, « Une dérive oligarchique », Le Débat, mai-août 1989, p. 190-192 et « Sciences-Po. entre l’élite et le pouvoir », Le Débat, 64, mars-avril 1991, p. 93-108.
a défini comme noblesse d’État pour les années 1970-1980 se relie à la même dérive qui réapparaît à mesure que la Cinquième République s’enracine11. Mais comme la France, malgré la crois-sance exponentielle des postes de la haute administration, reste fondamen-talement un État centralisé où l’accès aux postes les plus stratégiques passe par des protections politiques au centre, l’accaparement prolongé de l’État par une majorité politique fait naître imman-quablement des frustrations internes aux groupes également légitimes pour accéder à ces positions. D’où des tenta-tives, quand le changement politique intervient, pour modifier les règles du jeu en faveur du groupe provisoirement dominant ou en inventant des dériva-tifs nouveaux (pantouflage, nouvelles
administrations, nouveaux échelons de postes, carrières administratives inter-nationales). Ce conflit récurrent sur les règles du jeu rend difficile à mon avis l’usage d’un terme unificateur comme « noblesse » pour désigner les participants sans cesse renouvelés à ces luttes de prestige et de redéfinition des périmètres des fonctions de l’État et où les capitaux nécessaires pour accéder aux postes et les enjeux de luttes changent régulièrement.
Toutes ces remarques soulignent que ce cours ouvre à la fois des voies nouvelles mais n’apporte pas, comme tout cours forcément provisoire et inachevé, la théorie complète et exhaustive qu’une bibliographie foisonnante éloigne toujours plus de l’horizon du
pensable global. Le dialogue entre histoire et sociologie est plus que jamais nécessaire mais sur des bases renou-velées et non des querelles anciennes dépassées. Le comparatisme si décrié de divers côtés aujourd’hui au nom de paradigmes attrape-tout est d’autant plus indispensable qu’il est particuliè-rement difficile à pratiquer dans l’état de parcellisation des travaux. Moins que jamais enfin le sociologue, l’his-torien ou le politiste ne saurait dialo-guer avec Sur l’État comme on glose sur un « classique » pour l’embaumer. On se doit toujours de lui appliquer la même exigence critique et réflexive que Bourdieu pratiquait lui-même sur tout et en premier lieu sur lui-même pour le rendre vivant et productif d’idées nouvelles.
Du bon usage des divergences entre histoire et sociologie
112
George Steinmetz
État-mort, État-fort, État-empire1
FRoNtISPICE de Leviathan par thomas Hobbes, Londres, 1651.
113ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES numéro 201-202 p. 112-119
Les cours de Bourdieu sur l’État consti-tuent une contribution précieuse à la réflexion théorique et à la recherche empirique actuelles sur la question de l’État, et ce, à plusieurs titres.
Leur premier apport est de mettre au centre de l’analyse de l’État le pouvoir symbolique. Ils nous présen-tent ensuite une théorie de l’État conçu comme un type particulier de champ, un méta-champ. En troisième lieu, Bourdieu nous fournit des concepts permettant d’ana lyser l ’habitus des agents de l’État. Il ouvre ainsi la voie à une sociologie systématique des conflits internes au méta-champ étatique et à ses divers sous-champs. Enfin, le champ étatique est replacé au sein du champ du pouvoir, espace plus vaste que le premier, sans que les deux ne se confondent. Si Bourdieu semble rejoindre la théorie marxiste de l’État, selon laquelle ce dernier tend à servir les intérêts des « dominants », son analyse s’en écarte, en ce qu’il ne fait pas nécessairement du pouvoir d’État une émanation directe du capitalisme ou un simple dispositif fonctionnel à son service. À ce titre, on peut dire
que Bourdieu va bien plus loin dans sa théorie de l’État que les gramscistes ou autres néo-marxistes.
Il n’en reste pas moins que quelque vingt ans séparent le moment où ces cours sur l’État ont été prononcés et leur publication récente, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes qu’on peut qualifier de « bourdieusiens » : tout d’abord celui de l’écart entre texte et contexte, c’est-à-dire entre les conditions de produc-tion et de réception originelles de ces cours ; à quoi s’ajoute le contexte actuel de discussion, mais aussi celui des écarts initiaux entre le contexte dans lequel s’inscrit Bourdieu en 1989-1992 et les débats théoriques sur l’État auxquels il se réfère dans son séminaire.
En effet, ces cours ont été dispen-sés à la fin d’une période incroyable-ment riche en productions théoriques sur la question de l’État, production émanant de sociologues, de politolo-gues et d’historiens, en Europe et en Amérique du Nord. À cette époque, le débat tournait essentiellement autour de la question de l’autonomie relative de l’État à l’égard de l’économie
capitaliste. Certains marxistes, comme Nicos Poulantzas, soutenaient que l’État, pour être en mesure de satis-faire aux intérêts objectifs du capital, devait conserver une autonomie partielle vis-à-vis du contrôle instrumental direct du capitalisme. Ce sont ces marxistes d’obédience althussérienne qui ont les premiers popularisé le concept d’« autonomie relative », qu’on associe aujourd’hui si étroitement à Bourdieu2. Ralph Miliband, au Royaume-Uni, et William Domhoff, aux États-Unis, ont, de leur côté, développé une approche plus « sociologique » du problème de l’« État capitaliste ». À la fin des années 1970, la plupart des théoriciens de l’État estimaient le « débat » entre Poulantzas et Miliband comme définitivement tranché en faveur du premier3. Les chercheurs s’attachèrent ensuite à mettre au jour les mécanismes institutionnels qui, dans les sociétés capitalistes, condui-saient l’État, selon leur hypothèse, à favoriser les classes dominantes et à protéger l’accumulation du capital, même quand le gouvernement était aux mains des partis sociaux-démocrates ou travaillistes. Fred Block expliquait
État-mort, État-fort, État-empire1
1. Une première version de cet article a été présentée au CSU-CNRS, au cours d’un séminaire organisé par Franck Pou-peau, le 12 février 2012. Il a fait l’objet d’une seconde présentation lors d’une table ronde organisée par Loïc Wacquant au congrès annuel de la Social Science History association de Chicago, le 21 novembre 2013.2. La théorie bourdieusienne de l’autonomie relative était certainement nourrie par les
discussions néo-marxistes autour de ce concept (ou, en tout cas, d’un concept du même nom), d’autant plus que c’est à l’École normale supérieure, dont Bourdieu venait juste de sortir, que ces dernières virent le jour dans les travaux d’althusser. Dans ses cours sur l’État au Collège de France, Bourdieu ne mentionne Poulantzas que trois fois, la première fois en l’évacuant rapidement (p. 33), les deux autres fois en le présentant comme une espèce de
sociologue crypto-américain, l’associant à theda Skocpol dans une même métaphore dépréciative, évoquant « l’ornière Skoc-pol/Poulantzas ». Pourtant, Poulantzas, décédé l’année même où Skocpol publie States and Social Revolutions (1979), n’a jamais mentionné la sociologue américaine dans aucune de ses publications. De toute évidence, Bourdieu fait ici référence à un débat qui opposa les chercheurs améri-cains au milieu des années 1980, débat qui,
au moment où Bourdieu donne ses cours, était dépassé. Qu’il s’agisse de Corrigan et Sayer dans The Great Arch (1985) ou de tilly dans Coercion, Capital and Euro-pean States (1990), aucun d’eux ne se réfère à Skocpol, mais Corrigan et Sayer citent Poulantzas.3. Pour le point de départ de ce débat, voir Ralph Miliband, “the capitalist state: a reply to Nicos Poulantzas”, New Left Review, 59, janvier-février 1970, p. 53-60.
George Steinmetz
114
4. Fred Block, Revising State Theory. Essays in Politics and Postindustrialism, Philadelphie, temple University Press, 1987. 5. Gøsta Esping-andersen, Roger Friedland et Erik olin Wright, “Modes of class struggle and the capitalist state”, Kapitalistate, 4-5, 1976, p. 186-220.6. Louis althusser, « Idéologie et appa-reils idéologiques d’État (Notes pour une recherche) », La Pensée, 151, juin 1970, p. 3-38.7. Voir, par exemple, Bob Jessop, “Narra-ting the future of the national economy and the national state: remarks on remapping regulation and reinventing governance”, in George Steinmetz (éd.), State/Culture. State-
Formation after the Cultural Turn, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1999, p. 378-406.8. Pour une comparaison entre Luhmann et Bourdieu, voir armin Nassehi et Gerd Nollmann (éds), Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2004 ; pour une tentative de conciliation entre Luhmann et la théorie marxiste de l’État, voir Bob Jessop, „Zur Relevanz von Luhmanns Staatstheorie und von Laclau und Mouffes Diskursanalyse für die Weiterentwicklung der marxistischen Staatstheorie“, in Joachim Hirsch, John Kannankulam et Jens Wissel (éds), Der Staat der Bürgerlichen Gesellschaft. Zum Staatsverständnis von Karl Marx, Francfort-
sur-le-Main, Nomos, 2008, p. 157-179.9. Giorgio agamben, State of Exception, Chicago, the University of Chicago Press, 2005.10. Voir néanmoins Pauline Jones Luong et Erika Weinthal, Oil is Not a Curse. Ownership Structure and Institutions in Soviet Successor States, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.11. Hamid Dabashi, The Arab Spring. The End of Postcolonialism, Londres, Zed Books, 2012 ; atef Said, “the paradox of transition to ‘democracy’ under military rule”, Social Research, 79(2), 2012, p. 397-434.12. aux États-Unis, le problème du caractère « dysfonctionnel » de l’État nazi
occupait une grande place dans les débats sur la théorie de l’État au milieu des années 1980, lorsque j’étais encore étudiant en sociologie, et ce problème était au centre des séminaires que j’ai donnés à l’Université de Chicago à partir de 1988.13. George Steinmetz, “Geopolitics”, in George Ritzer, The Wiley-Blackwell Ency-clopedia of Globalization, vol. II, Malden (Ma), Wiley-Blackwell, 2012, p. 800-822. Voir aussi tanisha M. Fazal, State Death. The Politics and Geography of Conquest, Occupation, and Annexation, Princeton, Princeton University Press, 2007.
cette situation par le fait que le fonction-nement propre de l’État dépendait des revenus produits par l’économie privée capitaliste, ce qui créait de fait une convergence entre les intérêts des groupes gouvernants et ceux des classes capitalistes4. De son côté, l’ouvrage de Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States (1990), que Bourdieu discute de façon approfondie, combi-nait la causalité marxiste à l’analyse causale webérienne. Dans le chapitre qui concluait son ouvrage, Tilly abordait le cas d’États se trouvant affranchis de toute dépendance à l’égard du capita-lisme local (en raison, notamment, d’aides ou d’investissements étran-gers), et constatait que leurs politiques publiques ne favorisaient plus néces-sairement les intérêts des classes dominantes locales.
Dans les années 1970, les néo- marxistes commencèrent à s’intéresser aux conditions dans lesquelles un État pourrait s’attaquer ou contrevenir aux intérêts du capitalisme, et mettre ainsi en échec la reproduction du système capitaliste. En 1975, déjà, Erik Olin Wright, Gøsta Esping-Anderson, et Roger Friedland soutenaient que les « limites du possible structurel » imposé par les structures étatiques pourraient bien ne pas correspondre aux « limites de la compatibilité fonctionnelle » inhérente aux besoins du Capital5. Leur étude parut aux États-Unis dans une éphémère revue marxiste, Kapitalistate [voir document, ci-contre].
C’est aussi aux théoriciens néo- marxistes de l’État qu’on doit les débuts de la conceptualisation d’une notion qui s’apparente à cel le de violence symbolique. Les travaux d’Althusser portaient non seulement sur le pouvoir coercitif de l’État, mais aussi sur son pouvoir idéologique – son pouvoir de créer des subjectivités
et des catégories de pensée6. Les socio-logues Corrigan et Sayer, salués par Bourdieu, se trouvaient au cœur des débats qui agitaient le marxisme cultu-rel autour de la question de l’État. Les régulationnistes eux aussi voyaient dans la domination culturelle un élément participant d’un dispositif ou d’un « mode de régulation » plus vaste7.
En négl igeant les recherches les plus avancées que le néo-marxisme avait menées sur la question de l’État au cours de la décennie qui précé-dait son séminaire, Bourdieu tomba dans un piège dont les néo-marxistes eux-mêmes étaient déjà en train de sortir à l’époque. En rejetant le fonctionnalisme et en ouvrant la possibilité qu’un État puisse ne pas réussir à trouver une solution à la crise du capitalisme, les théoriciens, de Habermas à Jessop, avaient pointé du doigt la possibilité d’un effondrement de l’État. La théorie de la régulation mettait en avant le caractère irréductiblement impré-visible des crises de société, et leur ouverture historique : toute crise affectant un « mode de régulation » ouvrait sur un futur impossible à prévoir. Pour les régulationnistes, la question de la fonctionnalité de l’État dans le maintien du capitalisme était une question ouverte. Le regain d’inté-rêt que connut, à la fin des années 1980, le concept d’« État d’excep-tion » de Carl Schmitt, y compris dans les milieux néo-marxistes et post-marxistes, attira l’attention sur la possibilité d’une autonomie presque complète de l’État. Cette idée d’une capacité d’autonomisation des systèmes – système politique, système judiciaire et autres sous-systèmes – se retrouvait également chez Niklas Luhmann et sa théorie des systèmes autopoïétiques8.
Un des acquis de ces débats qui agitèrent les années 1980 fut donc la prise de conscience qu’il existait tout un éventail de possibilités, allant de la mort de l’État à l’autonomie radicale de ce dernier, avec, situés entre ces deux extrêmes, les situa-tions « normales », qui nourrissaient depuis longtemps la réf lexion des marxistes occidentaux, des pluralistes et des théoriciens des élites.
Dans sa communication au colloque consacré à Sur l’État au Collège de France le 23 janvier 2012, Franck Poupeau a fait remarquer qu’un des éléments du contexte dans lequel Bourdieu menait sa réflexion était l’effondrement des États balkaniques. De fait, le problème de l’effondrement de l’État est apparu récemment lors des débats sur l’« État d’exception »9, la « malédiction du pétrole » (les pétro-dollars constituant une source d’autono-mie radicale de l’État)10 et le « Printemps arabe »11 et ses conséquences. Sans doute était-ce trop demander à Bourdieu que de lire Carl Schmitt en 1989 – mais peut-être aurait-il pu consulter une partie de la littérature historique qui, à l’époque, s’intéressait au nazisme en tant que forme de suicide collectif de l’État12. Tilly lui-même avait, dans ses recherches, abordé aussi bien la question de la disparition de l’État que celle de son développement. La fin de l’État a toujours été au centre des préoccu-pations des chercheurs en géopolitique et relations internationales13.
Ces fructueux débats des années 1980 sur la question de l’État, ont produit quelques avancées significatives. En premier lieu, ils ont contribué à mieux cerner la question de l’auto-nomie relative de l’État. Ensuite, ils ont soulevé le problème de l’« État d’exception », dont l’horizon ultime est l’autonomisation totale de l’État.
George Steinmetz
117
14. Voir l’article d’abram de Swaan, dans ce numéro.15. adam Przeworski, Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cam-bridge, Cambridge University Press, 1991.16. Mahmood Mamdani, Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism, Princeton, Princeton University Press, 1996 ; George Steinmetz, « Le champ de l’état colonial. Le cas des colonies alle-mandes (afrique du Sud-ouest, Qingdao, Samoa) », Actes de la recherche en sciences sociales, 171-172, mars 2008, p. 122-143.17. Lisa Wedeen, Ambiguities of Domi-nation. Politics, Rhetoric, and Symbols
in Contemporary Syria, Chicago, the Uni-versity of Chicago Press, 1999.18. Fanny Colonna, Instituteurs algériens, 1883-1939, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1975, p. 168-169.19. Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories, Princeton, Princeton University Press, 1993.20. Voir, par exemple, Michael Burleigh et Wolfgang Wippermann, The Racial State. Germany 1933-1945, Cambridge, Cam-bridge University Press, 1991. Naturelle-ment, on trouvait aussi, dans les colonies européennes et l’allemagne nazie, des
politiques d’État fortement alignées sur les intérêts du capitalisme.21. Christophe Charle, La Crise des sociétés impériales, Allemagne, France, Grande-Bretagne, 1900-1940. Essai d’his-toire sociale comparée, Paris, Seuil, 2008 [1ère éd. 2001].22. Pierre Bourdieu, Sur l’état. Cours au Collège de France 1989-1992, Paris, Raisons d’agir/Seuil, coll. « Cours et tra-vaux », 2012, p. 213.23. Ibid., p. 297.24. Ce point était déjà traité par Michael Mann dans le premier volume de The Sources of Social Power, New York, Cambridge University Press, 1986.
25. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 126. Voir aussi Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant, “on the cunning of imperia-list reason” (« Sur les ruses de la raison impérialiste »), Theory, Culture & Society, 16(1), 1999, p. 41-58.26. Cf. notamment Pierre Bourdieu et abdelmalek Sayad, Le Déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Paris, Minuit, coll. « Documents », 1964 ; voir aussi Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1958.27. Pour la question de l’État colonial et de sa violence, voir notamment P. Bourdieu et a. Sayad, Le Déracinement…, op. cit.
Cette question a soulevé, à son tour, celle de la possibilité d’un retour en arrière, qui verrait l’État recourir à des modes de domination principa-lement coercitifs plutôt que symbo-liques, c’est-à-dire un retour à la violence pure et simple14. En lien avec ces questions, c’est la notion même de légitimité de l’État qui s’est trouvée critiquée15. Enfin, ces débats ont permis d’affiner l’analyse du concept d’« État défaillant » et d’« effondrement de l’État ».
Depuis la fin des années 1980, chacune de ces questions a fait l’objet de recherches poussées. On peut citer, entre autres, celles menées sur l’irra-tionalisme économique de certaines pratiques étatiques – question restée jusque-là en marge des débats sur la théorie de l’État –, à propos de l’État colonial16, de l’État nazi et de certains États autoritaires comme la Syrie de Bachar el-Assad17. Au cours des trente dernières années, les chercheurs en sociologie historique ont décrit en détail la logique irréduc-tiblement raciale de l’État nazi et des États coloniaux européens. Dans une étude historique sur la formation des instituteurs algériens en Algérie française, inspirée de la sociologie de l’éducation de Bourdieu, Fanny Colonna a montré que le pouvoir colonial mettait une barrière infran-chissable sur la voie de l’acculturation, en définissant l’« excellence » scolaire comme une qualité intermédiaire : était « excellent » celui qui, sans être resté trop proche de sa culture d’origine, ne s’était pas non plus trop rapproché de la culture occiden-tale18. Pour Partha Chatterjee, ce qui distingue l’État colonial en tant que tel, c’est son application de la « règle de la différence coloniale », qui interdit à la plupart des sujets
colonisés d’accéder aux mêmes droits, à la même reconnaissance et au même statut que les colonisa-teurs19. Mes propres travaux sur la politique indigène menée dans trois États coloniaux allemands ont mis en évidence le fait que l’attachement des gouvernements à la question de l’ordre et leur volonté de racialiser la domina-tion les avaient souvent conduits à adopter une logique anti-économique qui avait sapé les investissements et le commerce européens, aussi bien que les intérêts matériels des colons. Les historiens du nazisme, de leur côté, ont montré que la logique implacable de l’antisémitisme exterminationniste avait souvent contrarié les intérêts du capitalisme allemand20.
Une dernière problématique à avoir été étudiée de manière plus approfon-die depuis les cours de Bourdieu est celle de l’empire, conçu comme un type spécifique de formation politique, part iel lement dist inct de l’État-nation21. Dans ses cours au Collège de France (comme dans d’autres de ses écrits), ce qui intéressait principale-ment Bourdieu était la genèse de l’État moderne européen, et le processus de transition entre l’État dynastique et l’État bureaucratique. Dans cette perspective, les empires ne sont consi-dérés que comme des précurseurs des États-nations modernes – en tant que « vastes États que les théoriciens appellent empires »22. Concernant la période moderne, Bourdieu circons-crit les empires aux « périphéries de l’Europe » uniquement, négligeant les empires coloniaux européens des XIXe et XXe siècles. Pour lui, les Empires russe, chinois, ottoman, romain, et autres grands empires territoriaux, se distinguaient des États européens en ce qu’ils ne constituaient qu’une sorte de « superstructure »
qui « laissait les unités sociales au niveau local relativement indemnes »23. Bourdieu néglige le fait que les empires modernes disposent souvent d’extensions de leur pouvoir central, qui fonctionnent localement à la manière d’États – qu’empires, États, et formations mixtes sont pris dans un continuum24. Il utilise indifféremment « empire » et « État », comme des termes interchangeables (il parle, à un moment, de « ce type d’empire, d’État »)25. Mais les empires sont davantage que des États géants, et ne sont pas les simples ancêtres des États modernes. La conception que Bourdieu se fait de l’État est celle, conventionnelle, de l’État démocra-tique moderne d’Europe occidentale. Cela est d’autant plus surprenant que ses premiers travaux portaient préci-sément sur un « État d’exception » en Algérie26, et que la France ne devint un simple État-nation qu’en 1962, lorsqu’en rendant son indépendance à l’Algérie, elle renonça au dernier élément vital de sa structure impériale (Fred Cooper). En outre, une décennie seulement sépare les premiers cours de Bourdieu sur l’État de l’inter-vention militaire que la France avait menée en Centrafrique pour évincer le célèbre « Empereur » Bokassa Ier (Jean-Bédel Bokassa), dans un conflit où s’affrontaient néo-colonialisme français et néo-impérialisme africain [voir document, ci-contre].
On comptait à cette époque plus d’une centaine de sociologues français ayant travaillé, ou travaillant encore, pour certains, sur le colonialisme et l’empire, parmi lesquels, bien entendu, Bourdieu lui-même27. Bourdieu avait attiré l’attention sur l’énorme somme de travaux réalisés sur le colonialisme par les sociologues français, lors de son intervention au colloque « Ethnologie
état-mort, état-fort, état-empire
118
28. Pierre Bourdieu, « Les conditions sociales de la production sociologique : sociologie coloniale et décolonisation de la sociologie », in Henri Moniot (éd.), Le Mal de voir. Ethnologie et orientalisme, politique et épistémologie, critique et auto-critique, Paris, Union générale d’éditions (UGE), coll. « 10/18 », Cahiers Jussieu 2, 1976, p. 416-427.29. Voir déjà chez Pierre Bourdieu, Les Struc-tures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000. Voir aussi Johan Heilbron, “towards a sociology of translation: book translations as a cultural world-system”, European Journal of Social Theory, 2(4), 1999, p. 429-444 ; Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999 ; Gisèle Sapiro
(dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France a l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS Éd., 2008.30. Gisèle Sapiro, « Le champ est-il natio-nal ? La théorie de la différenciation sociale au prisme de l’histoire globale », Actes de la recherche en sciences sociales, 200, décembre 2013, p. 70-85 ; George Steinmetz, “Social fields at the scale of empires: revising Bourdieu’s theory”, His-tory and Theory (à paraître).31. Neil Brenner, New-State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, oxford, oxford University Press, 2004.32. David Lambert et alan Lester (éds), Colonial Lives Across the British Empire. Imperial Careering in the Long Nineteenth
Century, Cambridge, Cambridge Univer-sity Press, 2006 ; George Steinmetz, “a child of the empire: British sociology and colonialism, 1940s-1960s”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, 49(4), 2013, p. 353-378.33. Crawford Young, The African Colo-nial State in Comparative Perspective, New Haven, Yale Universi t y Press, 1994. Sur le système du « gouverne-ment indirect », voir Frederick Lugard, Representative Forms of Government and “Indirect Rule” in British Africa, Edim-bourg, W. Blackwood & Sons, 1928 et, M. Mamdani, Citizen and Subject…, op. cit.34. Voir Georges Balandier, entretien réa-lisé par George Steinmetz et Gisèle Sapiro,
« tout parcours scientifique comporte des moments autobiographiques », Actes de la recherche en sciences sociales, 185, décembre 2010, p. 44-61.35. Sur la distinction entre espace social et champ, voir Pierre Bourdieu, La Distinc-tion. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1979.36. P. Bourdieu, Sur l’état…, op. cit., p. 209.37. Hannah arendt, The Human Condition, Chicago, the University of Chicago Press, 1998 ; Michael Hill et Peter Hupe, Implemen-ting Public Policy: Governance in Theory and in Practice, Londres, Sage, 2002.
et politique au Maghreb » en juin 197528. Il est d’autant plus surprenant qu’il ne fasse pas le lien entre le thème de l’« État » et celui du « colonialisme ».
L’approche de Bourdieu demanderait, à mon sens, à être reformulée sur au moins quatre points majeurs. Le premier, auquel j’ai déjà fait allusion, c’est la nécessité de faire la différence entre États et empires. Le deuxième point concerne l’échelle géographique. On ne saurait considérer les champs (ou les espaces sociaux) comme coextensifs à l’État-nation : souvent, leur étendue excède ses frontières (ou, à l’inverse, opèrent un rétrécisse-ment par rapport à elles). Ce fait a été reconnu dans des études histo-riques qui se réclament de Bourdieu29, mais ce n’est que depuis peu qu’on a vu paraître les premières études s’attachant à repenser et à adapter la carte des champs à l’échelle spatiale des empires et des espaces transna-tionaux constitués par des rapports de force asymétriques en général30. L’État métropolitain lui-même connaît plusieurs subdivisions territoriales, selon une échelle de niveau allant du « central » au « régional » et au « local »31. On peut voir les extensions de l’État se prolonger au-delà de ses frontières, dans ses colonies d’outre-mer, ses consulats et ambassades à l’étranger, ses bases militaires, et ses zones d’extraterritorialité. Les champs et les espaces sociaux de la bureaucratie coloniale s’étendaient sur des empires entiers, avec des individus circulant entre métropole et colonie, ou de colonie à colonie, ou encore occupant différentes fonctions au sein d’une seule et même colonie ou zone d’influence impériale. C’est ce que les historiens ont appelé l’« imperial careering » (la « carrière impériale »)32.
En troisième lieu, il est nécessaire de préciser que les empires coloniaux modernes comprenaient une multitude de champs étatiques. Il y avait toujours (au moins) un État – européen – dans chaque colonie. Ensuite, dans les colonies régies par le système du « gouvernement indirect » (indirect rule), l’État européen conquérant coexistait avec un nombre indéfini d’États indigènes, dont les pouvoirs étaient généralement réduits, mais jamais inexistants33. Enfin, à tous ces États s’ajoutait l’État métropolitain – le seul à avoir concentré l’attention des « théoriciens de l’État ».
Prise dans son ensemble, cette combina ison d’admin ist rat ions coloniales métropolitaines et d’États coloniaux d’outre-mer constitue un espace administratif impérial. Ici, j’aimerais établir une distinction entre les espaces sociaux impériaux et les champs impér iaux . Les systèmes administratifs des États coloniaux formaient souvent des champs cohérents. Autrement dit, les fonctionnaires impériaux pouvaient, dans certains cas, aller et venir entre différentes administrations coloniales. De même, un sociologue travaillant sur les colonies comme Georges Balandier a été en mesure de circu-ler entre plusieurs colonies françaises au cours des dix premières années de sa carrière, engagée en 194634. Il en allait de même pour les sociologues du colonialisme britannique dans les années 1940 et 1950. À d’autres égards, toutefois, les empires ne constituaient pas des champs unifiés, mais un assemblage de champs, qui coexistaient au sein de forma-tions moins intégrées qu’on pourrait appeler des espaces impériaux35. La distinction entre champ impérial
et espace impérial apparaît le plus clairement dans les cas où la mobilité entre l’administration coloniale métro-politaine et le service des colonies d’outre-mer se t rouvait l imitée (certains États coloniaux, par exemple, établissaient parfois entre eux et les fonctionnaires des autres colonies une cloison étanche visant à les tenir à l’écart). Qui plus est, dans la mesure où plusieurs empires coexistent dans un même moment historique, nous pouvons parler d’un méta- espace d’espaces administrat i fs impériaux, chacun ancré dans un empire national spécifique.
La quatrième retouche concerne la façon plus ou moins interchangeable dont Bourdieu utilise les expressions « champ étatique », « champ bureau-cratique » et « champ administra-tif ». Cet usage est trompeur, et pas seulement parce que les activités étatiques prennent souvent une forme non-bureaucratique36. Il s’agit ici d’apporter une clarification, plutôt que de procéder à une véritable révision de la théorie. Bourdieu néglige souvent d’expliciter la distinction qui existe entre la politique en tant que telle et l’administration publique, ou, pour le dire autrement, entre les secteurs de l’État chargés de la formulation des politiques publiques (par le biais de décrets gouvernementaux, de lois parlementaires, de décisions de justice, ou de textes élaborés par divers bureaux ou commissions) et celui de la bureaucratie chargée de leur mise en œuvre37. Bien évidemment, cette distinction est implicite dans sa théorie de l’État et des champs en général, et des études plus récentes se sont penchées sur la question de la mise en œuvre des politiques publ iques ou de la « pol it ique
George Steinmetz
119
38. Voir Vincent Dubois, La Vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, coll. « Études politiques », 1999 ; Loïc Wacquant, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement
de l’insécurité sociale, Marseille, agone, 2004 ; Didier Fassin, La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2011 ; les travaux en cours de Sébastien
Roux sur la politique de l’adoption.39. Pour aperçu de ce point de vue dans la théorie des relations internationales, voir Frédéric Mérand et Vincent Pouliot, « Le monde de Pierre Bourdieu : éléments
pour une théorie sociale des relations internationales », Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 41(3), septembre 2008, p. 603-625.
au guichet »38. Il est donc nécessaire de distinguer entre le champ de l’État au sens large (qui inclut un grand nombre de fonctionnaires et d’admi-nistrateurs subalternes) et un champ étatique plus étroit, comprenant les responsables politiques et chefs d’État, les hauts fonctionnaires, les juges et les législateurs.
Six thèses sur l’État et l’empire
Après avoir critiqué le travail de Bourdieu sur l’État, je voudrais mainte-nant dire en quoi il nous aide à nous représenter ce dernier plus clairement.
1) Premièrement, l’État doit être conçu à la fois comme une machine à tuer, et comme un fantasme d’unité, de totalité et d’universalité. Pour le dire autrement : l’État cherche à s’assurer à la fois le monopole de la violence physique et celui de la violence symbo-lique. Bien entendu, comme Bourdieu le faisait remarquer, les machines à tuer ne peuvent tuer que pour autant qu’il existe des significations communes. Cela n’impl ique pas forcément le partage d’une idéologie ou de valeurs particulières, mais il faut qu’il existe, au minimum, un ensemble de catégo-ries de pensée communes. De toute évidence, certaines formes d’exercice du pouvoir étatique se satisfont d’un minimum de légitimité culturelle. C’est particulièrement visible dans le système international, où les thèses soi-disant « réalistes » tiennent souvent le haut du pavé, et où les logiques impériales sont guidées par une Realpolitik qui, souvent, se contente d’essayer de se légitimer après coup – ou, comme dans le cas de l’État de Bush/Cheney, et sans doute aussi dans celui de l’État d’Assad, ne s’en donne même plus la peine.
2) Deuxièmement, comme le suggère Bourdieu, l ’État est un champ dominant : c’est un méta-champ. Et c’est un champ qui se différencie de tous les autres en ce que le contrôle de l’État fait l’objet de luttes singulièrement vives, si vives qu’il existe un mot spécifique pour désigner le contrôle de l’État : la souveraineté. Certes, ce mot s’applique aussi métaphoriquement au contrôle exercé dans d’autres domaines ou sur
d’autres entités, y compris le Moi, mais dans son acception la plus rigoureuse, il ne renvoie qu’au contrôle de l’État. Et parce que le contrôle que ce dernier exerce sur les ressources du pouvoir est si grand, les controverses pour ou contre la préservation de l’État sont, elles aussi, particulièrement intenses. Bien entendu, il y a d’autres crises qui sont appréhendées comme telles – au moins par certaines catégories de la population –, comme la marchandi-sation de l’art, le déclin des humanités, la mort de l’industrie du livre, ou la privatisation de l’université. Mais quand c’est l’État tout entier qui se trouve menacé, en cas de guerre, d’invasions ou d’événements catastrophiques, il suscite une mobilisation et un émoi sans comparaison, qui engagent l’ensemble de la société. Cela montre bien la diffi-culté qu’il y a à utiliser le concept de champ pour décrire l’État. L’État n’est pas un champ comme les autres.
3) Troisièmement, le conflit entre autonomie et hétéronomie, caractéris-tique d’autres champs, revêt une forme spécifique dans le domaine de l’État. Alors que l’autonomie, dans un champ culturel ou scientifique, soustrait en grande partie ce champ aux regards du public, un État doté d’une très forte autonomie, par exemple une dictature, continue à jouer un rôle central dans la vie sociale et peut garder une très grande visibilité. Dans le contexte de l’État, l’hétéronomie peut signifier deux choses différentes. D’un côté, l’hété-ronomisation du champ étatique peut renvoyer à la théorie « pluraliste » et à celle du « marxisme instrumental » – elle suggère une domination de l’État par le champ de la politique électorale ou par le champ économique. Bourdieu n’igno-rait pas cette complexité de niveaux, et distinguait le champ du pouvoir du champ politique et du champ bureaucra-tique. Relativement au champ politique, l’État est fondamentalement perméable, à tout le moins dans les démocraties électorales, où les élections et les partis politiques menacent périodiquement de modifier l’ensemble de la structure interne de l’État. Intrinsèquement, l’État se trouve ainsi à la fois plus et moins autonome que d’autres types de champs.
Au regard du champ politique, l’État est soumis à des luttes si intenses, et les conflits qui le traversent mobilisent une telle somme de pouvoir et un tel investis-sement de ressources, qu’on peut diffi-cilement, dans ce domaine, le comparer aux autres champs, où l’on observe rarement un tel degré d’exacerbation.
D’un autre côté, l’hétéronomie extrême renvoie, non pas à la prise de l’État par la société civile, mais à la disparition de l’État, comme dans le cas des « États défaillants ».
4) Quatrièmement, l’État, davantage que la plupart des objets sociaux, se distingue par son haut degré de territorialisation. Il existe d’autres objets sociaux qui, sur ce plan, s’appa-rentent aux États – les empires, les villes, les régions – mais, dans une certaine mesure, ils appartiennent tous à la même catégorie d’objets géopolitiques que l’État. Bourdieu y fait allusion dans ses cours sur l’État 1 et 2, mais il ne précise pas que les champs diffèrent dans leurs formes et degrés de territorialisation.
5) Cinquièmement, l’autonomie de l’État se définit non seulement vis-à-vis des champs domestiques, mais aussi, fondamentalement, vis-à-vis d’autres États à l’intérieur d’un champ ou système étatique international. Ainsi, alors qu’on peut très bien imaginer qu’un champ culturel soit en mesure de vivre en vase clos, en se constituant un micro-univers ou un micro-nomos bien à lui, les États, en revanche, ne peuvent exister qu’à l’intérieur de systèmes étatiques39.
6) Enfin, les États sont étroitement liés aux empires. Mais ces deux catégories ne sauraient se confondre, ni se concevoir en termes d’un « Avant » et d’un « Après », comme des formes « archaïques » ou « modernes » d’une même entité. Les États se trouvent souvent au cœur d’empires plus vastes. L’État français était au centre d’un empire colonial mondial, bien plus vaste que lui, et incluant également en son sein un grand nombre d’États coloniaux semi-autonomes. Souvent, l’empire est le télos ou l’origine de l’État.
Traduit de l’anglais par Frédéric Junqua
état-mort, état-fort, état-empire
120
RésumésL’action de l’État, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux
En permettant de dépasser les fausses oppositions et les limites des notions ad hoc souvent mobilisées dans les approches dominantes de l’analyse des politiques publiques, le mode de pensée relationnel de la théorie des champs offre une base utile à la construction des politiques d’État comme un objet à part entière de l’analyse sociologique. Cet article propose dans cette perspective de mobiliser le concept de champ pour analyser l’action publique en tant qu’elle est fondée socialement sur des relations entre espaces sociaux distincts et contribue en retour à les structurer.
Régimes génocidaires et compartimentation de la société
À mesure que les États ont émergé et donné naissance à un système interétatique en monopolisant les moyens de la violence légitime sur leurs territoires respectifs, ils ont accumulé les ressources leur permet-tant de livrer des guerres toujours plus destructrices à l’encontre d’autres États. Ce phénomène ne concernait toutefois que des confrontations entre des parties en présence relativement symétriques, fort différents des épisodes de violence de masse extrêmement asymétriques au cours desquels des hommes organisés et armés s'en prennent à des populations non organisées et désarmées, donnant ainsi lieu à des situations d'extermination de masse. Ces épisodes d’extermination mas-sive sont la résultante d'un processus de compartimentation qui se vérifie à tous les niveaux de la vie sociale : au niveau macro-sociologique des transformations sociales et culturelles; au niveau méso-sociologique des politiques du régime en place ; au niveau micro-sociologique d’une « dé-iden-tification » et d’un ostracisme croissants et quotidiens à l’encontre du groupe-cible ; et enfin, au niveau « psychologique » de l’internalisation du rejet du groupe-cible. Ce processus de compartimentation ne suit pas la même séquence dans tous les épisodes d’extermination de masse, mais on retrouve dans chaque cas de nombreux
éléments, voire la plupart d’entre eux. on peut ainsi distinguer quatre types d’extermination massive. Premièrement, la « furie conquérante » : lorsqu’une armée victorieuse déferle sur une nation vaincue et se livre à des meurtres de masse afin de punir et de terroriser la population. Deuxièmement, un régime en place peut recourir à un « régime de terreur» afin d'inti-mider sa propre population. troisièmement, un régime sur le point d’être vaincu par une armée étrangère peut encore recou-rir à l’extermination de masse contre un groupe-cible dépourvu de défenses, dans une configuration de « triomphe du per-dant ». Et enfin, une vague apparemment spontanée de pogroms locaux, déclenchée et synchronisée par un événement majeur, ce qu'on appellera un « mega-pogrom ».
Le Brésil : un État-nation à construire
Lors du processus de constitution des États-nations modernes, l’identité nationale a été construite à travers des symboles tels que le drapeau et l’hymne national. Si dans la monarchie le « corps politique » du roi représentait la permanence de la commu-nauté nationale, le « pouvoir sans corps » de la république avait besoin de symboles collectifs. au Brésil, les symboles de la république, qui ne s’est constituée qu’en 1889, n’indiquent cependant pas une rup-ture radicale avec le régime monarchique antérieur comme ce fut le cas en France. Le drapeau impérial, esquissé par Jean-Baptiste Debret de la Mission artistique française, renvoyait aux couleurs dynas-tiques du couple impérial. au moment de la constitution de la république, on garda sa structure en y ajoutant la devise « ordem e Progresso », qui attestait que le groupe politique des positivistes avait su impo-ser son interprétation de la république. Quant à l’hymne national, la république ne put en imposer une nouvelle version, le peuple ayant su manifester avec succès sa prédilection pour l’hymne impérial que l’on conserva. Pour l’allégorie de la république, il y eut des tentatives de représentation par des figures féminines, trop proches cependant de la Marianne française. La figure historique de tiradentes rencontra une résonance plus durable, elle permet-tait d’incarner plusieurs dimensions de la nation : l’abolition de l’esclavage et l’indé-pendance, le passé et le présent.
L’érosion discrète de l’État-provi-dence dans la France des années 1960
L’article tend à montrer la brièveté de l’épisode keynésien dans la vie politique française et la fragilité des conversions de l’élite politico-administrative au key-nésianisme. Les transformations des compétitions bureaucratiques dans les années 1960 et le caractère extrême-ment dispersé et fluctuant des politiques économiques et sociales de la prési -dence gaulliste permettent de repérer l’émergence d’orientations, de pratiques, de méthodes, plus sensibles à la question de la réduction de la dépense publique et à la restauration des grands équilibres économiques. au cours des années 1970, ces réformes discrètes de l’appa-reil d’État et des politiques publiques sont publicisées et accentuées, formant ce qui devient un tournant néo-libéral.
Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires
Les études sur la police tendent à oppo-ser deux thèses, l’une dite de l’insularité, insistant sur le pouvoir discrétionnaire des agents, l’autre dite de l’instrumenta-lité, les considérant au service de l’auto-rité publique. L’enquête ethnographique conduite dans la région parisienne sur le travail de patrouille des unités de sécu-rité publique, et plus particulièrement des brigades anti -criminalité, permet de résoudre cette apparente contradic-tion entre la vision d’un État dans l’État et la conception du bras armé de l’État. En s’appuyant sur l’observation des pra-tiques en matière de répression des infrac-tions à la législation sur les stupéfiants et en resituant la fameuse culture du résultat dans le cadre de la réorientation de la poli-tique pénale, il est possible d’établir que, particulièrement dans les quartiers popu-laires, l’insularisation de l’activité policière constitue le moyen le plus efficace de son instrumentalisation. ainsi les gardiens de la paix font-t-ils à la fois ce qu’ils veulent et ce que l’on attend d’eux. L’inégale distribu-tion de l’usage de la sanction et de la force au détriment des populations défavori-sées principalement d’origine immigrée redouble et légitime l’inégale distribution des ressources sociales. tout en justifiant son action au nom de la sécurité collective
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 201-202
121
et du bien commun, l’État pénal reproduit ainsi l’ordre social et, paradoxalement, fragilise l’ordre public.
Bourdieu, l’État et l’expérience chinoise
L’auteur débute par quelques réflexions sur la forme de l’enseignement de Pierre Bourdieu au Collège de France telle que la révèle Sur l’état et sur l’opposition entre le travail du sociologue et celui de l’historien, sur laquelle Bourdieu s’interroge beaucoup dans ce texte. Il reprend ensuite un certain nombre de considérations sur l’État déve-loppées dans l’ouvrage pour les confron-ter à l’expérience historique chinoise, sur laquelle il se réfère à quelques-unes de ses propres recherches – ainsi, sur l’assi-milation de l’État à une divinité ou à une personne, sur l’État en tant que « champ », ou encore sur la genèse de l’État.
À propos de Pierre Bourdieu et de la genèse de l’État moderne
Pierre Bourdieu s’interroge sur l’État en tant qu’objet social historique. En cela, il s’écarte de sa démarche antérieure, mais aussi de celle des historiens qui se limitent le plus souvent aux aspects maté-riels de l’État. Sa critique de l’approche des historiens est sévère, mais elle ne le conduit pas à remettre en cause sa confiance en leurs travaux. Pierre Bour-dieu donne sa propre définition de l’État : il est ce qui fonde l’intégration logique et morale du monde social : si le consente-ment et la communauté ainsi créés sont illusoires, cela n’enlève rien à la puissance de cette illusion. La définition webérienne s’en trouve modifiée : il faut parler du monopole de la violence physique et de la violence symbolique, cette dernière l’emportant largement sur l’autre. De fait, la concentration et la maîtrise du pouvoir symbolique par l’État sont au cœur de la recherche de Pierre Bourdieu qui propose, pour analyser la façon dont le pouvoir symbolique génère consentement et légiti-mité, deux concepts : celui de la génétique structurale, pour comprendre la genèse des objets sociaux historiques tels que l’État, et celui de champ. Un aspect important du cours est la confrontation des vues de Pierre Bourdieu sur la genèse de l’État avec celles des « sociologues généralistes »,
dont il fait une critique sévère mais nuancée des théories historiques. Mais il est dom-mage qu’il ne se soit lui-même intéressé ni à l’antiquité ni au Moyen Âge, ce qui lui interdit de voir à quel point le pouvoir symbolique de l ’État s’est développé sur le modèle et dans le sillage de celui de l’Église et de la monarchie pontificale, dont l’essor est précisément contemporain de la genèse de l’État moderne.
Du bon usage des divergences entre histoire et sociologie
Sur l’état est fondé à la fois sur une ana-lyse critique des pratiques des historiens sur ce sujet et sur un recours massif à la démarche historique pour fonder la théorie de la monopolisation de la violence symbo-lique légitime qui sous-tend la perspective de Bourdieu. L’article revient sur les usages de l’histoire et de la comparaison par Bour-dieu et pointe un certain nombre de diver-gences avec les orientations actuelles de l’historiographie contemporaine où la vio-lence physique « légitime » des États a été surtout au centre des recherches. De la même manière alors que Bourdieu établit une perspective de longue durée remontant au Moyen Âge, les historiens même influen-cés par la sociologie structurale insistent beaucoup plus sur les ruptures et les déca-lages entre l’émergence et l’affirmation des divers types d’États dans les périodes récentes. Ce cours ouvre bien des voies nouvelles mais n’apporte pas, comme tout cours forcément provisoire et inachevé, la théorie complète et exhaustive qu’une bibliographie foisonnante éloigne toujours plus de l’horizon du pensable global. aussi le dialogue entre histoire et sociologie est-il plus que jamais nécessaire mais sur des bases renouvelées et non des querelles anciennes dépassées. Le comparatisme si décrié de divers côtés aujourd’hui au nom de paradigmes attrape-tout s’avère d’autant plus indispensable qu’il est particulièrement difficile à pratiquer dans l’état de parcel-lisation des travaux. Sur l’état en fournit certaines clés.
État-mort, État-fort, État-Empire
Le cours de Bourdieu sur l’État replace le méta-champ étatique au sein du champ du pouvoir. Mais si Bourdieu semble rejoindre
la théorie marxiste selon laquelle l’État tend à servir les intérêts des « dominants », il s’en écarte du fait qu’il ne voit pas nécessairement dans le pouvoir d’État une émanation directe du capitalisme ou un simple dispositif fonctionnel à son service. Cet article montre qu’il est nécessaire de replacer le cours de Bourdieu sur l ’État dans l ’espace des déba ts des années 1970 e t 1980 sur l ’État pour comprendre à la fois l’originalité de l’analyse propo-sée mais aussi le fait qu’elle se limite aux États démocratiques de l ’Europe occidentale, en évacuant la question de l’empire et de l’État colonial.
SummariesHow the relations between social fields both shape state policy and are shaped by it
to the extent that the relational approach of field theory enables us to overcome the false dichotomies and the shortcomings of the ad hoc concepts usually found in maintream policy analysis, it is a powerful conceptual resource that makes it possi-ble to frame state policy as an object for sociological analysis. In this perspective, the paper proposes to use Bourdieu’s con-cept of field to consider public policy as a process that is socially shaped by the relations between distinct social spaces and shapes them in return.
Genocidal regimes and the compartimentalization of society
as states emerged in a system of states, monopolizing the means of violence within their respective territories, they accumu-lated the resources to wage ever more destructive wars against other states. But these were confrontations between relatively symmetric parties. this contrasts with the extremely asymmetric episodes of mass violence by organized and armed men against unorganized and unarmed
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 201-202
122
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 201-202
people that constitute instances of mass annihilation. Leading up to such episodes of mass annihilation is a process of compar-timentalization at all levels of social life: at the macrosociological level of societal and cultural transformation; at the mesosocio-logical level of the ruling regime’s policies; at the microsociological level of increasing everyday “disidentification” and avoidance of the targeted group; and, finally, at the “psychosociological” level, of internalization of the predominant rejection of the targeted group. this compartmentalizing process does not occur in the same sequence in all episodes of mass annihilation, but many or most elements may be found in every instance. In fact, four kinds of mass annihilation may be distinguished. First, “conquerors’ frenzy”: when a victorious army overruns a defeated foreign nation and loses itself in mass killings to pun-ish and terrorize the population. Second, an established regime resorts to a “regime of terror” in order to intimidate its own pop-ulation. third, a regime that is about to be defeated by a foreign army nevertheless resorts to mass annihilation of a defense-less target group: a “losers’ triumph”. and, finally, a wave of apparently spontaneous local pogroms, unleashed and synchronized by a major event:a “mega-pogrom”.
Brazil: a nation-state in the making
the symbols of the Republic established in Brazil in 1889 do not indicate a radical break with the previous monarchical regime, as was the case in France. the colors of the imperial flag refer to those of the Bragança dynasty. the Republic maintained the flag’s structure, but added the motto “order and Progress,” which attested to the fact that the positivists had managed to impose their interpretations upon the new regime. as for the national anthem, the Republic failed to choose a new one and the people manifested their preference for the old imperial anthem. as for the alle-gory of the Republic, there were attempts to represent it with female figures which were, however, too similar to the French Marianne. the figure of tiradentes had a resonance that was more durable because it allowed for the interconnection of two pri-mary dimensions of the nation: the abolition of slavery and independence.
the discreet erosion of the welfare state in the 1960s France
this article describes how short-lived the Keynesian episode has been in the French political life. It also points out the fragility of the political-administrative elite’s conver-sion to Keynesianism. In the 1960s, the evolution of bureaucratic competitions as well as the very scattered and fluctuating social and economic policies of de Gaulle presidency were early signs indicating the emergence of practices and methodolo-gies aimed at reducing public spending and restoring a balanced economy. During the 70s, these initially low profile reforms of the state and of public policy became increas-ingly publicized and reinforced, eventually becoming a neoliberal turning point.
Discretionary power and security politics
Studies of the police tend to pit two theses against each other: the first is the thesis of the “insularity” of the police and it empha-sizes the discretionary power of police agents; the second is the “instrumental-ist” thesis which considers policemen as agents of public authority. Ethnographic fieldwork conducted in the Paris area on the patrolling work of the public safety units of the police, and more specifically anti-crime brigades, makes it possible to solve this apparent contradiction between the notion of a state-within-the-state and the concep-tion of the police as the armed branch of the state. Building upon the observation of repressive practices seeking to enforce leg-islation on drugs and resituating the notori-ous “result-driven management” within the context of the general reorientation of penal policy, the article suggests that the insulari-zation of police activity constitutes the best means of its instrumentalization, especially in poor neighborhoods. It is by doing what they want that policemen also do what is expected of them. the unequal distribution of the use of force and of sanction against underprivileged populations composed mostly of recent immigrants overlaps with and legitimizes the unequal distribution of social resources. By justifying its policy in the name of collective security and the common good, the penal state thus repro-duces the social order while, paradoxically, weakening public order.
Bourdieu, the state and the Chinese experience
this article starts with some reflections on the form of Bourdieu’s lectures at the Collège de France as they appear in Sur l’état, and on the opposition between the work of the sociologist and that of the historian, as they are discussed at length in the text. It then addresses several considerations about the state developed in these lectures and sets them against the historical experience of the Chinese state; it questions in particular notions of the state that liken it to a person or a god, the notion of the state as a “field,” and the genesis of the state.
about Pierre Bourdieu and the genesis of the modern state
Pierre Bourdieu analyzes the state as a social-historical object. In doing so, he parts with his previous approach, but also with the approach of historians who often limit themselves to the consideration of the material aspects of the state. His cri-tique of this historical approach is severe, but it does not lead Bourdieu to doubt the value of the historians’ work. He pro-poses his own definition of the state: the state is what makes possible the logical and moral integration of the social world. If the consent and the community thus created are illusory, this does not take anything away from the power of such an illusion. the Weberian definition of the state is thus modified: one should talk about the monopoly of physical violence and of symbolic violence, the latter pre-vailing largely on the former. as a matter of fact, the concentration and control of symbolic power by the state are at the center of Bourdieu’s work. He proposes to analyze the way in which symbolic power generates consent and legitimacy with two concepts: the concept of “struc-tural genetics,” which explains the gen-esis of social-historical objects such as the state, and the concept of “field.” an important aspect of the lectures is the comparison of Boudieu’s views with those of the “generalist sociologists,” whose historical theories he criticizes strongly yet with nuance. Yet, one regrets that Bourdieu has never expressed a signifi-cant interest in the antiquity or the Middle
123
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 201-202
ages, since it prevents him from seeing the extent to which the symbolic power of the state has developed after the model and in the wake of the power of the Church and of the papal monarchy, the development of which is contemporary with the birth of the modern state.
on the appropriate use of the divergences between history and sociology
the first of Bourdieu’s Collège de France lectures, Sur l’état, is based upon both a critical analysis of the historians’ work on the topic and on a massive reliance on a historical approach in order to estab-lish the theory of the monopolization of legitimate symbolic violence that under-lies Bourdieu’s perspective. the paper examines Bourdieu’s use of history and of comparison, and indicates a number of differences with the main orientations of contemporary historiography, which
focuses mostly on “legitimate” physical violence. Similarly, while Bourdieu follows a long-term perspective going back to the Middle ages, historians, even when they are influenced by structural sociology, emphasize much more the discontinui-ties and the discrepancies between the emergence and the consolidation of differ-ent types of states in recent periods. this lecture does open new perspectives, but, being provisional and unfinished like any lecture, it does not provide a complete and exhaustive theory, which a prolific bibliography constantly expels from the realm of what is thinkable. as a result, the dialogue between history and sociology is more necessary than ever, but it must also take place on a renewed basis, rather than on obsolete quarrels. Comparatism has been criticized so frequently in the name of catch-all paradigms, but it turns out to be indispensable, not least because i ts pract ice is made more di f f icul t by the fragmentation of existing work that
currently prevails in this field. Sur l’état provides some hints as to how this can be done.
Defunct state, strong state, empire state
this article argues that Bourdieu’s lectures help to reframe the study of the state. of prime importance is Bourdieu’s conceptualiza-tion of the state as symbolic violence and as a distinct sort of meta-field. Conflicts within and over the state are particularly intense, and the struggle between autonomy and heteronomy takes a specific form. this article also argues that Bourdieu’s theory needs to be resituated in the space of debates over the state in the 1970s and 1980s and in more recent discus-sions of empire and colonial states. the con-cept of state should not continue to be seen as a modern stage following an archaic period of empires. States and empires are often com-bined as empire-states. Even in the modern era, states sometimes give way to empires.
Tous les arTicles proposés sont soumis par le comité de rédaction à au moins deux évaluateurs anonymes. La décision de publication appartient au comité de rédaction, coordonné par les responsables éditoriaux et le directeur de publication.
RActes de la recherche en sciences sociales ne publie que des textes inédits.
RL’article peut être soumis dans une autre langue que le français. Il peut être de longueur variable mais ne doit pas dépasser 60 000 signes (notes et espaces compris), sauf cas particulier dont la pertinence sera appréciée par le comité de rédaction. Il doit être accompagné d’un résumé de 1 000 signes et de cinq mots-clés.
RLe texte, en style Times New Roman, corps 12, et interligne double doit être présenté sans autre enrichissement typographique que les caractères italiques : pas de feuille de style ni de tabulation.
RIl n’y a pas de bibliographie en fin d’article.
R Limiter le nombre de notes et les réserver aux références bibliographiques.
R Les notes méthodologiques ou commentaires annexes feront l’objet d’un encadré inséré dans le texte et signalé en laissant un blanc avant et après.
RLes représentations graphiques doivent utiliser le noir et le gris ainsi qu’un graphisme (ligne, pointillé, etc.) permettant de différencier les courbes. Les fonds des graphiques ne doivent pas être tramés. Toutes les données sont saisies en Arial (corps 10 pour les légendes).
RLes graphiques doivent être fournis avec leurs données sources, sous Excel, et non dans un format « image ».
RLes documents illustratifs doivent être joints en fichier séparé, en format JPEG, avec une résolution de 300 dpi au moins, format A4. Les originaux (coupures de presse, photographies sur papier) pourront être demandés en cas de publication. Dans la mesure du possible, les auteurs doivent s’enquérir des détenteurs de droit sur les images qu’ils souhaitent utiliser.
RLa revue incite les auteurs à joindre tout matériel susceptible d’étayer les travaux en vue d’une diffusion sur le site de la revue (statistiques complémentaires, iconographie, enregistrements audio et vidéo, etc.) Les auteurs fourniront une note de présentation de ces annexes électroniques.
REn cas d’acceptation, les auteurs seront invités à produire un résumé en anglais d’environ 1800 mots (10 000 signes) présentant la problématique, les méthodes, la principale contribution de la recherche ainsi que les matériaux qui ont servi à son élaboration. La revue attire l’attention des auteurs sur l’importance de rédiger ces résumés dans un anglais de bonne qualité.
R Les coordonnées des auteurs, ainsi que leur rattachement institutionnel, doivent figurer sur la feuille de résumé (nom, prénom, adresse postale, courrier électronique et numéro de téléphone). Ces informations ne seront pas transmises par le secrétariat de rédaction lors de la communication du texte pour évaluation.
L’ArtiCLe soumis doit être trAnsmis pAr Courrier éLeCtronique et/ou pAr LA poste
Actes de la recherche en sciences sociales,Collège de France, 3 rue d’Ulm, 75005 Paris
Modalités de soumission des articles à la revue
Les Actes de la recherche en sciences sociales sont disponibles sur internet
Les résumés en français, anglais, allemand et espagnol sont disponibles sur le site de la revue : http://www.arss.fr
http://www.persee.fr pour les numéros de 1 à 150
http://www.cairn.info du numéro 135 aux plus récents (accès payant pour les trois dernières années)
ww
w.ar
ss.fr
Directeur Maurice aymard
Comité de rédaction Jérôme Bourdieu, Patrick Champagne, Christophe Charle, olivier Christin, François Denord, Yves Dezalay, Julien Duval, Julien Fretel, Nicolas Guilhot, Johan Heilbron, Brigitte Le Roux, Dominique Marchetti, Frédérique Matonti, Franck Poupeau, Bénédicte Reynaud, Gisèle Sapiro, Franz Schultheis, Sylvie tissot, Loïc Wacquant
Secrétaires éditoriaux François Denord, Julien Duval, Dominique Marchetti, Franck Poupeau, Bénédicte Reynaud, Sylvie tissotSecrétariat de rédaction 3 rue d’Ulm 75005 ParisChristine Grosse, Sylvie Prin, Marie-Christine Rivière Site internet et diffusion internationale : Élodie Couratier, Étienne ollion et Jocelyne Pichot Courriel [email protected]
Administration Éditions du Seuil, 25 boulevard Romain Rolland CS 21418 - 75993 Paris Cedex 14
Graphisme atelier du Bonjour
Conseil scientifique Christian Baudelot, alban Bensa, Jacques Bouveresse, Rogers Brubaker, Craig Calhoun, Roger Chartier, aaron Cicourel, Robert Darnton, Mireille Delmas-Marty, Itamar Even-Zohar, anne Fagot-Largeault, Yves Gingras, Klaus Herding, Éric Hobsbawm, Joseph Jurt, Haruhisa Kato, David Laitin, Remi Lenoir, Sergio Miceli, Daniel Roche, M’hammed Sabour, Nancy Scheper-Hughes, Quentin Skinner, Pierre-Étienne Will, William Julius Wilson
Rédacteurs associés Catherine Bidou-Zachariasen, anna Boschetti, Philippe Bourgois, Michel Bozon, Éric Brian, Donald Broady, Pascale Casanova, Inès Champey, Stefan Collini, Christoph Conrad, Deyan Deyanov, Vincent Dubois, Rick Fantasia, Laurence Fontaine, Sandrine Garcia, Bertrand Geay, Michel Gollac, Michael Grenfell, alicia Gutiérrez, odile Henry, Isabelle Kalinowski, arthur Kleinman, Bernard Lacroix, Roland Lardinois, Frédéric Lebaron, Maria Malatesta, Margaret Maruani, Gérard Mauger, Christian de Montlibert, treserra Montserrat, Francine Muel-Dreyfus, Erik Neveu, Françoise Œuvrard, Dag osterberg, Nikos Panayotopoulos, Denis Pelletier, Michel Pialoux, Patrice Pinell, Louis Pinto, alejandro Portes, annick Prieur, Lutz Raphael, Lennard Rosenlund, Saskia Sassen, Jürgen Schlumbohm, Margareta Steinrücke, Hugo José Suarez, Ivan Szélényi, Göran therborn, Yves Winkin, tassadit Yacine, aristide Zolberg
Revue trimestrielleDirecteur de la publication : Jérôme BourdieuImprimé en France chez Normandie Roto Impression s.a.s., Lonrai. tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays. Dépôt légal : 1 e trimestre 2014
Bulletin d’abonnementà retourner à :
Éditions du SeuilAbonnements12, rue du Cap vert21 800 Quetigny
Veuillez m’inscrire pour :
un abonnement (un an : quatre livraisons)
un réabonnement à partir du numéropréciser le numéro et l’année
Nom : M., Mme, Mlle
Prénom :
adresse :
Code postal :
Ville :
courriel :
Je joins un règlementà l’ordre des Éditions du Seuil
France : 49 euros Étranger : 63 euros
Par chèque à l’ordre des Éditions du Seuil
Par virement international sur le compte bancaire : IBaN FR76 30003 03080 00020040527 07
Par carte bancaire (CB, Visa, eurocard) n°.................... Expire fin .......... / Indiquez les 3 derniers chiffres au dos de votre carte : ..........
REVUECrédits photos et illustrations
1re et 4e de Couverture, p. 112 © RMN-Grand Palais (Institut de France). Photo/Gérard Blot.
p. 4 Barthélémy l’Anglais, Le Livre des propriétés des choses. © Bibliothèque nationale de France.
p. 7 Libre de droits (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiananmen-Wroclaw-plDominikanski.jpg).
p. 17 David Easton, “An approach to the analysis of political systems”, World Politics, 9(3), 1957, p. 384 (haut).
Michel Arnaudon, « Rationalisation des choix budgétaires et développement économique des pays du Tiers Monde », Tiers-Monde, 12(47), 1971, p. 654 (bas).
p. 18-19 © AFP Photo/Jacques Demarthon.
p. 20 Financial industrial complex, 2002. Cartographie. © Bureau d’études.
p. 22-23 Ambrogio Lorenzetti, L’Allégorie du Bon Gouvernement, fresques du Palazzo Pubblico à Sienne, 1337-1340 (fragments).
p. 26 © Bundesarchiv, Bild 1011-270-0298-07.
p. 39 © EyesCoffee.com.
p. 44 Libre de droits (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Décio_Villares_%281851-1931%29._Tiradentes,_ost,_60,5_x_49,7cm.jpg).
p. 51 Libre de droits (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro: Décio_Villares_%281851-1931%29._República,_ost,_60_x_49cm,_photo_Gedley_Belchior_Braga.jpg).
p. 58 Libre de droits.
p. 65 © Association pour la libre entreprise, Vive la liberté, Paris, 1948.
p. 79 Annexe au Rapport relatif aux relations police/citoyens et aux contrôles d’identité, Le Défenseur des droits, 2012.
p. 84 Libre de droits (http://voituredepolice.niceboard.com/ t31-ecussons-des-brigades-anti-criminalite et http://b-a-c.skyrock.com/1.html).
p. 92-93 © Bibliothèque de l’Institut des hautes études chinoises du Collège de France.
p. 98 Libre de droits (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sylvester_I_and_Constantine.jpg?uselang=fr).
p. 103 © Associazione Culturale Info. Roma. It.
p. 106 Libre de droits (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siemens_Ehrenmal_Spandau_4.jpg).
p. 109 Werner Siemens und sein Werk, Siemens & Halske/ Siemens-Schuckertwerke, Berlin, 1936. Photo. © Siemens.
p. 115 © San Francisco Bay Area Kapitalistate Group, 1976.
p. 116 Libre de droits.